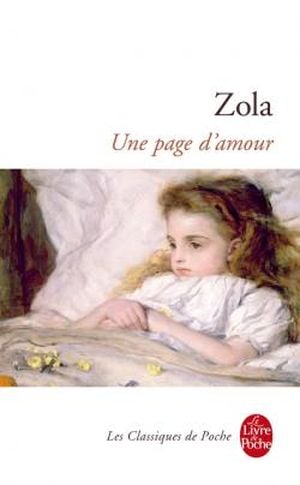Zola, écrivant à Huysmans, trouve sa page d'amour "bien plate et grise", lui qui passe des vacances studieuses à l'Estaque à écrire Une page d'amour et commence déjà à imaginer ce que Nana sera.
Il n'est pas tellement étonnant que Zola trouve son histoire peu inspirante, le contraste avec l'Assommoir étant il est vrai, un peu violent. Pourtant c'est précisément ce que l'auteur recherchait, montrer qu'il pouvait écrire autre chose, suivant le conseil de Flaubert qui pensait qu'il "serait fâcheux de faire beaucoup de livres comme celui-là". Et Zola, qui avait depuis longtemps pensé à ce roman, décide donc de ne pas s'enfermer dans la description du populaire. Il voulait une page d'amour, "une opposition, une halte de tendresse et de douceur".
Sans dévoiler la suite du roman, force est de constater que Zola a une bien curieuse façon d'envisager la tendresse et la douceur, le roman inclinant vers le drame. Il ne s'agit pas seulement de décrire un moment d'égarement entre une veuve, mère d'une petite fille maladive, et un médecin bourgeois, marié et père d'un garçon. La passion c'est aussi celle de l'enfant pour sa mère, de l'ami de la famille, amoureux digne, envers Hélène, de Juliette pour la superficialité, de Rosalie pour Zéphyrin et de Zola pour Paris.
Le roman ronronne agréablement puis dans les deux dernières parties prend des allures de tragédie grecque. Il n'a pas la puissance de l'assommoir, bien évidemment, mais ce n'est pas le but recherché, il n'a pas les envolées descriptives du ventre de Paris mais est moins superficiel et terne que ce que son auteur en pensait.