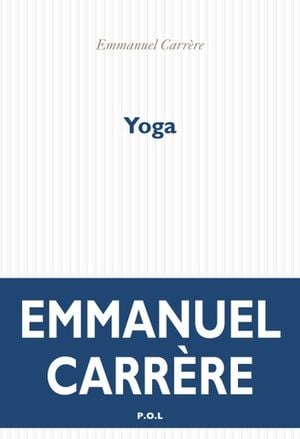On en veut toujours à un écrivain, qu'on aime penser être son préféré, de nous décevoir et de rater ce dans quoi il excellait jusqu'alors : nous toucher. Cela vaut d'ailleurs pour les artistes en général, et même, soyons audacieux, pour les personnes qu'on aime tout court.
Je précise. Ce n'est plutôt pas le fait que Carrère me touche qui me fait aimer son travail. C'est même lorsqu'il cherche à me toucher, comme il essaie, parfois réussit, mais pas toujours, avec ce présent livre, que Carrère me parle. Disons parle, oui.
D'autres vies que la mienne, son plus grand succès, commercial, critique et public, et, selon ses dires, celui de ses livres qu'il préfère, ne m'avait pas tant enthousiasmé que ça, car Carrère s'engageait dans une tentative perpétuelle de se dépasser lui-même pour sortir voir l'Autre et sa souffrance, pour aller voir, comme le titre l'indiquait, d'autres vies que la sienne.
Carrère l'a d'ailleurs toujours fait, en tant que journaliste au statut un peu particulier, dont on sent dans ses premiers articles, publiés dans l'excellent recueil Il est avantageux d'avoir où aller, un talent particulier pour la mise en scène de son propre regard et une aisance totale dans l'art du récit, dans l'art de raconter des histoires, art propre à la littérature (ce qu'il est peut-être absurde de rappeler, mais qui chez Carrère prend tout son sens).
Aller vers l'autre tout en ne sortant pas de soi, ça s'appelle tout bonnement la vie, et c'est ce que Carrère, lorsqu'il n'écrit pas des fictions, a toujours fait.
Lorsque Carrère me parle, j'y reviens, c'est lorsqu'il m'obsède. Lorsque sont couchées sur le papier ses obsessions qui à leur tour m'obsèdent, lorsqu'en est réalisé le récit, l'analyse subjective jamais détachée d'un contexte objectif qu'il tente de contrôler.
Lorsque Carrère me parle c'est lorsqu'il écrit Un Roman Russe, lorsque plein de confiance suite au succès du brillant L'Adversaire, il se sentait écrivant surpuissant, démiurge et control freak, confondant sa vie, son histoire, avec celles d'autres, et pensait les maîtriser, la sienne, et celle des autres, justement. La force de Carrère vient probablement de ses échecs, du récit pathétique de ses souffrances, de ses obsessions, de son narcissisme névrosé, et non, je pense, lorsqu'ouvert à l'autre, il se démocratise.
J'avais émis l'hypothèse, il y a quelques temps, qu'en s'ouvrant ainsi à l'autre, Emmanuel Carrère deviendrait un meilleur être humain, ce qui est l'objectif désespéré de son travail d'écrivain, comme il ne le cesse de le répéter livre après livre. Selon lui, cela mènerait aussi à devenir un meilleur écrivain. Je n'en étais pas si sûr, moi qui l'aimais pour ce qu'il détestait (et au fond de moi j'espérais bien qu'il échouerait dans cette quête du mieux, si cela lui permettait d'être l'écrivain torturé que j'aime lire).
En allant mieux Carrère sortirait donc de son maladif égocentrisme, ou bien c'est en sortant de son maladif égocentrisme qu'il irait mieux, cela va de toute façon un peu dans les deux sens et simultanément.
Une hypothèse balayée par l'arrivée surprise de ce Yoga.
Surprise car Carrère ne semblait plus avoir la force d'écrire de livres, avouant lui-même son absence de sujet, et ayant pour actualité tout plein d'autres choses : l'écriture et le tournage d'un film adapté d'un livre de Florence Aubenas, un recueil de ses articles précédemment nommé, quelques articles (pour The Guardian ou la revue XXI) et un livre hommage d'amis et universitaires sur son œuvre, accompagné de textes inédits.
En 2020 est donc publié ce Yoga, au titre aussi bref qu'énigmatique. Un livre sur la dépression, un retour annoncé à l'auto-analyse et à la plongée dans les méandres chaotiques de ses pensées.
J'y voyais un espoir odieusement heureux de retrouver l'écrivain névrosé et torturé qui m'avait tant obsédé.
Mon hypothèse qui voyait un Carrère aller de mieux en mieux et sortir de plus en plus de lui-même était donc balayée, et cela me réjouissait.
Carrère était de retour à ses démons.
Acheté dès sa sortie j'ai repoussé volontairement sa lecture, un livre sur la dépression n'étant probablement pas le récit idéal en cette période, avant finalement de m'y attaquer d'un bloc.
Un bloc inégal.
Par sa forme, l'objet déstabilise d'emblée.
Bâti en 5 grandes parties, par leur longueur déséquilibrées, elles-mêmes segmentées en de (trop) nombreux petits chapitres, Yoga est un livre disparate dans sa forme, un assemblage cafouilleux de parties sans liant.
C'est la patte même de Carrère que ces récits en poupées russes, que ces histoires qui se télescopent, que ces chocs de sujets a priori sans rapport qui, sous la plume de l'écrivain, et dans une lecture qu'il faut la plus dense et ramassée, font finalement sens. Unir le contradictoire, faire aller ensemble ce qui d'emblée ne semble pas pouvoir, c'est peut-être, au-delà du fait d'être un meilleur humain, le vrai objectif de l'écriture de Carrère. Et la quatrième de couverture de Yoga l'explicite :
C’est un livre sur le yoga et la dépression Sur la méditation et le
terrorisme Sur l'aspiration à l’unité et le trouble bipolaire Des
choses qui n’ont pas l’air d'aller ensemble. En réalité, si : elles
vont ensemble.
Et pourtant la forme, en segments courts et inégaux, saccadent un récit qui aurait pu avoir le pouvoir de rendre plus simple et plus explicite ce qui rassemble tous ces sujets qui ne vont apparemment pas ensemble. L'aspiration à l'unité recherchée est bousculée.
Dans une première partie qui tient, mine de rien, un tiers du texte, récit d'une retraite un peu hardcore de méditation qu'a suivie Carrère en janvier 2015, cette forme saccadée peut avoir un sens, la forme exprimant habilement le fond et rendant compte à merveille du fatras de pensées, de souvenirs et de réflexions, d'idées avortées et de poussées métaphysiques, de cette collision de vritti, de cette fluctuation informe de pensées, de ce chemin interne dans le crâne bouillonnant de l'écrivain.
Dans la suite du texte, cette forme perd de son intérêt et brise même l'écriture ample de Carrère. Ce qu'il nous raconte s'en retrouve découpé, en tranches inégales, inégales dans leur longueur et dans leur réussite. Certaines intéressent, d'autres moins. Chacun fera son propre choix.
Je peux dire pour ma part que Carrère a tout mon intérêt lorsqu'il raconte, par exemple, avec nostalgie un souvenir de vacances d'été en Bretagne avec ses enfants, et qu'il me perd un peu lorsqu'il s'évertue, par exemple encore, à détailler les différents mouvements de méditation.
Je dois donc avouer m'être poliment ennuyé dans cette première partie, tant ce que l'écrivain me raconte sur le yoga ne m'intéressait tout simplement pas.
Je remarque pour autant que Carrère parvient, par la seule force de sa fluide écriture, à m'entraîner dans ses pensées et à me promener dans son histoire du yoga et de la médiation, dont je n'ai pour être honnête que faire. La force de Carrère est donc celle-ci, de m'intéresser à ce qui ne m'intéresse pas. Mais il faut avouer que si j'ai dévoré cette première partie, c'est bien parce que je la savais première, et que le petit livre souriant et subtil sur le yoga qu'entreprenait d'écrire ici l'écrivain allait bientôt être renversé, annonce faite d'emblée, avec un sens du suspens toujours impressionnant (parvenir à raconter une histoire et à maintenir éveillée le lecteur là où il n'y pas précisément pas d'histoire et pas forcément grand chose pour maintenir éveiller le lecteur, rares sont ceux qui y parviennent aussi bien que lui).
La deuxième partie (passée la surprise de la perpétuation de cette écrire en sous-parties, qu'on pensait voir disparaître), rapidement expédiée, s'attarde sur les attentats survenus en 2015 dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo, et vécus à travers le regard de l'écrivain qui perdit lors de cet événement tragique celui qui aurait pu devenir un proche ami, si on leur en avait laissé le temps, l'économiste Bernard Maris. Comme toujours c'est indirectement, par celle qui fut sa compagne, amoureuse éperdue, lors de ses dernières années, que Carrère traite l'événement, avec une distance et une volonté permanente de déjouer l'émotion, de désactiver un suspense obscène qui n'aurait ici pas lieu d'être. Sa pudeur dans le récit de cet amour brisé est déchirante. Carrère est peut-être le meilleur lorsqu'il se fait le porte-voix de ceux qu'on n'entend pas, qu'il traite la grande Histoire par la petite, la minuscule, la personnelle, qui touche et parle bien plus.
La troisième partie, la plus aride, la plus dure.
Par des phrases arides, le lecteur est plongé assez abruptement dans une description impressionnante de la dépression à son état le plus violent, qui valut à Carrère quelques mois d'internement en hôpital psychiatrique. La langue froide des médecins et son vocabulaire propre permettent un pas de côté et une plongée un peu moins insoutenable dans l'horreur décrite. C'est peut-être dommage, tant ce qui faisait l'horreur et la folie du verbe de Carrère était précisément cette confrontation brute avec l'objet de l'horreur.
Mais ici l'objet de l'horreur ce n'est plus la folie d'un autre, ou une situation extérieure, mais l'écrivain lui-même, d'où ce compréhensible recul.
La quatrième partie raconte avec aisance et une certaine beauté placide, flegmatique, le séjour que l'auteur passa durant l'été 2016 sur l'île de Léros en Grèce, devenue camp de réfugiés à ciel ouvert, ses relations avec son interlocutrice Erica devenue amie, les autres bénévoles du camp et quatre jeunes garçons réfugiés, dont un en particulier. Ne sombrant pas dans ce que ce sujet peut avoir de risqué (des prises de positions explicitement politique, un ethnocentrisme déplacé, ...), Carrère trouve le juste équilibre entre récit de son séjour, de sa relation avec Erica, ses états d'âmes à ce moment-ci de sa vie, et les récits de l'expérience de l'immigration rapportés par ces jeunes garçons.
Carrère est un merveilleux conteur, une merveilleuse oreille, et donc un merveilleux (re)transcripteur.
La cinquième et dernière partie, intitulée Je continue à ne pas mourir, trouve le récit dans un état délabré et prend l'initiative d'essayer de recoller tous les morceaux pour en faire quelque chose de cohérent et conclure correctement.
Commencer et finir obsède Carrère. Comme il le dit lui-même, il lui est aisé d'inspirer, de prendre, de s'approprier, mais bien moins aisé d'expirer, de rendre, de donner.
Finir un livre c'est le donner à ceux qui le liront, ne plus pouvoir le toucher.
Pour ce Yoga, Carrère semble résister et ne pas parvenir à lâcher son texte. Cette dernière partie s'évade, à l'image du livre dans son ensemble, un peu dans tous les sens.
C'est parfois dans cette profusion d'information que le texte peut être le meilleur, tant il porte et incarne par cette profusion les traces d'une personnalité. C'est d'ailleurs dans cette dernière partie que Carrère écrit probablement les plus belles phrases de son livre dans un hommage poignant à son ami et éditeur de toujours Paul Otchakovsky-Laurens.
Des mots justes et habités qui émeuvent avec brio.
Dommage que Carrère ne sache pas terminer et peine à rendre sa copie, s'éternisant dans d'interminables sous-parties qui tentent de raconter en quelques mots déguisés ce qui a volontairement été mis en ellipse durant tout le récit (la fin de son histoire et sa séparation d'avec sa femme, grande absente de ce récit, tout comme l'amour en général), et penche même vers une fiction frôlant le ridicule dans une scène se déroulant dans un aéroport (je n'en dis pas plus).
Le constat de ce livre, une fois fait ce peut-être assommant commentaire partie par partie, est malheureusement celui d'un livre mosaïque qui, si chacun des carrés qui le constituent est une pépite aux couleurs éclatantes, rate à représenter quoique ce soit.
Un visage fait de beaux yeux, d'un beau nez, de belles lèvres, mais qui, assemblés ensemble ne produirait pas ce qu'on pourrait appeler un beau visage.
On peine à deviner derrière ces 400 pages un dessein, un projet, une idée. On sait pour Carrère l'écriture thérapeutique. Ses précédents livres, notamment Un Roman Russe, sans conteste mon favori, le faisaient sentir. Ecrire, pour Carrère, c'est savoir pourquoi on est vivant, c'est trouver sa place sur terre et permettre de s'améliorer en tant qu'humain.
Ecrire c'est sauver sa peau.
Pour autant, avec Yoga, Carrère semble ne parler qu'à lui-même, avec ce texte multi-face, dont le lecteur, une fois l'ouvrage fermé, ne saura que faire.
Que faire de cet atroce récit d'une expérience en hôpital psychiatrique ?
Que faire de ce témoignage très personnel sur la pratique du yoga ?
Que faire du récit d'un été sur l'île de Léros auprès d'enfants réfugiés ?
Que faire de Yoga ?
L'écriture dans cet ouvrage est trop soliloque, Yoga est un ouvrage qui se retourne sur lui-même sans cesse en oubliant l'intérêt que peut en avoir le lecteur. La façon dont Carrère le sursollicite, par des citations, des interrogations directes, un tutoiement, trahit peut-être ce sentiment que le livre, quoiqu'en pleine possession de son écrivain, délaisse celui à qui il le destine.
Une fois les pages toutes tournées jusqu'à la dernière, un goût âpre reste en bouche, et ce pendant plusieurs jours.
Un goût d'inachevé, un goût de molle émotion refoulée, là où les précédents textes de Carrère faisaient éclater notre émotion avec puissance ; effroi, terreur et dégoût face à l'horreur, joie d'être en vie face à la mort, empathie et tristesse profondes face à celle de l'autre.
A ce goût-là s'ajoute celui, problématique, de s'être fait flouer.
Passons sur le sentiment de déception. Il m'est propre et n'est pas un argument ; j'attends peut-être trop des œuvres d'artistes que j'aime et ne l'accorderai jamais le bénéfice de la surprise. On ne peut en effet pas être surpris face à une œuvre dont on attend tout ; lorsqu'elle nous donne tout, on appelle ça l'évidence. Lorsqu'elle ne nous donne pas tout, on est déçu. Il est donc plus facile de n'attendre rien ; on sera à tous les coups surpris.
Passons, donc.
S'être fait flouer.
Car pour la première fois, Emmanuel Carrère brise volontairement la frontière entre l'autobiographie, le récit journalistique, pour résumer, la vérité, et la fiction. Revenant, lors de certaines séquences à ses plaisirs premiers de romanciers, fan de science-fiction, Carrère n'est plus l'homme en qui l'on fait confiance, mais l'homme qui peut, par la seule force de ses mots, nous mener à penser vrai ce qui ne l'est pas et vice-versa.
Dans ces livres et articles précédents, Carrère passait un pacte tacite de vérité subjective avec son lecteur ; ce qu'il allait raconter serait vrai, uniquement vrai, mais vu par ses yeux, entendus par ses oreilles, retenu et probablement déformé par sa mémoire, et finalement couché sur papier avec ses mots et ses œillères.
Ici, le contrat n'est jamais explicitement énoncé, et on ne sait s'emblée plus ce qui tient du vrai, du fantasmé, de l'inventé, ou du mensonge pur et simple.
Je ne m'intéresse pas forcément à l'histoire entre Carrère et son ex-épouse, Hélène Devynck, qui dans une lettre ouverte a annoncé, entre autres choses que je me passerai de détailler ici car cela m'intéresse guère, que l'écrivain mentait dans son texte, utilisant pour la première fois depuis des dizaines d'années la fiction afin de concourir à la course au Goncourt 2020 (dont on sait les jurys peu portés sur les récits non-fictionnels) et enfin peut-être gagner le fameux prix (Carrère et le concours, c'est un peu DiCaprio et l'Oscar, sauf que ce-dernier l'a finalement eu).
Aussi inintéressante cette polémique soit-elle, tout de même, je dois bien avouer que les propos de Devynck (s'ils sont eux-mêmes vrais, on en est à ce niveau-là de paranoïa) m'intéressent en fait, parce qu'ils sèment le doute et disent quelque chose de la démarche globale de ce projet.
Si la fiction a bel et bien été utilisée dans ce récit, où l'a-t-elle été ?
Et ne l'a-t-elle été que dans l'objectif de remporter le précieux prix ?
Il semble alors problématique de lire le récit des deux mois que Carrère a passé sur l'île de Léros à s'occuper d'enfants immigrés, de lire le récit de leurs voyages et de leur enfance bousillée par les guerres, le fanatisme religieux et plus globalement la mort, de se prendre d'affection pour ce jeune Atiq dans lequel Carrère semble trouver un fils spirituel, sans penser que ce récit peut être faux, romancé, et que ce voyage pourrait avoir en fait duré quelques jours seulement, comme annoncé par Devynck, qui annonce d'ailleurs aussi avoir accompagné l'écrivain pendant une bonne partie.
Il semble alors problématique de lire cette mise en parallèle douteuse entre les tragédies humaines qu'incarnent ces jeunes enfants réfugiés et la dépression du bourgeois névrosé qu'est Carrère.
Sa volonté de fiction pousse donc Carrère à brouiller les pistes, à noyer sous des détails pluriels et vrais, technique bien connue, des récits plus ou moins fantasmés.
Et le pousse, dans la toute fin de son livre, à sombrer dans un élan imaginatif de mauvais goût qui pourrait un temps faire confondre Yoga avec un roman de gare, à l'eau de rose, pour ménagère esseulée.
Carrère a vieilli. Il l'admet, avec honnêteté, mais tout de même, cela se ressent durement. Si l'on admire toujours la plongée méta de ce récit sur sa propre fabrication, l'exquise lecture du récit en train de se faire, son humour n'est plus le même, parfois même suranné, moins fin. Son verbe est plus expéditif, moins alambiqué, plus direct, comme si on l'entendait parfois soupirer "et puis merde, je le dis".
Quiconque a déjà lu ses livres précédents, suit son actualité et ses articles journalistiques ne pourra que trouver dans Yoga de lourdes répétitions. Carrère se cite lui-même, rappelle des événements de sa vie, raconte, avec d'autres mots mais une même finalité, ce qu'il raconte déjà dans ses écrits antérieurs, et parvient même à se répéter dans ce-même ouvrage. C'est comme si son texte, déjà tout strié qu'il est, se prenait le luxe de se renvoyer à lui-même en ne cessant de nous interpeler pour nous faire nous souvenir de ce dont nous nous souvenons que trop bien.
Là encore le sentiment de Carrère d'écrire pour lui-même se fait ressentir ; en nous exhortant à nous rappeler, c'est comme si c'était lui-même qu'il exhortait à se rappeler.
Texte inégal et étrangement entortillé, Yoga est donc aussi un texte qui se répète et tente parfois vainement de cacher un vide que l'on devine malgré tout.
Carrère enchaîne les récits sans qu'ils aient de liens où qu'il cherche à en créer un, là où c'était pourtant son grand talent. Les récits sont à prendre pour ce qu'ils sont, descriptifs, froids, aussi fantasmés et enjolivés qu'ils puissent l'être.
Dans une reconquête perpétuelle de lui-même, Carrère réussit peut-être une recollection salvatrice, mais lasse dans un récit qui s'embourbe dans son apparence de compilation sonnant creux. Alors qu'il se faisait jusqu'alors l'auscultateur de ses névroses psychiques et en dressait, dans une écriture paranoïaque et profondément vertigineuse, la suite causale, Carrère se contente aujourd'hui du constat de leur existence, plus violentes peut-être qu'auparavant, dans un récit simplement chronologique, écrit dans une langue endolorie, comme anesthésiée par la douleur trop atroce.
Demeurent l'évidente puissance de son écriture et son talent de conteur, qui rendent la lecture, peut-être moins haletante, mais toujours aussi facile.