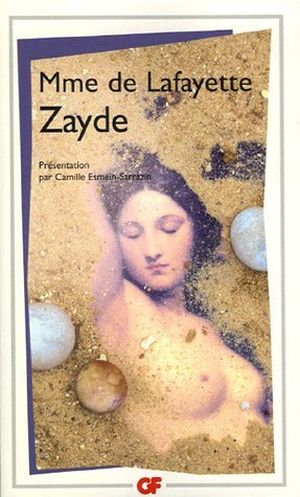Zaïde est un étrange animal hybride. Il relève manifestement du « roman courtois », littérature de cour par excellence de la France du XVIIe siècle. Ce n’est pas le moindre de ses charmes, d’autant qu’il est nettement plus facile à lire que les grands succès du genre (L’Astrée, avec ses quelques cinq mille pages, est vingt fois plus long). Le lecteur peut y découvrir cette littérature fossilisée, avec la fascination intriguée qu’il éprouverait dans un musée d’histoire naturelle.
La combinaison des dispositifs du roman précieux dans un genre à part est singulière. En revanche, chacune de ses composantes est familière au lecteur moderne. Il y a d’abord la multiplication des récits enchâssés, petits romans dans le roman. On pourrait y voir une préfiguration de la post-modernité littéraire à l’anglo-saxonne (en reprenant, dans un sens différent, la phrase de Lyotard selon laquelle on est post-moderne avant d’être moderne) — et sans doute y-a-t’il bien un air de famille sans cette littérature moins obsédée par la vraisemblance et plus ludique. Plus qu’à cette ressemblance savante, les « trucs » de Zaïde m’ont plutôt évoqué le cinéma et la télévision modernes : usage immodéré des analepses qui forment les homologues d’autant de flashbacks ; happy ending obligatoire après une série de rebondissements conventionnels.
Dans le même temps, Zaïde ouvre aussi la voie au roman moderne, dont Mme de Lafayette donnera une illustration fondatrice par son brillant La Princesse de Clèves. D’ailleurs, derrière la touchante concorde amoureuse qui conclut le roman, pointe aussi de nombreuses marques de pessimisme. La plus frappante est sans doute celle qui marque la première rencontre entre Consalve et Zaïde, commentée par l’auteure d’un lapidaire : « […] le voilà abandonné à la réflexion de ses malheurs, où il ne trouvait d’autre consolation que de croire qu’il ne pouvait plus lui en arriver, mais la fortune lui fit voir qu’elle en trouve jusque dans les déserts. » (dans le même sens, plus près de la fin, elle note : « Il est vrai aussi que l’amour est si dangereux à voir qu’il ne laisse pas d'enflammer, lors même qu'il ne s’adresse pas à nous »). En bref, la rencontre de la femme aimée, parce qu’elle apporte la passion, est un malheur en soi ! Pensons encore, au sort que fait Mme de Lafayette à d’autres gloires terrestres dans son beau récit du passé de Consalve. Il y a là à la fois quelque chose de l’humeur racinienne, contemporaine, et du roman psychologique.
Au-delà de ce bel assemblage en forme de marqueterie Boulle, ce qui est surtout radieux dans Zaïde, c’est la beauté de la langue. Je cite pour le plaisir une phrase exquise parmi d’autres, pour son air pré-proustien : « Il est vrai aussi que, dans le temps qu’il songeait à plaire, le désir de se faire aimer lui donnait une sorte d’ardeur qu'on pouvait prendre pour de la passion, mais sitôt qu’il était aimé, comme il n’avait plus rien à désirer et qu’il n’était pas assez amoureux pour trouver du plaisir dans l’amour seul, séparé des difficultés et les mystères, il ne songeait qu’à rompre avec celle qu’il avait aimée et à se faire aimer d’une autre. »