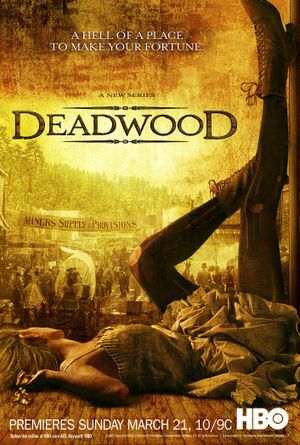Pure produit de l’écurie HBO, Deadwood ressemble par moment à un Sur écoute au pays des cowboys. On y retrouve avec délice cette exigence dans l’écriture qui irrigue les productions de la chaîne américaine, mais aussi son style visuel particulièrement minimaliste, pour ne pas dire un peu chiant. En effet, Deadwood réinvente le western en un huis presque clos, offrant pour théâtre des opérations, une rue bondée, une quincaillerie, deux bars et un paquet de nichons.
Mais la série vaut surtout pour sa galerie de personnages pittoresques, auxquels on s’attache rapidement, au milieu desquels trône Al Swearengen, incarné par un Ian McShane en état de grâce. Le proxénète dégoupille à tout moment, explose à chaque scène, il éructe, organise, égorge à tire-larigot dans un ballet démoniaque qui offre à la série quelques moments de folie pure.
Hélas, tout au long de ces trois saisons, il faudra aussi composer avec de multiples récits qui se chevauchent, s’entrecoupent, parfois jusqu’à l’écœurement. Les différents arcs ne sont pas toujours d’une qualité égale, et David Milch pèche parfois par excès de zèle. Le créateur de la série apporte autant son perfectionnisme et son exigence qu’il étouffe son récit par sa volonté de tout y mettre, quitte à oublier de hiérarchiser ou élaguer un peu. On peut ainsi régulièrement se perdre dans les méandres des complots des uns et des autres, entrecoupés par une amitié incongrue, une romance inattendue ou une rivalité impromptue.
S’arrêter à ce joli bordel narratif serait néanmoins un peu triste tant la série regorge de moments exquis, de héros magnifiques, drôles, émouvants, qu’on déteste aimer ou qu’on adore détester. Il s’en dégage un cœur immense, celui que David Milch a mis à l’ouvrage pour donner vie à cette ville, Deadwood. On ne peut que regretter l’arrêt prématuré de la série, privée d’une véritable conclusion, nous laissant un peu hagard, orphelin d’un monde fascinant qu’on aurait volontiers continués à contempler.