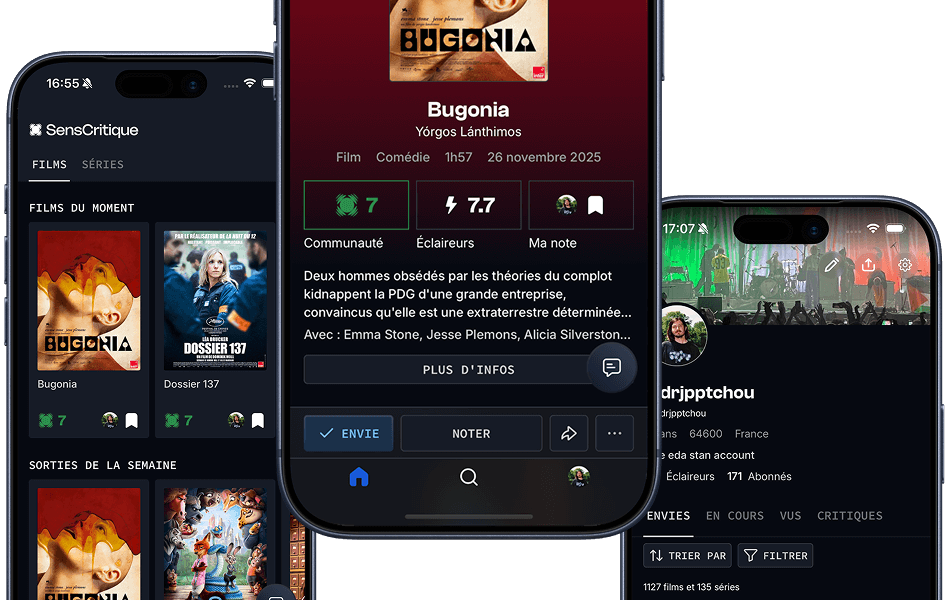Voici clairement une bande-dessinée que j’ai lue parce que la couverture m’a interpellé.
Ça pourra peut-être paraître bête à certaines ou à certains de ne construire sa curiosité que sur une seule couverture, mais d’un autre côté je trouve que ce genre de premier contact avec l’œuvre peut être riche d’enseignements.
On ne réussit pas une couverture par hasard. Si une couverture interpelle c’est qu’elle est parvenue à dire quelque-chose au travers de cette seule convention. Or ce que m’a dit cette couverture de ces Pizzlys c’était que son auteur savait particulièrement bien jouer de sa palette de couleur.
Ce rose bien appuyé et qui est malgré tout atténué par le noir et le turquoise environnants : c’est saisissant sans être agressif ; tranché sans manquer de subtilité… Et au milieu de tout cela trois silhouettes en train de voler, comme des plumes portées par un courant.
D’un côté l’apaisement de l’aurore boréale, de l’autre l’intrigue suscitée par ces silhouettes…
Ah ça ! Il n’y a pas à dire mais ça a été une vraie réussite sur moi ce type de composition. Autant vous dire que sitôt cette bande-dessinée avait été mise dans mon champ de vision que ça m’a clairement donné envie de l’ouvrir et de découvrir ce que l’auteur avait à y dire…
Me concernant il s’agissait là de ma première prise de contact avec l’œuvre de Jérémie Moreau ; un auteur dont j’avais déjà entendu le nom mais sans jamais parvenir à y associer quoi que ce soit jusqu’à présent.
Ces Pizzlys se sont donc avérés être – avec l’intrigue suscitée par la couverture – doublement source de curiosité et…
…Je dois avouer que j’ai très vite été décontenancé.
Premier choc : ce parti pris visuel.
Alors, en même temps, à quoi s’attendre d’autre de la part d’une bande-dessinée qui a su séduire par la singularité de sa couverture… Mais tout de même…
Le dessin est assez dépouillé. La ligne est fine, claire et régulière, comme s’il s’agissait d’un dessin au stylo. Les personnages ne sont caractérisés que par quelques traits. Peu de relief par les couleurs. Beaucoup d’aplats. On ne peut pas ignorer… ça.
De là nait tout de suite une certaine déstabilisation me concernant. Dans le principe j’aime quand une œuvre dispose d’une personnalité esthétique qui lui est propre et – pour sûr – ces Pizzlys en ont…
…Seulement, je ne peux m’empêcher, en contrepartie, de toujours questionner la pertinence de ce genre de geste. C’est si marqué qu’on ne peut l’ignorer. Si marqué qu’on ne peut lire l’intrigue sans être interpellé en permanence par ce choix singulier ; au point que ça puisse en devenir contreproductif.
Là, en ce qui concerne ces Pizzlys, on commence aux côtés de Nathan, jeune conducteur Uber, qui enchaine les courses jusqu’à très tard la nuit afin – comprend-on rapidement – de subsister.
La ville est très dépouillée et terne. Impersonnelle.
Au sein de l’habitacle seuls les mains et les visages ressortent de par ce choix d’aplats de couleurs tranchées. Des visages vides. Des poupées lisses et sans vie. Une dynamique visuelle que l’agencement des cases rend assez monocorde, plate et figée.
D’un côté je me dis que c’est signifiant au regard de ce que semble vouloir poser cette B.D. : la vie parisienne qui déshumanise ; le monde moderne qui désincarne ; les routines du quotidien qui vident les êtres de leur substance…
…Et puis de l’autre je me dis à chaque page tournée que quelque-chose ne marche pas.
Ça ne marche pas parce que ce choix visuel m’empêche de m’imprégner des personnages. Ils sont lisses. Ils sont des stéréotypes. Je ne les incarne pas. Je ne m’émeus pas pour eux. Je ne m’interroge pas non plus.
Ça ne marche pas parce que même lorsque ces personnages quittent ce monde parisien ils restent toujours aussi lisses et plats. Jamais ne prennent-ils de relief ou de nuance. Le parti-pris visuel reste figé, sans dynamique.
Et puis tout ça ne marche tout simplement pas parce que, tout du long de la B.D., j’ai perçu ce parti-pris visuel comme une composante venant se juxtaposer à tous les autres mais sans parvenir à s’y additionner pour faire corps.
Pour moi, si cette B.D. avait été en noir et blanc ou en couleur sépia, ça aurait été pratiquement pareil en termes de ressenti. En tout cas ça ne m’aurait pas fait ressentir le parcours initiatique de ces personnages autrement.
Donc, clairement non, me concernant, ce parti-pris graphique, c’est vraiment un semi-échec…
…« Semi-échec » mais pas « échec total » non plus.
Pourquoi ? Parce qu’on sent que Moreau a réfléchi au choix de ses couleurs et à la composition globale de ses toiles. Les rendus sont toujours saisissants. Certaines pages sont d’ailleurs de très belles audaces visuelles ; parfois des paysages aux traits délicats et aux aplats harmonieux, d’autres fois l’ouvrage se risque à des compositions plus complexes et abstraites. Il s’agit là d’ailleurs pour moi des aspects les plus réussis de cet ouvrage. Ils contribuent à donner à cette B.D. une indéniable identité ; identité qui pourra d’ailleurs séduire en raison de son
esthétique racée…
Néanmoins ces qualités, bien que remarquables, n’ont au final que très peu impacté mon ressenti global de l’œuvre ; et ce ressenti c’est celui d’avoir parcouru une B.D. lisse dont je ne retire finalement pas grand-chose.
En fait le vrai problème tient à une forme de dissonance – et j’oserais presque dire d’ incohérence – entre la narration visuelle et la narration textuelle de l’œuvre.
Alors que l’esthétique se veut atypique et interpellant, le scénario s’illustre quant-à-lui par sa platitude et sa convenance.
La vie en ville c’est pas une vie… Les petits-boulots c’est quand-même chaud… Le monde capitaliste, quand-même, ça fait pas de cadeau… Les gamins, d’nos jours, ils ne savent que rester sur leurs consoles et leurs téléphones et ne profitent plus des bonnes choses… Ah ça non : rien de tel qu’un retour à la vie sauvage pour se reconnecter à la nature, pour retrouver son moi profond, pour rouvrir ses chakras et ouvrir les yeux sur la folie des hommes…
Mouaif…
Dans le fond, pourquoi pas, mais là, dit comme ça, ça coche quand même toutes les cases de la complainte du bobo parisien et de toutes ses lubies à base de ressourcement et de développement personnel.
Jamais l’écriture ne parvient à contourner les gros clichés du genre. Non seulement elle met bien les pieds dedans mais en plus elle insiste bien fort dessus ; verbalisant et illustrant les choses de manière bien démonstrative au cas où si on n’avait pas compris…
Même cette symbolique du « Pizzly » – que Moreau pose comme un étendard de son œuvre en le choisissant pour titre – est lui-même expliqué, décortiqué, rabâché… Ce qui dénote quand même fortement sitôt considère-t-on cette philosophie de l’épure affichée par la démarche esthétique d »ensemble.
En fait les rares fois où cette B.D. m’a semblé parvenir à raconter quelque-chose d’un brin original et évocateur, bah ça a été quand elle s’est tue.
Ces quelques instants de flottaison de Nathan, ces paysages naturels interpellant, ces formes géométriques et compositions abstraites, ce sont finalement les seuls et rares moments qui – à mes yeux – ont su véhiculer cette idée de nécessaire reconnexion à la nature et au vivant, pour ne pas dire à une certaine mystique qui nous échappe…
…Un peu comme ce que suggérait la couverture en somme.
Comme quoi…
D’ailleurs c’est en refermant l’ouvrage – et en retombant sur ce mariage audacieux de couleurs de la quatrième de couverture – que j’ai fini par acter ce qui me semblait être les quelques enseignements à tirer de ces Pizzlys.
Oui, il semble manifeste que Jérémie Moreau soit un grand bédéiste ; et sa manière de composer certaines pages de cet album me le prouve amplement…
…Mais non, ces Pizzlys ne sont certainement pas l’œuvre à travers laquelle ce talent semble s’exprimer au mieux.
Car en fin de compte, de tout cet ouvrage, depuis le départ c’est la couverture qui a tout dit. Elle a dit où se trouvait la force de Jérémie Moreau et ce vers quoi il devait creuser.
A lui donc de poursuivre son chemin sur cette voie-là, ou à moi de remonter sa trace pour voir si son œuvre maîtresse existe déjà… ;-)