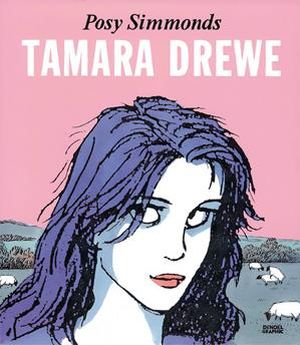J'ai hurlé, intérieurement, pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits de ma mémoire visuelle, ce que je pensais de toi, Posy, au point de me taper Gemma Bovery, histoire d'être bien sûr, de bien tremper dedans. Et je me suis calmé, j'ai pensé à autre chose. Et là, j'ai un peu de temps pour écrire sur SC, et la première chose qui me revient c'est tout ce mal que j'ai ruminé à propos de Tamara Drewe.
Depuis que j'ai lu la première tentative narrative de Simmonds, Tamara Drewe est encore descendu dans mon estime (mais je me rends compte que je n'ai pas encore baissé la note!), puisque tout ce que le livre contient d'ingénieux s'y trouve déjà. Même les visages des personnages y sont, j'imagine que c'est ce qu'on appelle faire œuvre. Et là est le problème: mademoiselle Posy Simmonds fait dans le prétentieux. Si j'étais Guyness, je dirais que j'ai rarement vu pose si immonde; mais le calembour dépasserait ma pensée, et la faute n'en incombe pas seulement à l'auteur. La presse, sans doute unanime, couronne cette suite de clichés ridicules du nom de "roman graphique", comme on rend fréquentable le clochard en l'affublant d'un chapeau ou d'un sigle. On peut lire l'histoire de la bande dessinée comme une conquête de la longueur: du dessin d'humour au strip, du strip à la planche A5 puis A4, à l'album, à la série, au one-shot de longueur variable. Soit. Je ne crois pas pour autant que le medium change de nature: on tente toujours de représenter le mouvement entre les cases, on hésite toujours entre la peinture et le récit, enfin vous connaissez tout ça. Le graphic novel est sensé faire "exploser les codes", preuve s'il en est que les codes n'existent que pour les incultes de l'art dont il est question. C'est toujours de la bande dessinée, qu'on enlève les cases, qu'on parle de guerre et d'inceste, qu'on enlève les bulles, qu'on raconte sa vie et non celle de Tintin. Parlons de forme innovante, comme, justement, on parle de la forme d'un roman: quand ça dit quelque chose sur le propos. Revenons donc à ce que dit la forme sur le propos de Tamara Drewe: les planches alternent cases classiques et dessins plus travaillés entourés de textes. Rien à dire sur les cases, mais vraiment rien, on dirait des croquis préparatoires de cinéma, plan large, plan rapproché, plan américain, rien d'autre, et surtout rien d'inattendu. Les planches narratives, celles qui doivent paraître follement innovantes au point d'exploser des codes, reprennent une forme qui porte un nom: ça s'appelle des albums, et j'en lis plein à mon fils, qui toutefois voit bien le progrès quand on s'attaque au Secret de la licorne. Il existe des albums formidables, où l'équilibre entre le texte et l'image permet des trésors de non-dits à décrypter; pas ici: rien de mieux que les illustrations des romans du XIX°sc., et sans la différence de regard entre l'auteur et le graveur.
Ce que disent les passages "album" est consternant: on se partage entre la femme trompée ("Quel magnifique portrait de femme bafouée qui sait garder sa dignité!"), l'universitaire frustré ("Belle mise en abîme!") et Tamara ("Quelle vérité dans la peinture des sentiments de toute une génération!"). Chacune de ces psychologies est battue et rebattue (par la littérature, par le cinéma, par les conversations avec ma grand-mère); on entame donc chacune des pages qui ralentissent la lecture avec l'espoir, toujours déçu, que cela en vaudra la peine. C'est de l'eau claire, à chaque fois. Par comparaison, les dessins prennent force de conviction, peut-être était-ce là l'effet recherché: déconsidérer les pensées des personnages pour laisser la champ libre au dessin pur: "Quel post-modernisme!" Peut-être que ça marcherait chez Moebius, je ne sais pas.
Revenons à Tamara, car j'ai parlé de la peinture de ses sentiments. J'ai découvert grâce à ce personnage, puis quelques lectures ultérieures, qu'il existait un courant de la bande dessinée qui s'abreuve à la psychologie des magazines féminins. Avec ironie bien sûr! Mais cela ne change rien: Tamara suit une sorte d'équivalent de la cristallisation de Stendhal qu'on aurait écrit à force de relire toujours les mêmes articles sur "je l'aime mais il n'est pas fait pour moi" "je voudrais mener une vie plus saine" "Comment devenir moins superficielle". La fascination qu'exerce le personnage sur les écrivains à la campagne, bien que sentant le procédé faisandé, pique un peu; puis chaque percée dans le mystère rend la femme au short moulé plus fadasse. On joue avec nos fantasmes de la femme fatale, quelle intelligence!
Le pire de tout, c'est la fin. Le drame qu'on voit trente pages à l'avance survient avec un sécheresse assez réussie; puis les trois personnages féminins se retrouvent dans une cuisine, et là c'est abominable. Mademoiselle Posy Simmonds, croyez-vous vraiment que la solidarité des femmes les sauvera de l'inconséquence des hommes? Ou est-ce là encore une ironie mordante dirigée contre un des plus défécatoires clichés sexistes, celui de la douceur féminine formant le liant réel derrière la scène occupée par les combats de bites? Les hommes paradent et parlent haut, mais nous, les femmes raccommodons le tissu social en préparant une bonne choucroute/un bon couscous/de bonnes lasagnes qui calmera tout le monde, et on fera tous la ronde, et tout ça? En tout cas, tout le monde est heureux à la fin: ça fait un enfant (que le père porte, bien entendu), ça garde sa dignité, ça publie un livre à succès, ça se promène dans le Dorset éternel. Et moi je me mets à me mordre la main pour éviter de lancer le livre à travers la pièce puisqu'il venait de la médiathèque, je pince mes lèvres afin de garder pour moi mes imprécations contre le graphic novel et le faux féminisme.
Je sauve les deux adolescentes, qui m'ont permis d'avaler tout ça jusqu'au bout.