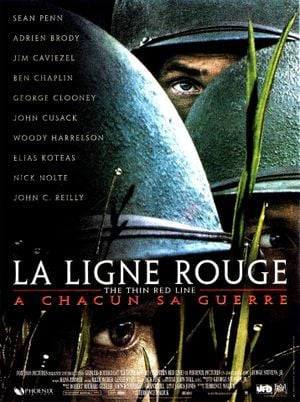Longtemps on a pu craindre que le nom de Terrence Malick ne serve qu’à épaissir les pages des dictionnaires de cinéma. À son entrée on aurait ainsi pu lire : réalisateur américain, né en 1943 à Ottawa, Illinois (ou bien à Waco, Texas… mystère). Auteur de La Balade Sauvage en 1973, l’un des premiers films les plus impressionnants depuis Citizen Kane. Crée la sensation en 1979 au Festival de Cannes, où son second opus, Les Moissons du Ciel, remporte le Prix de la Mise en scène. Pendant vingt ans, période au cours de laquelle il a notamment traduit Heidegger et étudié le bouddhisme, il s’est tenu éloigné des plateaux et d’Hollywood. Mais le silence de sa vie n’a pas altéré le tumulte de son œuvre. Son troisième long-métrage est l’adaptation d’un roman de James Jones consacré à la très stratégique bataille de Guadalcanal, en 1942, épisode crucial de la guerre du Pacifique. Six mois de combats, parfois au corps-à-corps, entre les boys et les Japs. Une violence programmée, obligatoire et dérisoire — il s’agit de conquérir une colline, une simple et belle petite colline — qui massacre le paysage immaculé d’une des îles Salomon. Malick s’inscrit dans une grande tradition qui court d’Emerson à Thoreau et Whitman, elle-même issue d’un faisceau d’influences diverses comme le néoplatonisme et la pensée religieuse orientale. Les herbes aux flux et reflux seyant sous la brise de mer quand grimpent les marines à l’assaut d’un fortin poudreux tenu par les fils du Soleil-Levant, les "humides étincelles" à la pointe de la moindre palmette, l’oisillon battant de l’aile et blessé à mort, surpris par le plomb et le feu, la boue terre de Sienne étoilée de l’écarlate du sang, l’apparition de la lune vague qui instaure le répit de l’ombre à l’heure "magique" composent des images foudroyantes comme autant de trésors, et sondent la profondeur de son âme de géant. Devant sa caméra, le paradis mélanésien affiche les contours mythologiques de l’Ancien Testament. La Ligne Rouge commence par la perte d’un éden tropical et s’achève sur un duel fratricide : le soldat américain tue son frère japonais sans que l’on puisse jamais distinguer lequel serait Abel et lequel serait Caïn. Les fantassins de la Compagnie C sont engagés dans un conflit immémorial, une guerre de Troie moderne. Ainsi, pour mieux le préparer à la nature du combat qu’il va mener, le colonel Tall demande au capitaine Staros s’il a lu Homère dans le texte, et la coiffure arborescente de Sean Penn rappelle davantage celle d’Achille que celle d’un G.I.
https://zupimages.net/up/18/05/1aov.jpg
L’épopée débute à l’ombre des cocotiers, dans un village où se prélassent deux soldats en fuite. Les autochtones souriants et insouciants, leurs occupations quotidiennes désintéressées de tout souci matériel, les chants séraphiques auxquels ils s’adonnent en groupe, tout participe d’un éblouissement solaire digne de Tabou. Le jeune Witt ne voit dans cette imagerie idyllique que gentillesse, fraternité, amour et innocence. Pourtant, lorsqu'il retournera au hameau après la bataille, les crânes s’exposeront sur les étagères des huttes, d’ineffaçables cicatrices blanches marqueront les peaux noires, et les hommes autrefois pacifiques se querelleront pour des peccadilles, comme contaminés par la progression du mal. C’est la subjectivité du déserteur qui construit le réel tel qu’il le perçoit. Mais soudain un patrouilleur de l'armée américaine surgit à quelques encablures de la plage, et voilà deux mondes qui se télescopent : celui de la civilisation moderne, destructrice et abusant des richesses de la nature, et celui des indigènes qui vivent en communion avec leur environnement. La même impression saisit le spectateur quand, plus tard, une cohorte de soldats armés jusqu’aux dents croise un vieil aborigène qui ne semble pas les voir, promeneur solitaire traversant indifférent ce qui deviendra bientôt un champ de désastre et de mort. Comme chez Michael Cimino, la violence des actions et des passions humaines s'inscrit dans un cadre naturel métaphorique : immensité silencieuse, magnificence d’une terre nourricière ravagée par ceux qui prétendent en prendre possession. Les échos bibliques à la Genèse et à l'Apocalypse sont omniprésents dans La Ligne Rouge. Avant le tournage, l’auteur avait d’ailleurs travaillé à un scénario sur la création du monde, vaste entreprise que The Tree of Life concrétisera quelque treize années plus tard.
On compare souvent le cinéma de Malick à celui de Murnau, le transcendantalisme du premier rejoignant le romantisme germanique du second. Les deux artistes témoignent d’un même rapport symbolique à la géographie, qui se dissout dans la sorcellerie d’épiphanies mystérieuses. Cette contre-plongée qui transforme les mâtures en une monstrueuse toile d’araignée déchirant un ciel blanc, cette main qui grouille d’insectes comme la brèche du cercueil pullulait de rats, semblent reprises de Nosferatu. Le cinéaste aborde le thème de la guerre en minimaliste ; pour lui, montrer les corps mutilés, insister sur la barbarie des combats ne présente aucun intérêt. La découverte des deux cadavres dans un champ s'impose dès lors comme une image-synthèse, une "icône" suffisant à témoigner de toutes les visions atroces inhérentes à un conflit. Le film exprime l'identité fondamentale entre le drame métaphysique qui se joue dans la permanence et celui vécu sur le plan de l'histoire. Contrairement à la jungle d'Apocalypse Now, hors-champ éminemment hostile renfermant toujours le danger, la nature est ici montrée comme un jardin polynésien où tout est objet d’émerveillement. Les prairies qui flottent et ondulent sous la caresse du vent, les couronnes des arbres baignées d’une lumière de cristal, le carnaval des animaux et des oiseaux multicolores perpétuent un cycle immuable. Pour le cinéaste il existe une immanence supérieure, à la fois perfection esthétique et éthique, immédiatement accessible à chaque faculté. Malick décline toutes les manifestations de la vie organique, comme autant de stances d’une prière obstinée. Sans accéléré ni ralenti, par la seule multiplication des images, son cinéma rejoint ce panthéisme moniste qui relève de la quintessence : tous les êtres sont égaux dans la grande valse des mondes qui tournent. Mais au champ cosmogonique s'oppose le sombre élan de la dévastation. Rarement l’angoisse de l’homme en guerre aura été exprimée avec une telle force : l’insoutenable attente avant l’attaque, la terreur hébétée au milieu du chaos, les propos incohérents tenus en état de choc (McCron), la langue maternelle qui réémerge dans les moments d’extrême tension (Staros marmonnant quelques mots en grec). Ainsi la caméra saisit-elle à la loupe les comportements irrationnels des soldats : l’un effleure avec curiosité la tige d’une fleur minimale qui se recroqueville sous ses doigts ; d’autres oublient les balles qui fusent pour débusquer un serpent exotique. Lorsqu’ils tombent, un étrange phénomène de perception pure se produit, le sentiment que le sol les mange, que la flore les avale sous le regard de la faune locale. La terre a donné, la terre reprend.
https://zupimages.net/up/18/05/xoyl.jpg
La polyphonie qui s'installe, aussi bien par le recours aux voix off (comme détachées des corps et du temps, extraites du monde pour en entonner le chant possédé) que par la variété des personnages sur lesquels le film se construit, propose une sorte de débat des points de vue sur la signification et la finalité des choses. Le mystique, l’idéaliste, le réaliste, l’humaniste se concurrencent tout autant qu'ils se complètent. Malick donne à entendre une chorale disloquée de méditations intérieures qui tendent à tisser une toile de fond, à ne former plus qu'une seule voix. L’itinéraire se vide du sens du devenir : il apparaît, disparaît, resurgit et stagne. Les eaux de la mer, l'île de Guadalcanal, le promontoire qu'il faut prendre d'assaut sont autant de lieux matriciels et initiatiques où s'accomplit le destin de chacun. Élaborant par ce relais d'intonations diverses un véritable opéra de la conscience, le cinéaste impose l'idée que la guerre n'est pas l'affaire d'individus mais d'un corps commun. D'où l'entorse faite à la tradition qui sied au genre : il prend le soin de ne pas caractériser les différents protagonistes, refuse de les doter des attributs permettant habituellement de définir au sein de la patrouille une tête brûlée, un lâche ou un éventuel philosophe. Il invite aussi à la confrontation des essences constitutives de l'homme : l'intellect (Tall), la sensibilité (Staros), l'imagination (Witt) ou bien encore l'instinct (Welsh). Si un conflit existe bel et bien entre les individualités, celles-ci font corps les unes avec les autres. À peine esquissés, les "héros" de La Ligne Rouge sont des êtres morcelés, mais ils existent suffisamment dans leur "anonymat" pour contribuer à faire naître l’impression que chacun d’entre eux est toujours un peu de l'autre. Ce que croit au demeurant le deuxième classe Witt, qui considère qu'il n'existe qu'une seule âme dont chacun de nous est une parcelle.
Cette dernière constatation semble valoir également pour la représentation progressive de l’antagoniste : menace invisible qui se cache dans un premier temps pour piéger sa proie, l'adversaire japonais apparaît peu à peu aux yeux du G.I. comme son propre reflet, son véritable égal. Défenseur ardent de ses lignes et de ses positions, il s’avère, lorsqu’il est capturé, aussi inoffensif que le crocodile chassé et ficelé dans le marais pour être ramené au bivouac. Le private guette et traque l'adversaire ; l'ennemi se dissimule en sous-sol. À mesure que le "chasseur" évolue discrètement parmi les prairies verdoyantes que tamise la course d’un soleil radieux, il se rapproche de celui qu'il va vraisemblablement abattre en même temps qu'il s'éloigne de lui-même. Car tuer son prochain, c'est aussi perdre un peu plus de sa propre humanité. Une fois maîtrisé, l'ennemi détenu dans la fosse de son blockhaus affiche sa vraie nature, celle d'un individu pathétique dans la défaite et terrifié à l'idée du sort qui l'attend. Des réactions qui renvoient aux tourments de l'autre camp : la peine et le moral ébranlé du sergent McCron par la perte de ses hommes, la peur mêlée à la détresse du pieux Staros, priant à la lueur des bougies avant de lancer l'offensive impossible. Même sentiment, même attitude, même action... Bien que la jeune recrue faisant office d'arracheur de dents dans le village refuse de comprendre le soldat asiatique qui lui parle et tente d'accuser la différence qui le sépare de son prisonnier en jouant l’indifférence, il ne peut qu’être pris de remords après avoir pesé de sa main le petit sachet renfermant le "souvenir", la maigre trace de cet homme qu'il considérait uniquement comme son rival. Sous une pluie torrentielle, il comprend que sa guerre est inutile, comme toutes les autres, puisqu’elle ne conduit finalement qu’à se combattre lui-même.
https://zupimages.net/up/18/05/znpw.jpg
Ce constat se lit aussi, inéluctablement, chez les officiers chargés des manœuvres tactiques. Nulle gloire dans cette guerre mélancolique où les combattants semblent charger les larmes aux yeux, entraînés malgré eux, convulsifs et schizophrènes. Homme de loi dans la vie civile, Staros est le premier à refuser de faire tuer inutilement ses hommes, conscient de l’absurdité des ordres reçus et de la mission à exécuter. Le capitaine Gaff, face aux congratulations de son supérieur qui le félicite pour sa bravoure, reste impassible, et par deux fois la promesse de se voir remettre une décoration est reçue comme une obscénité. Tall, quant à lui, apparaît en victime de la machine militaire, tel un maillon asservi à la logique du conflit et de la hiérarchie : programmé pour une guerre qu’il aura passé sa vie à attendre, il est un mort-vivant irrémédiablement perdu parmi tant d'autres, consumé à petit feu et dévoré par ses faiblesses. Malgré la victoire, il laisse transparaître son désarroi face au gâchis quand il se retrouve en silence et en paix, seul, assis avec une expression hagarde et lointaine. L’étincelle sincère et pure qui éclaire tous ces regards est indissociable de la question de la mort, dans un contexte de guerre où celle-ci est l'ombre apprivoisée et familière qui plane constamment sur le soldat. Qu’elle prenne le nom de Destin ou de pur Hasard, elle frappe sans répit, implacablement. Lorsque Keck, piégé par sa propre grenade dégoupillée, sent la vie le quitter peu à peu, il éprouve concrètement sa propre précarité, ce que McCron mesure à son tour en affirmant que l'Homme n'est qu'une poignée de boue laissée au bon vouloir du vent. Bien que lourdement affecté psychologiquement, ce dernier va jusqu'à défier l'ennemi debout et les bras en croix : un geste révélateur de l’affliction de celui qui prend paradoxalement conscience du chemin par lequel il court à sa perte. La guerre tourne à plusieurs vitesses et se tire aussi à pile ou face, entre folie et courage au paroxysme de l’affrontement. L’héroïsme, ce n’est que ça, une perte de connaissance, un instant d’abandon au même titre que la démence.
Plus largement encore, la confrontation qui s’articule est celle de l'individu, de la nation et de l'humanité. L'espace intérieur du soldat est le lieu d'un affrontement entre ces principes dans une recherche de reconquête de l'unité perdue. La voix off joue sur ce point un rôle déterminant, qui s'oppose et se construit à partir de la réalité du combat et renvoie l'image blakienne du mariage du ciel et de l'enfer. Mais que ce soit celle du monde ou celle du cœur, l'innocence est toujours perdue, et c’est pourquoi le mode du souvenir est régulièrement convoqué. La pureté peut revêtir le visage de l’Amour dans les scènes d’un temps désormais révolu et suspendu (l’insert sur l’horloge) entre le soldat Bell et sa douce épouse, souvent associée aux éléments naturels tels que l’eau (elle s’immerge dans l’immensité de la mer à la tombée de la nuit) ou l’air (qu’elle fend sur une balançoire, dans un extraordinaire plan renversé rappelant celui d’Une Partie de Campagne). Bell ne vit sur le front que pour sa femme restée au pays, ce qui rend d’autant plus cruelle la séquence terrible de fatalité ordinaire où, dans une lettre, elle lui apprend qu’elle le quitte et le supplie de l’oublier. Chacun se préserve comme il peut, personne n'est épargné par le désespoir. Où chercher la force de vivre ? La réalité est une épreuve, consistant à retrouver le sens du message sous l'expérience de la destruction. Cette morale, qui se réclame du christianisme, se rapproche surtout de l'hérésie gnostique. Si l’homme est déchu, prisonnier de ses sens, de l'espace et du temps, c'est que la chute ne fut autre que la Création : la première image du film est celle d’un alligator qui s’immerge lentement dans une rivière marécageuse. En montrant que la réponse ne peut être que personnelle, que chacun trouve en soi les raisons de sa subsistance, le film reflète les contradictions et les tâtonnements intimes pour atteindre des certitudes qui se dérobent sans cesse. Le temps de vivre, le temps de mourir.
https://zupimages.net/up/18/05/dkwz.jpg
Cette quête spirituelle est tout particulièrement figurée par Witt, qu’habite la conviction que derrière chaque trépas se trouve une fenêtre ouvrant sur l’éternité. Parti à la recherche d’un paradis perdu, l’utopique soldat est affecté après sa désertion au service d’infirmerie : il assiste les agonisants dans leurs derniers instants, obnubilé par ce passage où l’âme quitte le corps pour s’élever vers l’illumination absolue. Dans sa cellule déjà, il passait son temps à griller des allumettes, les regardant brûler jusqu’à ce que la flamme s’éteigne. Witt se nourrit de la soif d’entrevoir au-delà du reste corporel constitué par le souffle calciné. Son obsession trouve peut-être son aboutissement dans le sacrifice. Parti en éclaireur, il est pris en embuscade sur les abords d’une rivière par un bataillon de soldats japonais qui surgissent tels des esprits de la végétation. Witt accepte de mourir pour sauver ses compagnons d’armes, et accède ainsi à la Vérité suprême. En cette ultime vision, durant laquelle il évolue dans les fonds paradisiaques du lagon en compagnie d’enfants angelots et de lamantins, il semble que sa patience, sa croyance et sa foi en une autre existence aient été récompensées : les ondes turquoises renvoient à l’élément fœtal, à une deuxième naissance plus lumineuse. Et le réalisateur de consacrer dans cet épilogue l’alchimie envoûtante et le lyrisme diluvien de son expression. C'est une des forces du cinéma que de rendre confuses les catégories et d'opposer à l'aveugle raison empirique une pensée ouverte dont son syncrétisme est l’exemple moderne le plus fulgurant. Malick se situe du côté des visionnaires, donc des marginaux dans un monde devenu l'esclave de la mesquinerie du réel et de la nécessité. Rarement un cinéaste aura donné, par delà l’aspect tourmenté de son inspiration, un tel sentiment de plénitude et de fécondité. Poème sublime, à la fois prosaïque et éthéré, furieux et contemplatif, harmonieux et déchirant, La Ligne Rouge fait partie de ces œuvres rarissimes qui semblent charrier un univers entier, et dont chaque plan pourrait valoir un film entier par ailleurs. À la fin, le croiseur de l’US Navy s’éloigne, la nature reprend ses droits, et l’île retrouve son calme originel, comme à l’aube de l’humanité. Dernière image : un petit palétuvier sort de l’eau, racines apparentes, mer grise, horizon cotonneux. Silence, Dieu dort. Do not disturb.
https://zupimages.net/up/18/05/l9un.jpg