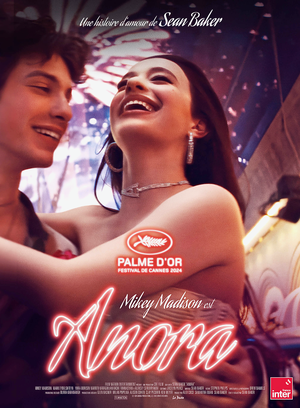La séquence d’ouverture donne à voir des fesses et des poitrines plein pot avec au second plan des hommes dans les lumières tamisées d’un établissement pour adultes. Pour Sean Baker, il n’y a rien de pathologique (en tous cas de psychologique) dans cette activité : les corps de femmes sont dans la norme, sobres en ce qui concerne leurs tailles et, mis à part quelques tatouages ou piercing, les cheveux et les prothèses ongulaires, les filles sont « standard » en comparaison avec l’image du corps féminin Fellinien par exemple.
Les hommes aussi forment une moyenne de profiles : jeunes, vieux, origine ethniques, on n’en retient que des types normaux, des « Monsieur tout le monde » comme dirait Madame Mado des Tontons flingueurs. La question de la moralité posée au personnage d’Anora se retourne immédiatement contre l’homme qui l’exprime sur un ton amusé. Sean Baker montre un milieu où les deux parties s’amusent.
On peut être troublé par cette profusion de mouvements suggestifs et de scènes de sexe jusqu’à la dernière minute du film mais la vision du réalisateur est équilibrée : le travelling d’ouverture du film est stable, passant en revue, à hauteur des corps, les filles qui s’excitent sur des hommes assis les uns à côtés des autres sur des fauteuils et dont l’intimité se résume à des demi-parois en plexi opaque.
La lumière est bleue et contrairement à la traditionnelle lumière rouge qui symbolise les lieux de prostitution. Dans Anora le rouge semble symboliser le manque de vertus lié à la richesse : de la parure en soie du lit du jeune Yvan certes enthousiaste mais inconsistant, à l’écharpe qui bâillonne Anora pour l’empêcher d’hurler sa colère, puis lui permet de se réchauffer sur Coney Island, pour finir jetée à la mère d’Yvan après qu’elle lui ait réclamé.
Anora c’est les montagnes russes matérialisées par le plan où 4 des protagonistes passent devant l’attraction Cyclone construite en 1927 et classée au Registre National Historic Landmark : de la chaleur sexy du HQ au froid de la grande demeure vide du jeune russe, du charme distillé par cet adorable petit bout de femme au sentiment de révolte ressentie par la furie qu’elle devient pour sauver son honneur, du rire provoqué par la bande de bras cassés à l’émotion d’un amour naissant, fort et sensible…
On apprend certaines des significations du prénom Anora par le seul personnage qui s’intéresse à elle au fond, car se faisant appeler Ani, comme le font beaucoup d’entraineuses pour n’être qu’une part d’elles-mêmes et conserver un territoire psychologique vierge, la jeune femme ne tient pas à son identité culturelle ; elle comprend très bien le russe grâce à sa grand-mère mais ne préfère pas le parler.
Le traitement de Sean Baker concernant la psychologie de la prostituée est subtilement dosé car si dans la première partie le personnage manque d’intériorité, la dernière partie du film donne une profondeur inattendue aux deux heures précédentes d'excès, de contrastes et de largesses rythmées. En une seule scène, un lent huis-clos, se révèle l’enjeu réel pour Anora : l'Amour. Se prostituer est un jeu d’enfant comparé à l’épreuve de s’abandonner à l’amour, de se laisser aimer pour qui elle est, à la fois une enfant et une furie, d’accepter d’être fragile et monstrueuse, accepter d'être aimée avec ses blessures, ses faiblesses et ses travers. D'être entièrement elle, pas seulement un corps.