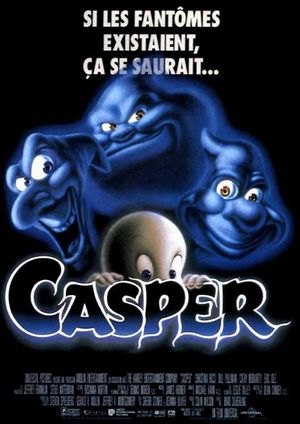Du temps de l’enfance, Casper était de ces VHS usées jusqu’à la moëlle, tout y confinant au fascinant : un soupçon de frisson pour le bambin, un héros attachant et une triplette d’esprits farceurs « ambiguës » et, bien plus encore, le décor d’un manoir bigarré ne ressemblant à rien d’autre, exacerbant l’imagination des plus jeunes spectateurs.
Si aujourd’hui tout cela est encore relativement vrai, le long-métrage du rookie d’alors Brad Silberling (qui n’a guère percé depuis) constitue un divertissement plutôt poussif : l’antagonisme incarné par Carrigan et Dibbs (qui rappellent beaucoup Médusa et Snoops dans The Rescuers) est unidimensionnel, excessif et caricatural, n’en déplaise à quelques excentricités surprenantes, marque d’un récit facile quoiqu’original par certains aspects.
Nous pourrions alors avancer que, le temps passant, nous ne sommes plus la cible de cette histoire de fantômes espiègles, mais pareil raccourci serait malvenu : de fait, la « férocité » de certains dialogues surprend, au même titre que l’usage de thématiques nullement anodines (le deuil étant la plus évidente)… quand bien même celles-ci seraient au service d’une narration privilégiant des gags inégaux pour progresser.
In fine, le plus gros problème tient peut-être du fait que les « déboires » de Casper ne parviennent pas à nous passionner, ce qui est paradoxal au regard de la sympathie qu’il inspire. À contrario, le personnage de Kat (interprété aux petits oignons par Christina Ricci) est davantage touchant, comme en opposition à l’emploi résolument cartoonesque de son paternel (pourtant sujet au blues) : au moins, son association aux trois « oncles » a le mérite d’être majoritairement poilante, le long-métrage s’arrogeant une ironie et un humour noir salvateur.
Puis, force est de constater (une fois encore) que Whipstaff Manor est un motif de satisfaction à lui seul : fort d’une architecture particulière, il nourrit une atmosphère unique et nous captive au moyen de ses couleurs tortueux, portes à la dérobé et pièces secrètes. Enfin, que dire de plus si ce n’est que les grosses ficelles auxquelles s’adonne Casper, très peu regardant en matière de cohérence, ont tôt fait de nous ramener sur terre : d’ailleurs, sa technique largement dépassée (mais louable pour l’époque) parachève cette vive impression de... pauvreté.
À l’image de quelques séquences baignant dans une douce lumière, brefs instants où l’émotion point pour le mieux, Casper s’illumine et nous capte par intermittence : si le visionnage n’est pas à la hauteur du souvenir, conclusion commune s’il en est, gageons que sa loufoquerie vaut malgré tout le détour.