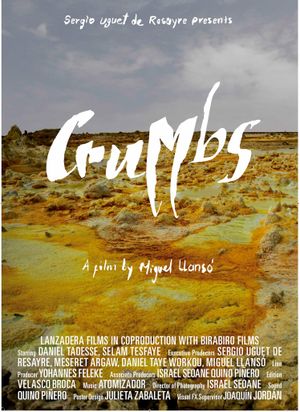Dans un monde post-apocalyptique, une nouvelle humanité vivote sans grande ambition, dans des conditions de vie modestes mais dans un état de paix universelle. En effet, la guerre a disparu en même temps que l’instinct de conservation : les gens se laissent gentiment mourir et ont cessé de faire des enfants, nous sommes dans une ère de lente dépopulation. Le premier plan nous montre ce qui ressemble à une mer asséchée (à moins que ce soit un désert), avec ses coraux exposés au vent. Candy, un petit homme bossu et hirsute, la tête rentrée dans les épaules, erre à la recherche d’un sapin qu’il finit par trouver pour le ramener à sa compagne, Birdy, une jeune femme qui réalise des œuvres d’art sur métal. Le couple vit dans un bowling désaffecté et sont inquiets car le vieux système électrique se remet parfois en marche et expulse des boules sur les rails sans qu’on sache pourquoi. Le décor ? Des friches industrielles abandonnées, des forêts, des gares désaffectées et recouvertes de végétation, une Ethiopie qui oscille entre campagne et terrain vague.
Les films de science-fiction en provenance du continent africain sont rares et ne serait-ce qu’à ce titre-là, "Crumbs" est une perlicule qui devrait susciter l’attention de tous les curieux. On apprend rapidement que Candy et Birdy ne sont pas réellement des Ethiopiens mais des extraterrestres égarés sur terre et qu’ils cherchent un moyen de rejoindre le vaisseau spatial qui plane en permanence dans le ciel et qui, imposant, construit à l’effigie d’un bras levé, s’apprête à repartir pour l’espace. Ses occupants sont des soldats dont on ne distingue pas le visage, cachés par des masques à gaz et des oreilles de souris, mais qui arborent des brassards nazis. Les habitants de la région améliorent leur ordinaire en spéculant, auprès d’un antiquaire avide et un peu escroc, tentant de marchander de vieux objets datant d’avant l’apocalypse : des figurines de tortues ninja, des disques de Michael Jackson, divers jouets qui deviennent pièces de musée ou objets consacrés. L’humanité vit dans le culte de ces vestiges, qui ont perdu toute charge triviale pour devenir des symboles quasiment sacrés. Durant les nuits d’orage, Birdy prie les saints de son panthéon (Einstein, Picasso, Paul Mc Cartney, Stephen Hawking, Justin Bieber…) et dans le jardin elle a construit un petit temple dédié à Mickael Jordan où le couple va souvent prier. Lorsque son compagnon doit partir en voyage afin de prendre conseil auprès d’une sorcière, Birdy lui confie, pour se défendre contre les éventuelles mauvaises rencontres, une réplique d’épée en polystyrène, dans son emballage de chez Carrefour, « le dernier artiste total » explique-t-elle.
Si on ajoute que ce que Candy souhaite savoir de la sorcière, c’est l’endroit où se cache le père Noël parce que ce dernier est le seul à avoir le moyen de les faire rejoindre le vaisseau spatial, on se dit que la fantaisie farfelue du scénario n’a décidément aucune limite ! Précisons encore que le père Noël est aussi noir que ses compatriotes, qu’il est caché dans un monde parallèle sous le bowling et vit en bord de mer en compagnie de chameaux en plâtre, que Candy et Birdy sont télépathes et peuvent converser entre eux sans ouvrir la bouche, que lui se considère comme l’héritier des derniers surhommes car il porte un t-shirt Superman (que le père Noël prend tout d’abord pour un symbole nazi), et que dans leur religion le paradis est associé à un jardin potager ; on aura alors un aperçu de ce à quoi peut ressembler cet ovni cinématographique. Rien de frénétique pourtant dans cette débauche d’idées absurdes ; le rythme est plutôt lent et les scènes se terminent souvent par de longs fondus au noir.
Le personnage de Candy, au physique complètement atypique (petit, tordu, bossu, asymétrique) s’avère touchant, avec son timbre de voix haut perché, sa démarche boitillante et ses regards méditatifs. L’environnement, dont on ne sait pas bien s’il faut y voir un décor de cinéma ou la réalité d’un pays aux infrastructures laissées en jachère, évoque bien cette vision de l’humanité d’après la catastrophe, avec des places de jeux aux modules rouillés, des vieux trains abandonnés, des œuvres d’art à base de matériaux de récupération (comme une grande roue hérissée de bouteilles en pastiques) et, côté nature, des forêts touffues et des singes tamarins qui dansent dans les branches des arbres. L’idée du film la plus intéressante est assurément celle qui consiste à imaginer comment nos descendants, en l’absence de toute histoire, de toute transmission intergénérationnelle, pourront interpréter le sens des objets de notre quotidien : le ludique, le pratique, l’anecdotique deviennent ici immanquablement artistique, superstitieux ou religieux ; l’usage s’en trouve modifié et le passé réécrit. Une réflexion judicieuse qui a toute sa place dans le cinéma de science-fiction.