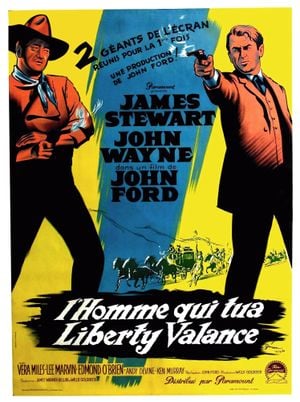L’Ouest, tel que le cinéma de John Ford nous l’a maintes fois représenté, vit ses derniers instants : les shérifs sont peu à peu remplacés par des hommes de loi, les colts par le code pénal, la diligence par le chemin de fer. C'est à la naissance d’un pays et de son Histoire que nous convie ici le cinéaste, mais aussi et surtout à la mort d’une certaine idée du western. Est-ce donc un hasard si c’est en époussetant une vieille diligence que James Stewart enclenche le long processus narratif du film, ce flash-back qui constitue le cœur même de L'Homme qui tua Liberty Valance ? L’Histoire, la vraie, celle de Ransom Stoppard & Tom Doniphon est cachée sous cette fine couche de poussière, poudre aux yeux qui aura transformé les héros en cadavres anonymes et les quidams en figures légendaires. Car Ransom Stoppard n’a jamais tué Liberty Valance, mais en retirera tous les bénéfices : une stature politique internationale, une femme dévouée et une vie comblée ; alors que Tom Doniphon, le véritable héros, lui, mourra seul.
C’est à cette vision mélancolique et amère de l’Histoire que nous invite Ford : les héros ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Dans L'Homme qui tua Liberty Valance, l’immense John Wayne, autrefois héros si fringant, achève sa course, las et désabusé, oublié de tous. Et James Stewart, dans une séquence finale splendide et tout aussi tragique, prend conscience, accablé, de l’énormité de la supercherie : une vie et un amour construits sur un mensonge, une carrière légendaire due à l'ironie de l’existence.
Dans ce moment de véritable drame, John Ford se surpasse et se met à jongler avec le temps, nous offrant, l’espace d’un quart d’heure, une même scène de duel, apogée du film, sous deux angles de caméra opposés, c'est-à-dire deux perspectives totalement différentes sur la petite et la grande Histoire. Le reste du film est d'égale valeur : science du cadrage, photographie aux majestueux contrastes, musique bouleversante.
Nous sommes loin du western lambda, notamment grâce à un scénario d’une richesse exceptionnelle qui constitue une superbe métaphore sur l’illusion (et donc le cinéma), s’autorisant une réflexion profonde d’une rare intensité sur l’Histoire des États-Unis. On ne retient souvent de ce film que sa phrase mythique, « Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende », alors que la richesse de ce film ne saurait se résumer à ce simple dialogue. L'Homme qui tua Liberty Valance est aussi un film éminemment politique. Étude au scalpel de l’histoire législative des États-Unis, le film de Ford est une variation sur son mélange foisonnant des cultures, notamment grâce à une scène d’éducation civique simple et émouvante regroupant des restaurateurs suédois, quelques enfants mexicains et un métayer noir autour de la Constitution américaine.
On se demande alors aujourd’hui comment les producteurs purent hésiter six longs mois avant de se décider à mettre en chantier ce film.
Peut-être que, tout simplement, avec L'Homme qui tua Liberty Valance commençait à disparaître un certain western, genre majeur depuis la naissance de Hollywood, et qui allait alors profondément se réinventer avec la future disparition de Ford et l’arrivée des Leone, Penn et autres Peckinpah. Car non content d’être un film profondément mélancolique sur l’Histoire des États-Unis, L'Homme qui tua Liberty Valance l’est aussi quant à l’Histoire. Placé sous le signe d’un enterrement, mené par un héros désabusé, mélancolique et vieillissant, L’Homme qui tua Liberty Valance est un splendide chant du cygne, l'ébauche d'un testament que Ford parachèvera avec La Conquête de l’Ouest.