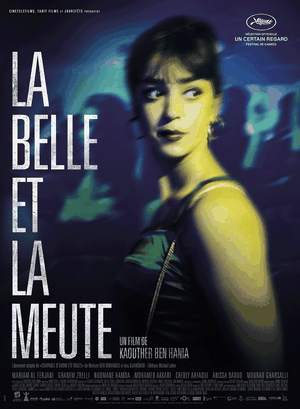Qu'est-ce qui rend un film comme celui-ci aux intentions pourtant louables si détestable ? Eh bien toujours la même chose finalement : un certaine position politique, faite de rage militante et de critique sociologique.
D'abord, l'idée que si on montre l'impuissance des démunis, on aura immédiatement fait la critique du pouvoir qui s'exerce sur eux. Il faut donc construire un scénario qui ne montre que leur dépossession, mais accordons leur une certaine noblesse et dignité dans les larmes de leur impuissance, tout de même. De quoi fait-on l'image alors ? Des opprimés certes, mais dans la mesure où ils sont opprimés et rien d'autre. On fait l'image qui les assigne à résidence. Cela peut mener à certaines abjections comme cette scène immonde de Moi, Daniel Blake où la bourgeoisie cannoise se gargarisant d'être de gauche ne sait pas montrer les démunis que comme des chiens affamés, la métaphore animale, toujours, des Dardenne à Parasite, qui toujours a sait sortir le joker de la critique pour devenir incritiquable. Manière bien moraliste d'être toujours du bon côté de la palissade, du côté du consensus donc. C'est comme, disait Rivette, si on résolvait toutes les questions formelles sans ne s'en poser aucune, ce qui revient à dire : regardez-les, les pauvres que nous ne savons pas voir autrement, parce qu'un pauvre c'est un pauvre et rien de plus, et c'est bien triste vous en conviendrez...
Bref, ce que je veux dire c'est que c'est un cinéma incapable de fiction, incapable d'utopies, incapable de parler pour autrui, mais toujours là pour parler à leur place. Ou du moins de l'image qu'ils se font de leur place, et qu'ils ont l'indigence de balancer aux yeux du monde. Ca n'est pas que la pitié est suspecte en elle-même, pas de discours de droite ici, la question c'est de quoi a-t-on pitié ? De la pauvreté ? Mais la pauvreté n'est pas la souffrance première des pauvres, elle en est la condition. Condition maintenue si l'on s'efforce de les priver de ce que la pauvreté les prive : la possibilité d'être autre chose que « des pauvres », donc d'être autre chose qu'une place dans la société, donc d'être autre chose que ce que la sociologie en fait. Voilà pour Ken Loach, mais revenons au film en question.
Ici ce n'est pas tant la pauvreté qui est en jeu, c'est le patriarcat. Autre sujet, même problème figuratifs : rien pour les victimes, juste des larmes, et une sorte d'abnégation qui ne cesse de renforcer l'impuissance d'un sujet face à l'institution. A quoi cela tient ? D'abord, surtout à cet engouement poétique pour les signes du réel. Attention n'est pas réaliste qui veut – je ne fais pas ici référence au courant ô combien plus important esthétiquement du réalisme en peinture et en littérature, ou du néo-réalisme au cinéma – ici il s'agit simplement de faire des unités de temps avec le plan-séquence (sorte de joker bazinien du montage interdit pour renforcer l'effet de réel), on s'attendait presque à voir de la caméra-épaule, on préfèrera néanmoins le steadycam pour rendre ça plus fluide. La « caution de réel » comme l'appelait Daney qui s'est démocratisée en « inspiré de faits réels », « inspiré d'une histoire vraie », « inspiré d'un fait divers », car si ça a eu lieu c'est que le film est vrai. Ensuite, à la cruauté du film, par la violence faite aux corps, à la fois émotionnelle et physique, mais qu'il faut montrer avec tout le dispositif de distanciation brechtienne parce que sinon on serait suspecté de voyeurisme (le viol ne sera donc montré que par le biais d'un écran). Mais surtout la grande doxa du cinéma de gauche qui reste la pédagogie sociologique, autrement dit la démonstration ostentatoire des mécanismes de domination du patriarcat, dont le scénario fait le commerce jusqu'à vider les caisses.
Et comme on sait, au moins depuis Bourdieu, que sociologie et esthétique ne font pas bon ménage, demandons-nous : de quoi cette sociologie est-elle armée ? D'affects évidemment, toujours les mêmes, martelés tout au long du film et supposés éveiller notre fibre contestataire, ou avoir le fameux effet d'un « électrochoc », « la claque », « le film coup de poing » mais moi je n'ai jamais aimé les tortionnaires. On reconnaît bien ici les présupposés du cinéma « critique » celui qui vient nous crier dans l'oreille : ayez pitié des démunis, indignez-vous, regardez ce qu'ils subissent, voyez comme ils sont impuissants. Alors il n'y a pas de doute, c'est bien du cinéma politique, mais de quelle politique est-il fait ? Entre celui qui dénonce mais ne montre pas autrement, et celui qui invente sans montrer tel que c'est, lequel des deux est le plus conservateur, lequel est le plus révolutionnaire ? Question rhétorique, qui sous-entend qu'une image appareille le voir, non pas le purifie, le transforme, non pas le conscientise ; que l'enjeu n'est pas mimétique mais poétique, car on ne cherche pas ce qui est en identique mais, au contraire, ce qui est dissemblable. Évidemment tout ce cinéma de pacotille est là pour nous rincer l'oeil, au sens propre en nous vendant leur camelote d'une communion directe avec le Réel, au sens malpropre et figuré en faisant de nous des voyeurs. « Écran transparent » comme disait l'autre mais cette fois qui ne débouche sur aucune opacité. Propos clair, simple, compréhensible, attendu, consensus, cinq sur cinq, j'ai bien reçu l'info, ça communique, okay, terminé, no comment, drop the mic.
Alors certainement qu'un tel film, plaira à toute la frange la plus tiédasse de la bienpensance, celle qui croit qu'on a besoin de films pour en parler, pour un peu de débat sur les affaires de société. Ou alors aux comités centraux qui recommanderont ces images pour s'indigner des horreurs commises par les institutions sous le patriarcat, ce qui consiste en somme à ne jamais voir différemment, juste à vérifier ce qu'on savait déjà. Les deux peuvent sembler contradictoires mais le consensus est bien là : la gauche se prive de l'esthétique, l'esthète ne pense que sociologie, et c'est ce qu'ils appellent "un film politique".