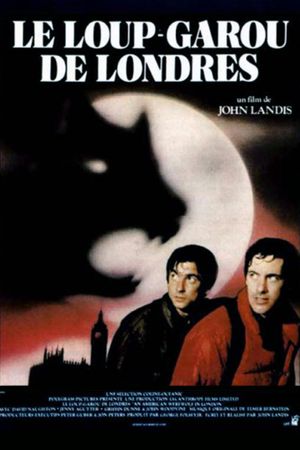En 1981, la presse est en émoi : Charles et Diana célèbrent leur mariage princier à la Cathédrale Saint-Paul de Londres. Contrastant avec la vision idyllique de la capitale britannique alors véhiculée par tous les médias du pays (et même au-delà), John Landis troque les dehors fastueux et romantiques pour une représentation de Londres éminemment plus crépusculaire et horrifique. Sa comédie d’horreur intitulée Le Loup-Garou de Londres, écrite alors qu’il n’avait à peine que dix-neuf ans, fait du zoo de Regent’s Park l’abri inconscient d’un homme-loup, des landes anglaises le terrain de chasse d’un prédateur assoiffé de sang, de Trafalgar Square un lieu de désespoir et de Piccadilly Circus, où tout tournage était jusque-là formellement interdit, un carnage dantesque caractérisé par les carambolages et les corps écrasés ou déchiquetés. À cet égard, il est difficile de contester au long métrage une place honorable au panthéon des films ayant érigé la ville en personnage en part entière. Et ce, d’autant plus que la bête sèmera ses victimes des quartiers cossus jusqu’aux zones investies par les sans-logis.
Il existe toutefois un autre panthéon, autrement plus prestigieux, que Le Loup-Garou de Londres a cette fois officiellement inauguré. En 1982 est décerné au spécialiste des effets spéciaux Rick Baker le premier Oscar des meilleurs maquillages. L’homme, sollicité par John Landis, avait dû quitter précipitamment le tournage d’Hurlements, de Joe Dante, pour rejoindre la production du Loup-Garou de Londres et ainsi honorer une vieille promesse faite au réalisateur américain. L’obtention de la statuette tant convoitée est essentiellement motivée par la séquence de transformation à laquelle on a parfois injustement résumé le film de John Landis. Il faut reconnaître que la prouesse est de taille : parfaitement rythmée et découpée, cette scène s’inscrivant en écho à la transition biophysique des enfants vers l’âge adulte est gorgée de prothèses, d’effets spéciaux, d’astuces visuelles, le tout sous une lumière profuse, et elle montre par le menu une mutation de l’homme vers le loup-garou extrêmement réaliste et douloureuse. Jusque-là, les transformations avaient été suggérées, ou arrangées au montage. Personne en tout cas n’avait jamais atteint un tel degré d’expertise en la matière. Mais il serait parfaitement absurde de ne retenir du travail de Rick Baker, patient et minutieux, que cette unique séquence. Le Loup-Garou de Londres s’est aussi distingué par la lente décomposition de Jack, un des deux héros du film, de jeunes Américains en voyage en Europe. Après avoir été sauvagement attaqué par un animal, qui s’avérera être un loup-garou, Jack réapparaît plusieurs fois face à son ami David sous forme de mort-vivant. Rick Baker va alors travailler la texture de ses blessures (ces entailles profondes, ce morceau de peau qui ne cesse de bouger…), puis lui donner un visage plus émacié, pour terminer avec une ingénieuse marionnette sculptée qui n’a pas pris une ride quarante années plus tard ! Autant de subtilités visuelles qui ont convaincu Michael Jackson de faire appel au tandem Rick Baker/John Landis pour son célèbre clip « Thriller ».
Une autre caractéristique rend Le Loup-Garou de Londres instantanément identifiable. Il s’agit bien entendu de son savant mélange des genres. L’horreur et la comédie s’y entremêlent sans cesse, à tel point que l’une semble quasi inopérante sans l’autre. La première attaque du loup-garou succède par exemple à une visite embarrassante – et très amusante – dans un bar. Tout au long du film, et notamment grâce au jeu de David Naughton, Griffin Dunne ou Jenny Agutter, les deux genres vont interagir l’un avec l’autre, semblant par moments ouvrir la voie à un film tel que Shaun of the Dead (même si la comparaison entre les deux œuvres n’est que partiellement judicieuse). L’horreur n’apparaît que rarement chimiquement pure dans Le Loup-Garou de Londres et les coupes opérées par John Landis pour éviter une classification R ont sans doute conduit à l’accentuation de cette impression. Quoi qu’il en soit, ses ruptures de ton et son humour méta- (2001, les affiches du métro, le générique, le discours sur les loups-garous, etc.) confèrent probablement au Loup-Garou de Londres son caractère résolument moderne.
Sans être dénué de défauts, le film de John Landis aligne les fulgurances : la scène du bar, l’attaque du loup-garou dans les landes, les questionnements légitimes sur la santé mentale de David, puis sur le comportement qu’il doit adopter pour préserver les autres, le regard que porte sur lui sa nouvelle petite amie (« séduisant » et « un peu triste »), les vues subjectives dans le métro, les précitées scènes de transformation et de Piccadilly Circus, etc. Avant-gardiste sur le plan des effets spéciaux ou de la tonalité bigarrée qu’il adopte, Le Loup-Garou de Londres figure aujourd’hui encore parmi les meilleurs films de loups-garous jamais réalisés.
Sur Le Mag du Ciné