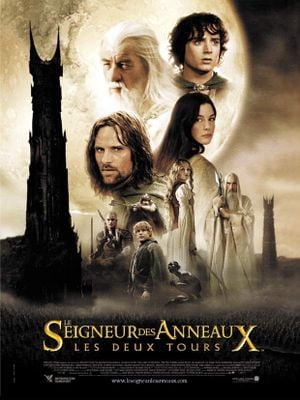Après un premier film somme toute assez facile à adapter, le véritable challenge, un vrai casse-tête même, débute réellement avec « The Two Tours ». Si « The Fellowship of the Ring » sacrifiait assez peu du contenu de l’œuvre originale, sur l’autel de l’adaptation, il en est tout autre pour cette seconde incursion en Terre du Milieu. Preuve en est, un quatrième scénariste est appelé en renfort, en la personne de Stephen Sinclair, qui a déjà collaboré avec Peter Jackson et Fran Walsh, sur les scénarios de « Meet the Feebles » et « Braindead ». Cet apport de qualité agit, qui plus est, en terrain connu.
Pour faire court, le roman de J.R.R Tolkien se compose de deux sections bien distinctes : la guerre de conquête de Saroumane, avec le siège du gouffre d’Helm, puis la randonnée pédestre de Frodon et Sam en direction du Mordor. Déjà qu’en livre ça passe un peu moyennement, puisque la première partie se montre riche, épique et plutôt fun à lire. La seconde est plus introspective, avec un rythme réduit, qui alimente la solitude du danger qui entoure les deux Hobbit et leur nouveau compagnon, Gollum. Exercice de style littéraire, plus enclin à conter deux histoires simultanées en parallèle (George R.R. Martin reprend d’ailleurs ce concept pour les tomes 4 et 5 d’A Song of Ice and Fire), il ne s’adapte pas vraiment au support cinématographique.
Le parti pris se montre radical, en remaniant absolument tout le livre, bien qu’il lui reste fidèle. Les péripéties se croisent dans une structure narrative quadrilatérale, et ce qui composait la fin des aventures de Frodon et Sam dans le livre n’est pas présent, reporté dans le film suivant. Cette audace certaine appuie le fait que l’adaptation prend de bonnes orientations, puisqu’elle ne cherche pas à suivre coute que coute sa base d’inspiration, ce qui représenterait un intérêt moindre. Cette prise de liberté s’avère des plus salvatrices, car tout le décor est posé, la plupart des personnages sont identifiés, les enjeux également, inutile donc de proposer de nouveau le même film. Bien entendu, le fait que l’ensemble existe déjà facilite la démarche, mais soudain « The Fellowship of the Ring » apparaît encore plus comme une introduction d’anthologie, invitant quiconque à venir suivre cette histoire épique.
Se croisent ainsi différents arcs narratifs, qui enrichissent davantage le récit. D’un côté, il y a le trek de Frodon et Sam vers le Mordor, et de l’autre Aragorn, Gimli et Legolas qui volent au secours de Merry et Pippin. Ces derniers, suite à leur rencontre avec un arbre, essayent de le convaincre de rejoindre la bataille contre Sauron. Ces trois arcs sont reliés par un quatrième, celui de Saroumane, qui en tant que pantin du seigneur des ténèbres prépare la guerre en bon chef autoritaire qu’il est. Ces orientations finissent toutes par se réunir à un moment, car chaque action des différents protagonistes influe sur l’histoire principale : la guerre de la Terre du Milieu.
« The Two Tours » - le film, adopte ainsi un langage cinématographique fouillé, et doit faire tenir toutes les thématiques sur un petit peu moins de 4 h. Forcément, dans « The Two Tours » - le livre, les deux parties prennent leur temps pour brasser moults enjeux, par de longues descriptions qui font corps dans une seule et même trame narrative, divisée en deux blocs. Le métrage outrepasse cela, et s’impose dès lors comme une œuvre complète, avec sa propre identité et sa personnalité. Influencée par Peter Jackson et non plus par J.R.R Tolkien, elle témoigne d’un héritage cinématographique et non plus celui de la linguistique et de l’Histoire médiévale occidentale.
Si « The Fellowship of the Ring » faisait la part belle à la civilisation Hobbit et sa place dans ce vaste monde que représente la Terre du Milieu, « The Two Tours » prend le temps de présenter une autre population. Les Rohirrims, présents dans un important royaume humain, composent un peuple de cheval, auquel ils vouent un véritable culte, et doivent leur réputation à leurs cavaliers hors pair. C’est là encore le sens du détail qui frappe, tellement cette civilisation semble tout droit sorti d’un livre d’histoire. Les motifs sur les armures et les cuirs, les sculptures sur les bois de leur ville, leurs mythes et leurs légendes ainsi que les fins ornements de leurs casques et de leurs épées, laissent à penser que cette civilisation remonte à fort lointain.
L’authenticité est la clé de la réussite de ce second volet, qui constitue une extension du premier film, et non une suite à proprement parler. Il s’en dégage une nature organique qui appuie un réalisme de l’imaginaire, donnant par exemple vie à cette peuplade du Rohan. Par les dialogues, les péripéties et les choix des personnages, se dessine en fond toute la culture rohirrim. Au détour de diverses réactions, le film nous renseigne sans cesse sur ce peuple et ses valeurs, en partie grâce à la présence de leur roi : Theoden.
Monarque médiocre, manipulé par l’un de ses conseillers à la botte de Saroumane, Theoden apparaît comme un être faible et impuissant. Le fait que le personnage le réalise et passe son temps à vivre dans la honte, face à ses illustres ancêtres, alors que sa lignée touche à sa fin, lui donne une dimension particulière. En effet, il demeure révélateur de la place des Humains, non pas seulement en Terre du Milieu, mais aussi dans cette première moitié de XXe siècle que décrit si bien Tolkien dans son ouvrage. En 2002, cette résonnance témoigne d’une forme d’impuissance des gens de bien, qui se retrouvent sans cesse mis au ban de sociétés contrôlées par les mauvaises personnes, pour les mauvaises raisons.
Si le film de Peter Jackson n’a pas vraiment de liens avec l’actualité de ce début des années 2000 (la trilogie fut tournée entre 1998 et 2000), la force des choses en fait pourtant un parfait écho. Les producteurs américains envisagèrent même durant un temps de retitrer ce second volet, puisque dans l’évocation des deux tours retentissaient encore les attentats du 11 septembre. Il sort en décembre 2002, quelques mois seulement avant l’invasion de l’Irak, laissant percevoir le tout va-t-en-guerre de l’administration Bush, alors au pouvoir aux États-Unis. La contemporanéité des évènements géopolitiques, avec le message pacifiste, idéaliste et parfois naïf de « The Lord of the Rings », n’est pourtant pas tant un hasard que ça.
En effet, si les répercussions de notre ère, avec ce qui se passe en Terre du Milieu, semblent aussi claires, c’est parce que les écrits de Tolkien reflètent le monde des années 1950. Ce dernier, a pourtant débuté son œuvre bien avant la Seconde Guerre mondiale, mais l’universalité de ses thématiques et la richesse de ses problématiques font que, peu importe les époques, cette trilogie fera toujours mouche. Puisque l’humanité se répète depuis aussi loin que se rappelle notre mémoire d’espèce, il suffit de reprendre les textes supposés d’Homer, l’Illiade en particulier, pour comprendre toute la portée de « The Lord of the Rings ».
Lorsque Tolkien publie ses livres, les questions d’environnement ne sont pas au goût du jour dans le débat public, seuls quelques marginaux l’évoquent dans le désintérêt le plus total. En 2002, ces questionnements sont de plus en plus latents, et ils ont même prit une dimension plus importante, et alarmante, dans les vingt ans qui ont suivi. Ainsi, la revanche des Ent sur Saroumane évoque simplement la revanche de la nature sur l’industrie. Ce fait, simple à comprendre, est présenté ici par le biais d’une bataille épique, porteuse d’un message solide en toute pérennité, puisqu’il est le même aujourd’hui. C’est aussi ce qui permet aux films de Peter Jackson de rester très actuels, ce ne sont pas juste des divertissements de Fantasy sans envergure, bien au contraire.
Le fameux monomythe de Joseph Campbell atteint ici ses limites tant la notion d’héroïsme, forgée dans le premier volet, vole en éclat. Plus le récit avance et moins Frodon fait figure de héros, il subit sans cesse l’anneau et ne fait que porter le fardeau d’une quête, qui en solitaire aurait connu assez rapidement un sort des plus funestes. La présence de Samwise Gamegie, ce petit personnage optimiste à l’espoir d’acier, même dans les pires moments, en est la preuve. Mais il en est un autre, un homme du Gondor, sans qui le destin de la Terre du Milieu aurait coupé court.
Faramir est le fils de l’intendant du Gondor et frère de Boromir, dans le contexte de l’histoire il apparaît comme le plus humain de tous. Puisque l’ensemble de cette trilogie reprend l’idée principale de Tolkien, Jackson démontre lui aussi que le meilleur peut se trouver dans le cœur de l’espèce humaine. Tiraillé entre le manque de considération d’un père qui lui préfère son ainé (bien plus féroce guerrier), son devoir en tant que soldat du Gondor et l’homme qu’il veut être, tout chez Faramir le pousse à succomber au pouvoir de l’anneau. Mais c’est un cœur pur, un honnête gens, ce qui l’invite à agir pour le bien commun et non pour conquérir un pouvoir personnel, ni même pour l’opportunité de retrouver grâce aux yeux d’un père cruel.
Les séquences avec Faramir se révèlent certes assez courtes, mais elles reflètent parfaitement tous les enjeux de cette quête, dont le fait de jeter l’anneau dans un volcan apparaît comme un détail (oui, en vrai on s’en fout, puisque techniquement on sait comment ça va finir). Avec cette trilogie, et davantage dans ce second film, il est question de la providence des Hommes et des Femmes de la Terre du Milieu. Tout tourne ainsi autour du fait de savoir si cette espèce se trouve apte à prendre son destin en main. Avec des protagonistes comme Theoden et Faramir, la nature terriblement humaine ressort sans cesse, laissant planer un espoir inaltérable au-dessus de ces peuplades aisément corruptibles.
La quête consiste en effet plus à savoir si l’humanité est arrivée à maturité, face à l’obscurantisme, qui explique le manichéisme volontairement unilatéral du récit, entre le bien et le mal. Ce dernier se cache aussi chez les Hommes, et le bien peut venir de ce qui est différent, comme les Hobbit, petits peuples discrets, dont quatre représentants vont bouleverser l’ordre des choses. Au-delà de sa nature de divertissement (et il peut tout à fait être lu juste dans ce sens), le film brasse une multitude de thèmes, dans un exercice qui diffère d’un livre rempli de microdétails.
Alors bien sûr, les antagonistes sont un magicien qui a mal tourné et un seigneur des ténèbres qui souhaitent récupérer son pouvoir et le monde pour faire régner son idéologie. À eux-seuls, Saroumane et Sauron suffisent pour comprendre tous les enjeux de l’œuvre. Si dans les années 1950 il est possible de rapporter Saroumane à Hitler ou Staline et Sauron à l’idée plus générale du fascisme et de l’autoritarisme, les noms, les visages et les idéologies s’interchangent, mais le mal persiste. Et lorsque l’on regarde le film du haut des années 2020, c’est encore plus révélateur, comme un constat d’échec de l’histoire, qui répète sans cesse ses mêmes travers.
De minuscules détails (encore et toujours) parcourent le scénario, et parsèment la manière dont sont représentés ici les puissants, généralement vieux et conservateurs (même Gandalf est parfois dépassé par des Hobbit un peu trop foufous). Au passage, la co-scénariste et co-productrice, Fran Walsh, vient de la scène punk néo-zélandaise. Son rejet du conformisme et de l’autorité conservatrice se perçoivent complètement dans ses scénarios depuis « Meet the Feebles », et « The Two Towers » ne déroge pas à la règle. Le film prend clairement l’orientation de constat présente chez Tolkien, agrémenté de fines touches de punk qui aurait certainement défrisé le vieil universitaire britannique.
Ces petites touches, associées à la vision de cinéma de Peter Jackson, opèrent ainsi des miracles, puisque par moments le réalisateur de Pukerua Bay retrouve ses petits airs de polisson. Décelables au détour d’une petite blague un peu potache, d’un plan gore savamment dissimulé, ou d’une moquerie plus généralisée de l’institution. Mais tout ça, est emballé dans une œuvre épique comme il en existe si peu. Pour exemple, la charge de Gandalf et d’Eomer au gouffre d’Helm représente certainement l’une des séquences les plus épiques rarement vues sur un écran de cinéma. Ainsi le film s’octroie le luxe de diffuser un message contestataire (la représentation du conservatisme pourra convaincre les plus dubitatifs) et en même temps de proposer un divertissement populaire singulier, capable de toucher le plus grand nombre par sa folie visuelle virtuose et sublime.
La tâche apparaissait ardue, et à côté « The Fellowship of the Ring » ressemble [presque] à une ballade de santé, face à l’adaptation d’un monument comme « The Two Towers ». Surtout, avec sa place hybride de volet centrale, le film ne possède ni début ni fin, mais une simple continuité de transition. Pourtant, il s’impose aussi comme une œuvre indépendante, en étoffant davantage le monde introduit dans le premier métrage. Parfaitement exécuté, son unique difficulté résidait dans sa nature de séquelle/préquelle, dont il parvient à se démarquer majestueusement par son identité forte. La présence des Rohirrims n’est pas étrangère à cela, tellement la culture de ce peuple fier imprègne le métrage avec vigueur, à l’instar d’un thème musical somptueux bien distinct.
Il est certainement facile de dire que le film compose une réussite indéniable (comme son succès commercial l’indique, avec près de 950 millions de $ de recette pour un budget de 94 millions), surtout deux décennies après. Pourtant, ce n’était pas vraiment gagné, car il aurait pu diviser le public entre puristes et masse populaire. Or, c’est tout le contraire qu’il parvient à réaliser, en rassemblant une audience de tout horizon, par une adaptation radicale qui ne dénaturer jamais l’œuvre de Tolkien. Ce véritable tour de force donne une autre dimension à cette suite, qui sans se montrer supérieure au premier volet, se présente juste comme différente, car finalement, elle raconte une autre histoire en filigrane : la nôtre.
-Stork_