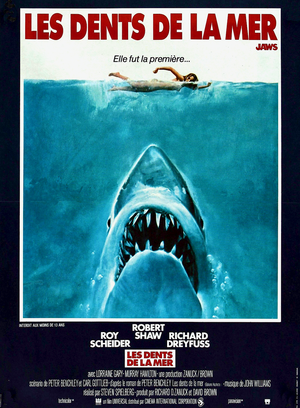Ce qui fait la force de "Jaws", c'est sans doute ce qu'il a de plus primaire et de plus viscéral. Sur la première moitié du film, Spielberg joue avec nos peurs les plus élémentaires : la peur de l'inconnu, l'angoisse suscitée par l'invisible et polymorphe visage du monstre que l'on ne voit pas ... et qui lui nous voit. Ces plans prenant le point de vue du monstre ; sans révéler son identité, le réalisateur le rend omniprésent, imposant une menace perpétuelle sur l'être humain (autrement dit le spectateur), insignifiante silhouette noir vouée à la mort, approchant au rythme de la musique frénétique de John Williams jusque l'inévitable. Le suspens se rompt et l'horreur atteint alors son paroxysme, lorsque subitement le point de vue redevient humain - et qu'on assiste donc, totalement impuissant, au carnage attendu et pourtant saisissant. Mais bon. Bien que superbe, l'idée de jouer sur les grands phobies humaines ne pouvait pas faire tout un film : de la même façon, le visage du monstre ne pouvait pas rester voilé jusqu'à la fin. A mi-parcours donc, les attaques surprises se terminent, et l'identité de la bête est dévoilée. Et le film d'horreur viscéral devient alors une lutte totalement sauvage entre l'homme et la bête ; le rythme explose, la crainte cède la place à une haine mêlée d'effroi et de fascination, et l'affrontement vire au combat légendaire. C'est l'histoire intemporelle de l'homme face au monstre, face à ses peurs les plus primales. Et, mine de rien, "Jaws" devient, bien au-delà du chef d'oeuvre, un film à la dimension mythologique.