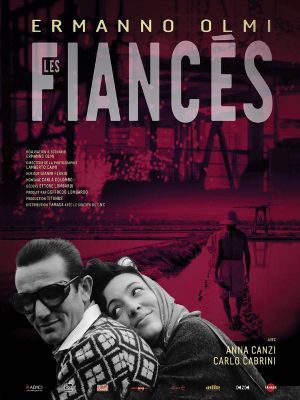Il en est des films comme des histoires d’amour. Certains prennent le temps de s’installer, tâtonnent un peu, ont des débuts revêches. Et d’autres vous enlèvent dès les premières secondes, vous enserrent d’une main de fer et vous compriment le cœur à vous en étouffer. Les premiers plans des Fiancés sont pétris à la fois de simplicité et d’évidence, et mêlent si bien la grâce et la surprise qu’on sent soudain, sans bien comprendre comment, un lien se former entre ces images et nous, à travers le temps et l’espace. C’est une salle de bal populaire, silencieuse et dans le noir. Les danseurs vont s’asseoir, les musiciens se préparent. Un serveur jette quelques poignées de sciure par terre. Et puis un tango se lance, quelques couples se forment, les corps glissent, les mains se joignent, et la magie opère, venue à pas de loup mais installée au coeur du film pour ne plus le quitter.
La maîtrise d’Olmi est proprement stupéfiante. Chacun de ses plans est composé comme un tableau, et pourtant il donne l’impression de filmer la réalité brute. Visages burinés, sans apprêt, et pourtant irradiant une beauté fulgurante. On est loin du naturalisme, tant la construction en flash back et en saynètes impressionnistes font la part belle à la subjectivité du personnage principal, un ouvrier parti en Sicile dans l’espoir de devenir ingénieur, mais le véritable tour de force du film est de maintenir de bout en bout un réalisme tout à la fois d ‘une grande précision et d’une poésie sans pareille. Giovanni erre dans la chaleur insulaire, loin de chez lui. Insomnies, fête masquée, recherche d’une pension où loger, l’intrigue est réduite à sa plus simple expression pour laisser la place au temps et aux sensations. Aux souvenirs et aux regrets aussi.
Tout est ici affaire de posture : Giovanni ne sait pas comment se comporter face à ses collègues difficiles à cerner, Liliana la fiancée abandonnée fait la fière en préférant se taire, et Olmi lui se tient droit dans ses bottes. Pas de maniérisme inutile, mais une volonté de creuser le réel comme un sculpteur un bloc de marbre. Pas d’intellectualisme non plus, le réalisateur met les deux mains dans la boue. Il filme les regards, les visages et les peaux. Il capte aussi comme personne les silences, les sourires ébauchés ou les larmes furtives. Un chien dans une église, un filet d’eau froide sur une épaule qui a chaud. Et soudain un simple coup de vent dans un rideau, ou la pluie sur une saline déserté deviennent des petits moments de pureté et de vérité doux mais coupants, subtils satoris qu’aucun mot, aucun discours ne sauraient mieux provoquer.