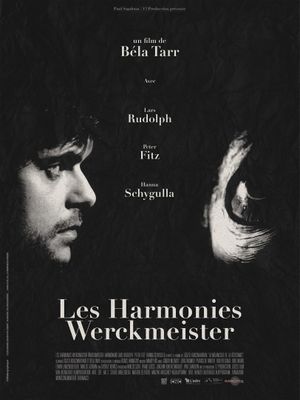Expérience hypnotique, odyssée apocalyptique d'une perte du sacré, déambulation métaphysique, ou encore apesanteur cinématographique dans les limbes (dis)harmoniques du cosmos, aucune expression ne saurait suffire à épuiser l'extraordinaire richesse visuelle des harmonies Werckmeister. Si d'aucuns pourront répudier cette dilatation du temps à l'extrême, force est de constater qu'elle se met ici pleinement au service d'un propos dont les ramifications et les interprétations multiples surgissent de chacun des plans-séquences qui composent cette œuvre, baignant constamment dans une étrange et mystérieuse atmosphère, certes, mais toujours poétique. Auréolée tantôt d'une poésie céleste et astrale, tantôt d'une austère rugosité, cette œuvre du cinéaste hongrois envoûte et inquiète à la fois.
C'est que Tarr est un grand chorégraphe, et il le prouve ô combien lors de cette scène introductive, rejoignant le panthéon des plus grandes - et fascinantes - scènes de l'histoire du cinéma : alors que le patron d'un bar exhorte les derniers piliers de bar à plier bagage, l'un d'entre eux demande à Janos Valuska de faire son spectacle. Ce dernier s'empare des poivrots cuvant leur alcool, les prenant chacun à partie pour mettre en scène le mouvement des planètes, dans une exceptionnelle pantomime qui révèlera pourtant une peur que l'on pensait révolue : celle de l'éclipse. Terreurs millénaristes et eschatologiques, resurgissement de l'irrationnel dans l'ordre harmonique et cosmique d'un univers dont les hommes deviennent la personnification à travers ce spectacle improvisé, voilà posés les jalons qui structureront toute la trame narrative du film. La caméra de Tarr finit par épouser le mouvement de la lune et de la terre, au point de devenir elle-même l'une des planètes du système solaire. Progressivement, la lancinante et poignante musique s'impose crescendo, elle qui scandera à de nombreuses reprises Les harmonies Werckmeister et lui confèrera ses accents d'une terrible tristesse.
La lenteur et la précision des mouvements de caméra, conjuguées à un refus manifeste de l'emploi du champ/contre-champ permet non seulement d'épouser le point de vue de Janos, mais surtout de procéder à une véritable phénoménologie cinématographique : il s'agit de montrer par là les tâtonnements d'un être marginal, de souligner à quel point sa découverte du monde qui l'entoure n'est toujours que fragmentaire et partielle, mais dont la brutalité latente ne pourra que se manifester tôt ou tard. Les rumeurs d'une menace extérieure (ou intérieure ?), la délation, ainsi que l'hystérie populaire gangrènent progressivement l'espace visuel depuis que le cadavre d'une baleine s'offre au regard des spectateurs sur la place de la ville, et qu'un certain Prince - dont nous ne verrons que l'ombre naine et menaçante - a pris ses quartiers.
Le contraste résolument expressionniste autorisé par la maîtrise impeccable du noir et blanc est à l'image même de la dualité constante du propos : il y a d'un côté la candeur de Janos, et de l'autre une violence sociale souterraine ; il y l'harmonie, et les dissonances ; il y a ces individus quasiment figés sur la place de la ville, telles des poupées de cire tout droit sorties d'un film de Wojciech Has, et cette foule opaque et galvanisée prête à se livrer à la violence la plus expiatrice. Avec la même virtuosité donc, le réalisateur hongrois filme le sac d'un hôpital d'une frénétique brutalité qui ne pourra s'achever que par la vision d'un homme nu et décharné, ultime réminiscence visuelle des camps de la mort... Et lorsque la foule repartira tête baissée, ne subsistera que le visage épouvanté de Janos, spectateur impuissant de cette sauvagerie.
L'idéal de pureté musicale que s'évertue à atteindre le pianiste Gyorgy Eszter, qu'admire Janos, est donc à jamais entaché par un réel de plus en plus absurde. Ne reste plus pour ce dernier qu'à s'émerveiller face à ce qu'il reste de divin ici-bas, le dernier avatar de la Création étant cette baleine devenue bête de foire ; et cette contemplation naïve fera de Janos, un peu à l'image de L'Idiot de Dostoïevski, le dernier symbole de ce qu'il reste d'humanité dans un monde qui tourne la page du XXe siècle et de ses pires atrocités.