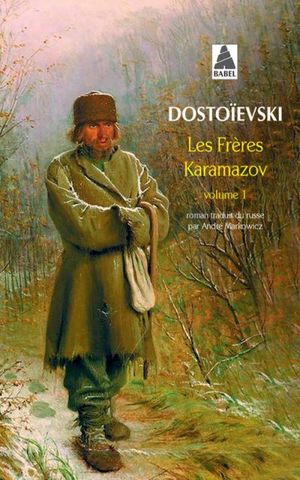Réveiller le Karamazov qui sommeille en nous
Ecrire une critique des Frères Karamazov relève de l'impossible ; se livrer à cet exercice reviendrait à passer pour une sorte de Tartuffe, un coupeur de cheveux en quatre, ou à tout le moins pour un sophiste se délectant de rhétorique spécieuse. Là où s'arrête le pouvoir hypnotique des mots, commence une expérience de lecture ineffable, magique et transcendante. Alors, pourquoi me suis-je résolu à partager cette expérience unique ? Peut-être, tout simplement, et modestement, pour recommander, à chacun(e) qui me lira, de se plonger un jour dans cette cathédrale dostoïevskienne, dont chaque page apparaît comme une pierre nécessaire à la grandeur d'un édifice qui nous dépasse. Plonger dans les abysses d'un tel chef d'œuvre, c'est se résoudre à épouser l'exaltation et la frénésie de cette myriade de personnages aussi réalistes que possible - peut-on encore parler de personnages tant la plume de Dostoïevski fait nôtre les questionnements, les tourments, les angoisses de ces Alexeï, Dmitri, Ivan ou Smerdiakov ? C'est laisser sa respiration suivre le rythme haletant de l'écriture ; c'est toucher la grâce et le Beau, tout en en explorant les tréfonds d'une âme humaine en proie à ses déchirures les plus profondes ; c'est assister à la lutte d'une humanité déchue, tiraillée entre le chemin des ténèbres et les voies de sa salvation, pour sa survie.
L'on aura beau faire des Frères Karamazov une lecture psychanalytique, comme l'a tenté Freud, une lecture sociologique de la Russie tsariste, ou s'aventurer dans une interprétation philosophique et métaphysique sur le libre-arbitre, aucune ne saurait suffire à épuiser la richesse incommensurable de l'œuvre ; le parricide nous est donné à voir alors qu'il n'est déjà plus là, qu'il se dérobe devant nous pour faire place à une réflexion sur l'amour, la possibilité de se sauver ou sur la liberté. En fin de compte, d'ailleurs, qu'importe le coupable, puisque ce qui compte est moins l'acte que le désir plus ou moins larvé de la mort du père ? Ces glissements perpétuels et cette irréductibilité de l'œuvre à son sujet brillent autant que le jeu sur les temporalités, la capacité à imbriquer les genres, la superposition de récits dans le récit - quel merveilleux passage que celui du Grand Inquisiteur ! -, la puissance et la beauté des dialogues.
Que reste-t-il donc, lorsque, non sans amertume et tristesse, vient le temps de refermer ce livre bouleversant, dont la fin est arrivée trop vite ? L'écho de réflexions pénétrantes, à l'actualité brûlante, la résonnance de phrases à graver en lettres d'or, une douce et indéfectible affection pour chacun des personnages qui viennent de défiler sous nos yeux, y compris les plus vils et les plus méprisables en apparence - car comment ne pas faire d'eux le miroir de nos propres faiblesses ? Il reste, surtout, et à l'image du starets s'agenouillant devant Dmitri, une envie de se prosterner devant des hommes qui courent inexorablement à leur perte. Et si cette fresque monumentale, aux couleurs évangéliques, nous touche irrémédiablement et universellement, c'est que subsiste, en chacun de nous, une part de karamazovisme.