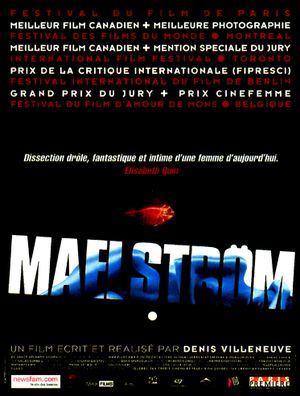Un gros homme sale et à moitié nu qui taille en pièces un poisson parlant dans un local sombre et rougeoyant. J'ai douté sur le moment d'avoir bel et bien lancé le second long-métrage de Villeneuve, un film qui lui a valu de faire neuf années sabbatiques avant Polytechnique parce qu'il ne le satisfaisait point. Et cette introduction, c'était son moyen de créer la dissociation dans un drame commun, comme c'était son credo dans ses premières années.
Peut-être le trop-plein de littéralité dans ce décrochement a-t-il déplu au réalisateur. C'est vrai qu'il ne nous glisse pas dans son univers avec la même étrangeté qui le caractérise (procédé de recyclage qu'il maîtrisera particulièrement dans Incendies), mais est-ce une mauvaise chose ?
Il n'y a que trois moments où cela rend le scénario trop elliptique : le début, le bouleversement dramatique, et la fin. Le reste du temps, soit l'écriture se fond dans l'image, soit l'oppression créée par les deux à la fois compresse la fibre dramatique jusqu'à la sublimer de la même manière que ses films ultérieurs (pré-Hollywood) se surpassent eux-mêmes. Avec moins de maturité certes, mais le bond est tout de même formidable depuis Un 32 août sur Terre.
Une odeur de poisson, les caprices d'une vie à surmonter, voilà nouée la malédiction au travers de laquelle on est amené à superstitieusement aborder les personnages. Dans ce surnaturel qui effleure à peine les recoins de l'image (c'est très Big Fish, tout ça), on ne regarde plus un drame, mais bien le Proto-Villeneuve qui se déchaînera au bout d'une décennie.
→ Quantième Art