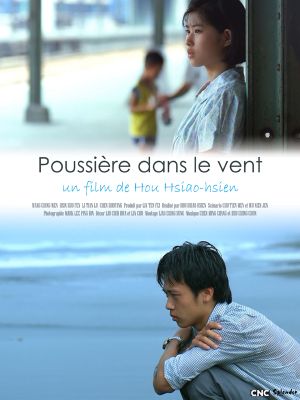On peut lire sur la fiche wikipedia anglophone d’Hou Hsiao-Hsen qu’il est connu pour son austérité. C’est se méprendre sur ce que peut être la richesse d’un film. Certes, Poussières dans le vent est majoritairement composé de long plans fixes, mais ils sont foisonnants.
Ces plans fixes sont plutôt des plans d'ensemble ou des plans moyens, qui laissent donc entrer beaucoup de personnages ainsi que leur environnement, rural au début puis urbain ensuite. Même quand la caméra se rapproche, l’image contient toujours plusieurs niveaux et plusieurs individus. Dans ces cas précis, les dialogues se font souvent avec les protagonistes dans le cadre plutôt que par des champs contre/champs. Il y a donc beaucoup de choses à voir à l’écran, et tout est composé avec un grand souci de captation de la réalité matérielle des deux héros. Par exemple, un certain nombre de dialogues ont lieu devant la maison des parents de Wan ; la largeur du cadre permet d’inclure une partie des autres habitants, notamment des enfants qui jouent et qui colorent les scènes d’une légèreté qu’un plan plus restreint n’aurait pu contenir. On voit aussi un muret en ruine suggérant la situation économique du village.
Le plan sur le salon partagé de Wan est assez large pour montrer les peintures sur lesquels travaillent son colocataire. La scène dirige l’attention sur la table à manger mais la composition du cadre permet de voir d’autres choses, en sous-main. Elle suggère par exemple une sensibilité esthétique aux personnages, qu’un plan plus serré aurait éclipsé - qu’un autre film dont le sujet est la relation de deux prolétaires taïwanais n’aurait jamais abordé. L'ampleur du champs permet à Hsou Hsiao-Hsien de placer plein de choses diverses et inattendues dans le cadre, surnuméraires par rapport au "programme narratif" du film, et donc bienvenues quand on se réjouit qu'une caméra peut faire mille fois plus qu'illustrer un sociotype (aussi intéressante que soit cette dernière ambition).
Cette façon de faire interagir les personnages dans des plans larges ne sert pas qu’à documenter et complexifier leur environnement, elle permet aussi de produire des émotions d'une grande intensité. A partir du moment où Wan puis Huen partent vivre à Taipei, le cadre laisse entrer énormément d’éléments matérialisant leur vie de travailleurs pauvres. On voit les ateliers, on voit l’entrée assez misérable de leur logement, son étroitesse par rapport aux nombres de colocataires (quoi que l'étroitesse soit surtout l'effet de tout le bordel qui se trouve en arrière-plan, peut-être la conséquence d'habiter à l'arrière d'un cinéma, c'est assez indécidable, encore des éléments surnuméraires impossibles à réduire au simple statut des personnages, qui enrichissent la description de leur quotidien et de leur environnement). On voit aussi qu’ils ont toujours des choses à faire, qu’ils doivent travailler. Assez ténus et assez rares, les moments de tendresse entre les deux héros sont décuplés par contraste. Surtout, ces moments sont représentés en situation : il ne s’agit pas de donner à voir une forme d’amour universel dans un monde difficile, il s’agit de montrer un amour contextualisé, l'amour de deux prolétaires qui tentent de gagner leur vie à Taipei. Cela passe donc moins par des dialogues et des situations typiquement amoureuses que par une présence mutuelle dans le cadre. On les voit faire des choses ensemble, parler en même temps que l’un travaille, l’un attendre l’autre, l’autre soigner l’un, acheter des chaussures ensemble, etc. Leur intimité n’éclate pas à l’écran, elle est subtilement disposée par leur placement dans le champs, leurs mouvements et leurs regards.
Tout ça donne évidemment bien plus de corps à leur amour que des scènes archétypales, dont le film est complètement exempt (à l’exception peut-être de la remarque de Wan sur le comportement d’Huen lorsqu’elle boit avec ses amis). Logiquement centrale dans une relation entre deux pauvres, l’argent n’est pas éludé et fait l’objet de quelques scènes, notamment après le vol de la moto du patron de Wan. Ces choses, triviales dans une autre fiction, participent à déterminer matériellement leur amour, et donc à le rendre vrai. Quand cette intimité est représentée par le champs/contre-champs (l’un des rares) qui fait suite aux soins donnés à Wan par Huen, elle devient d'autant plus poignante. Huen souriant à Wan encore avachi, en regard caméra, est un plan magnifique. Wan admirant une dernière fois Huen à travers le soupirail de son atelier l’est tout autant.
Et quand le film met un terme à la relation entre Wan et Huen, on a juste une lettre, les pleurs de Wan et un plan sur Huen présentant son mari au village. Ça dure à peine cinq des dix dernières minutes d’un film d’1h50, ça n’élucide rien mais ce n’est pas utile (on devine la raison derrière le choix de Wan). Hou Hsiao-Hsen nous a dépeint une relation dont la documentation matérielle a accru la réalité ; la banalité avec laquelle cette relation s’arrête nous émeut.