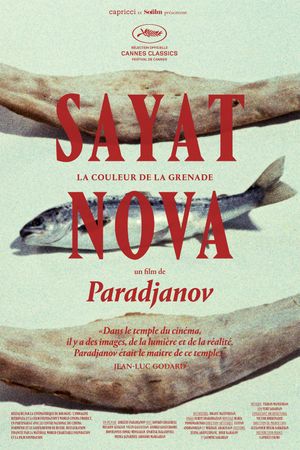Si Sayat Nova retient particulièrement l’attention au sein du riche panorama du cinéma soviétique (arménien ?), pourtant peuplé d’originaux plus ou moins célèbres comme Tarkovski, Sokourov ou Lopouchanski, c’est aussi peut-être parce que contrairement à ces autres exemples, Paradjanov (son réalisateur) semble avoir découvert l’image filmé et ses possibilités en même temps qu’il tournait son film. Si pour bien des long-métrages, au fil des années, on a pu répéter « celui-là ne ressemble à aucun autre », Sayat Nova est possiblement le seul de tous à véritablement mériter cette description : cet objet arménien débarqué sur la planète Terre en 1969 a inventé sa propre manière de concevoir le septième art. Il est même particulièrement compliqué d’en délivrer une analyse tant le film de Paradjanov évite tout critère ou code envisageable comme un potentiel point de départ pour une appréciation critique, tant objective que subjective : il n’y a pas d’histoire, il n’y a pas d’acteurs (tout au plus des êtres humains catapultés sur une pellicule), il n’y a – à vrai dire – même pas de scène. Des tableaux alors ? Même pas. Une installation ? Ce serait réducteur.
Seule intention visible (car énoncée) de Paradjanov, celle de trouver une poésie – celle de son personnage et sujet principal, le poète médiéval Sayat Nova. C’est peut-être la meilleure manière de le résumer : cette recherche imperturbable d’une forme de l’écrit d’un autre temps, d’une autre humanité. Et puisque l’œuvre de Sayat Nova est probablement encore plus obscure que son existence, difficile pour quelconque cinéphile curieux d’en juger la véracité : mise à part essayer d’abord de déchiffrer un brin de sémantique avant de finalement s’abandonner à l’admiration béate d’un tel élan créateur, difficile de faire quoi que ce soit. Car oui, nul autre destin que celui de faire table rase de tout biais culturel face à ce film. Tout le monde est égal face à Sayat Nova, de la même façon que tout le monde est égal devant une fresque médiéval mettant en scène un seigneur, des serfs est un château : ces compositions nous semblent abstraites car nées de l’ancien monde.
Sayat Nova renoue avec une idée de l’image qu’on pouvait avoir au Moyen-Âge : cet aplat des perspectives, des reliefs ; cette palette de couleurs sans artifices ; ces choix étranges, irréalistes, de faire jouer l’action, la symbolique et le temps sur un même plan immobile, incarné d’une plasticité désuète. Et pourtant, Paradjanov ne fait pas un film-tableaux : il joue des sons, de gestes cycliques presque atemporels, il recompose sans jamais reformuler. On sait par avance où nous emmène chaque « plan » mais il semble impossible d’en prévoir la durée, ni même encore (et c’est normal) la force sensitive.
Parler de Sayat Nova c’est comme parler d’un objet préhistorique : nos repères sont flous, notre sensibilité est notre seule arme. Pourtant, et c’est bien là un rebondissement, tout cela est un film, un vrai, un original, et on ne saurait dire s’il a été fait par des aliens ou par des peintres du XIVe siècle. Seule certitude : c’est par ce genre d’écarts indescriptibles que le cinéma nous laisse entrevoir une réalité alternative, celle où – plutôt que dicté par le mouvement interrompu du temps et de l’action – il aurait pu être régi par un moteur tout autre, inconnu, inimaginable. Ce serait comme découvrir une nouvelle couleur. Sayat Nova, comme un témoin de cet autre monde, nous laisse mélancoliques : pourra-t-on un jour explorer ces milliers de films extratemporels ? Et si chaque film était le premier de sa propre histoire du cinéma ?