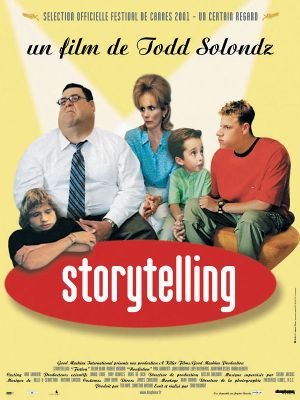Réalisateur provocateur oeuvrant au sein du cinéma indépendant américain (et donc loin de Hollywood et de ses "majors"), Todd Solondz, au même titre que ses confrères Larry Clark ou Gregg Araki, issus du même milieu artistique, utilise le cinéma pour dépeindre et dévoiler, à travers des portraits humains assez peu glorieux, tous les travers et faux semblants de la société américaine contemporaine bien pensante.
Famille américaine moyenne, jeunesse en perte de repère, personnes en apparence bien sous tous rapports (psychiatre bon père de famille, enfants touts polis tout gentils, mère au foyer bien intentionné); bref ce sont tous les clichés de la "midlle classe" américaine vu et revu à travers bon nombre de sitcoms et de séries pour ados que Solondz s'amuse à torpiller de films en films.
Par exemple, dans "Happiness", son film le plus controversé à ce jour, un "papa poule, bon mari et psychiatre réputé se révélait être au final un dangereux pédophile. De même, dans le même film, un jeune homme au physique ingrat mais d'une apparente gentillesse souffrait de ne pas avoir de petite amie... jusqu'à ce que l'on s'aperçoive assez tôt qu'il harcelait sexuellement et anonymement des femmes par téléphone.
Bon, tout ça pour dire que l'ami Solondz n'a jamais fait dans la dentelle, au point d'en laisser certains sur la touche (répudiés par ses outrances et provocations) là où d'autres se pâment au point de crier au génie. Et ce n'est pas ce fameux "Storytelling" (littéralement le fait de raconter une histoire à des fins de communication), sortit deux ans après "Happiness", qui calmera les esprits.
Film singulier s'il en est, il se compose de deux histoires (en gros, un "court-métrage" de 20 minutes suivi d'un "moyen métrage" d'environ une heure) n'ayant rien à voir l'une avec l'autre.
La première histoire, intitulée "Fiction", met en scène Vi, une étudiante en littérature qui sort avec Marcus, jeune homme handicapé mental. Le couple suit le même cours d'écriture donné par monsieur Scott, un professeur noir réputé pour sa carrière prestigieuse (prix Pullitzer) et pour son charme auprès des étudiantes de son cours et auquel Vi elle-même ne semble pas insensible, au grand dam de Marcus, se sentant de plus en plus méprisé pour son handicap.
A travers cette histoire et tout comme il l'avait déjà fait dans "Happiness", Solondz pervertit les "lieux clichés" typiques des séries et sitcoms américaines, ici, la banlieue chic et aisée d'"Happiness" se substituant à un lycée somme toute relativement classique dans ses particularités (professeur séduisant, ados rebelles, jeunes filles effarouchées) histoire de faire comprendre que le mal peut prendre racine dans les lieux que l'on croit de prime abord être les plus banals et les moins à problèmes.
Pour le réalisateur, le fait de pervertir les lieux constitue aussi une manière de révéler que en fin de compte, les gens que l'on croit être bien intentionné sont en fait de véritables monstres, on peut même parler de "porcs" dans la mesure où leurs déviances sont majoritairement sexuelles, n'ayant d'humain que leur chaire. Et pourtant, dès le départ, bien avant l'outrage subie par Vi, on sent qu'il y a quelque chose de pas très clair, dans cette petite histoire de lycée américain. Bien que très compréhensive et bien intentionnée vis-à-vis de son petit ami Marcus, on se demande si au fond, Vi sort avec lui par compassion ou par réel désir, interrogation qui sera par ailleurs dévoilée par Vi à elle-même à sa meilleure amie de fac.
On ne va pas se mentir, le fait que le réalisateur ait délibérément choisit de mettre en vedette de son histoire un couple apriori peu banal (une jolie fille avec un handicapé) fait partie de son envie de provoquer, provocation qui plus tard débouchera sur un final des plus dérangeant sur fond de soumission sexuelle, de racisme et de handicap qui ne manque ni d'audace... ni de finesse, et c'est là que le bas blesse. En effet, à force de vouloir jouer la carte de l'outrance en voulant "choquer à tout prix", le malaise l'emporte sur la réflexion, le temps d'une scène de sexe assez sordide et malsaine (que nous tairons ici sous peine de "spoiler").
Et pourtant, ce "premier film" traite intelligemment de la fontière entre fiction et non fiction (d'où le sens de son titre "Fiction", dans la mesure où Vi finira par rédiger par écrit ce qu'elle a subit et que dès lors, où se trouve la vérité ? Qui pourrait la croire maintenant qu'elle a décider de témoigner de ce qu'elle a vécu par écrit, sans preuves irréfutables ?
C'est sur ces questions délicates et qui resteront sans réponses (si ce n'est les remarques condescendantes de la part de ses camarades de classe sur son style d'écriture) que Solondz choisit de boucler son histoire qui, en l'espace de 20 petites minutes, aura eu le mérite de nous dévoiler des personnages intéressants car plus ambigus qu'ils n'y paraissent (l'innocente Vi, le pauvre Marcus et le mystérieux Monsieur Scott), des sujets tabous traités en profondeur (le droit à la sexualité pour tout le monde, le racisme, la question du désir).
En bon provocateur, Solondz choisit de filmer de manière froide, optant pour une photographie grisâtre histoire de traduire le malaise suscité par les interrogations de ces personnages, qu'il cadre de manière très serrés (gros plans et très gros plans sur les visages). Malheureusement, ""Fiction", faute à son dernier acte trop outrancier pour être honnête, finit par perdre en subtilité ce qu'il avait pourtant envie de démontrer.
Dommage...
La deuxième histoire, "Non fiction", plus longue, est plus réussie. Non exempt de défauts (scènes inutiles qui semblent présentes uniquement par remplissage), ce "second film", plus développé et moins outrancier (mais qui reste provoquant), est tout de même plus réussit. Racontant l'histoire de Toby, un documentariste avide de reconnaissance médiatique qui décide de suivre la vie des Livingston, famille américaine moyenne BCBG par l'intermédiaire de Scooby, le fils aîné amateur de marijuana et à l'homosexualité naissante, "Non fiction" reprend les codes d'"Happines"" (banlieue chic,image de la "famille parfaite") tout en les réinventant : le psy pédophile en apparence "père et mari modèle" cède ici sa place à un enfant "parfait", très poli et très gentil qui est en réalité un sale gosse pourri gâté abusant du profond respect de son père à son égard et de la bonté de Consuelo, sa nounou mexicaine, le fils tout innocent du psy se substituant au rebelle Scooby .
La réussite de cette seconde histoire tient au fait que, tout en restant fidèle à sa volonté de pervertir les codes de la "middle class" américaine histoire de mieux faire en faire ressortir leur hypocrisie, Todd Solondz se permet quelques clins d'oeils parodiques (et assez appuyés) au cinéma documentaire de Michael Moore, à travers le personnage de Toby. Connu pour sa manière de tourner en dérision les intervenants réels de ses films, le plus souvent qualifié de "manipulateur" par ses détracteurs, Michael Moore peut effectivement se lire en la figure fictive de Toby, dans sa manière de tourner en ridicule les valeurs de la famille Livingston (le père prônant la réussite sociale et matérielle à tout prix, Scooby filmé tel un "hippie" tombé à la mauvaise époque), ce que démontrera la séquence durant laquelle Scooby, se sentant humilié, assiste bien malgré lui aux réactions hilares des quelques spectateurs ayant assisté au film-documentaire réalisé par Toby sur lui et sa famille.
De même, le réalisateur, à travers le film de Toby (et donc en s'appuyant sur la technique "meta" - en gros, "le film dans le film dans le film"), se permet même un clin d'oeil potache à la célèbre séquence volante du sac plastique du film "American Beauty" de Sam Mendes.
Si ces quelques trouvailles peuvent sembler un peu faciles, il n'empêche qu'elle témoigne d'une envie du réalisateur de ne pas se répéter et même d'envisager la question sur le fait que "la fiction l'emporte sur la réalité" et vice-versa.
Ceci dit, ce que l'on retiendra surtout de ce second film , c'est toute la partie, jubilatoire, traitant des rapports entre le bonne des Livingston et leur jeune fils Ethan. Faussement gentil, le petit garçon, de par ses questions d'une cruauté à faire pâlir le marquis de Sade lui-même ("Si ton fils est mort exécuté sur la chaise électrique, c'est qu'il le méritait, tu crois pas ?") émise avec un calme des plus dérangeant, n'hésite pas à abuser de l'amour de ses parents pour les pousser, d'une manière des plus insolite que nous ne dévoilerons pas ici, à se montrer injuste via-à-vis de la malchanceuse Consuelo.
Cette "seconde partie de film", "Non fiction", est tellement amusante (de par ses dialogues parfumés à l'humour noir, son ironie grinçante, son final tragi-comique) que l'on en vient à regretter que Solondz n'ait pas souhaiter l'allonger, voir même à en faire un "vrai" film.
Loin d'atteindre la virtuosité tragicomique d'"Happiness" qui finissait par nous faire éprouver de la peine y compris pour ses personnages plus abjects, "Storytelling" n'en reste pas moins l'un des "films" (ou du moins "long-métrage divisé en deux") les plus intéressants de son auteur en ce qu'il poursuit de manière audacieuse et provocante (rarement l'humour noir n'aura atteint un tel degré de cynisme) , surtout dans "Non fiction", la radiographie des travers cachée sous la face trop lisse pour convaincre de ces américains BCBG vivant dans des maisons proprettes et aux jardins impeccablement bien tondus; le tout servi par des comédiens très complices et habités par leurs rôles (John Goodman en patriarche de la vieille école obsédé par la discipline et la réussite, Paul Giamatti en documentariste manipulateur lointain cousin de Michael Moore).
On ne peut pas en dire autant de la première partie, "Fiction" qui, en dépit de ses thématiques intéressante et de sa manière amusante de tordre le cou aux clichés de série adolescentes, n'atteint pas le même niveau, et sombre dans un malaise des plus discutables.
Reste une oeuvre intéressante, inégale et imparfaite, mais suffisamment travaillée (en tout cas dans sa seconde partie) pour attirer l'attention.