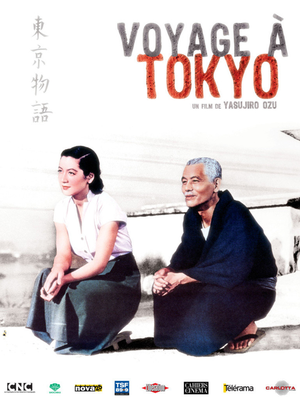Variation sur les thèmes de la filiation et de la transmission, Voyage à Tokyo met en scène à travers l'opposition ville et campagne les différences entre les générations, l'une traditionnelle et l'autre moderne qu'incarnent parents et enfants - dualité qu'illustrent les images finales du train à l'allure folle et du bateau glissant doucement sur le fleuve.
Pour mieux analyser les enjeux de ce film, arrêtons-nous sur cette citation, confidence glissée par l'un des trois amis de toujours dans un moment de franche camaraderie que le saké excite: « C'est un dilemme: quand on perd ses enfants, on est malheureux. Mais quand ils vivent, ils deviennent trop lointains.» Le dilemme donc. Il régit les rapports entre les personnages et est formellement représenté par les fréquentes alternances champ contre-champ, créant ainsi un subtil dialogue entre fond et forme qui révèle la maîtrise filmique du cinéaste et la profondeur de la réflexion qu'il soulève. En effet, malgré l'apparente fluidité du quotidien banal et monotone des personnages, le dilemme est tapi sous leur destin tragique auquel ils ne peuvent échapper puisqu'ils sont confrontés à des choix qui ont pris le dessus sur leur volonté, si bien qu'ils se retrouvent pris dans le courant de leur vie sans pouvoir les contrôler. Ils ont donc tous perdu leur liberté, prisonniers de décisions que leur imposent des facteurs extérieurs.
Prenons par exemple les enfants, qui, lorsque leurs parents viennent leur rendre visite, ne peuvent leur consacrer le temps que ces derniers mériteraient, car leurs propres enfants, leurs obligations professionnelles, la nécessité impérieuse de réussir dans une société obnubilée par l'ambition leur accaparent leur temps, les rendant esclaves de ce système qui les aliène. Ou encore, les anciens qui sont tiraillés d'un côté par le désir de se rapprocher de leurs petits-enfants et de l'autre par la volonté de les laisser vaquer à leurs occupations (le petit-fils étant lui-même forcé de faire ses devoirs, au lieu de parler avec ses grands-parents, pour faire perdurer le cercle vertueux de la réussite, lui dont le père a obtenu un doctorat pour devenir médecin). De même, ils sont contraints de rester seuls alors qu'ils voudraient pouvoir partager plus avec leurs propres enfants mais ceux-ci sont en voyage d'affaires, doivent s'occuper de patients gravement malades ou recevoir les clients qui ont déjà pris des rendez-vous. Il y a aussi le cas de la belle-fille veuve qui, dans ses nuits hantées par la solitude et le désir, rêve de retrouver un autre homme mais demeure seule sous le poids des convenances. Ou encore les hommes qui aiment boire et sortir avec leurs amis mais qui se rappellent aux réprimandes de leur femme ou de leur fille.
Ce n'est qu'à la fin, lorsque le père perd sa femme et que les enfants quittent le foyer, qu'il se retrouve enfin seul avec lui-même. Alors le temps lui est offert et la liberté totale, dont l'image de la fumée de l'encens qui se consume lentement est une métaphore visuelle, devient accessible. Or, en même temps, il ressent le vide vertigineux qui a pris place en lui et confie à sa voisine «le temps est bien long maintenant qu'elle est partie». Et c'est ce même vertige dont fut saisi la mère devant l'immensité de la mer (ici symbole de la liberté) qui l'avait conduit lentement à la mort. Dernier dilemme donc, celui entre la liberté et la mort.