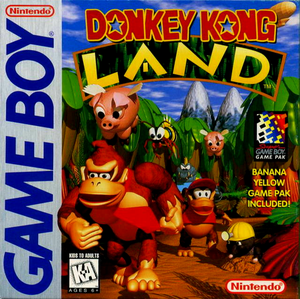Il est plutôt amusant de s’apercevoir comment les narratifs semblent parfois se croiser. Presque comme s’il existait une quasi forme de loi naturelle de la création vidéoludique. Tenez. Prenez les emblématiques Jo-John : Carmack et Romero. D’un côté la rockstar. Le créatif. Mais un créatif instable, qui à force de briser les murs des conventions finissait par avoir la fâcheuse tendance à oublier de consolider des fondations stables. Heureusement, Carmack était là. Le programmeur. Le nerd. C’est lui qui maintenait l’équilibre général de leurs créations, et qui savait faire prendre vie aux fulgurances Romeroèsque. Voilà. Cette histoire, vous la connaissez. Ce duo, cette alchimie, elle a accouché des intemporels Wolfenstein 3D, Doom, et Quake. Mais ce modèle quasi archétypal du duo fondateur, figurez-vous qu’on le retrouve autre part aussi. Outre-manche, pour être plus précis.
Prenez les deux gars derrière le studio Ultimate Play the Game. Qui deviendra plus tard la branche spécialisée dans la création de jeux pour la NES, Rare Software. À force de génie et épaulés par leurs camarades nippons Nintendo, ils décidèrent dans les années 90 de ressusciter un certain macaque bien vendeur. Un macaque qui, jadis, avait chamboulé le monde de l’arcade pour finalement donner naissance à ce qui reste encore aujourd’hui l’une des meilleures séries de plateformers 2D jamais conçues, et accessoirement l’une des plus grandes claques graphiques de son époque. J'ai nommé : les frères Stamper.
Et là, je vous les donne en mille. D’un côté, Christopher, dit Chris, l’aîné. Passionné de technologie, au point d’avoir construit son propre PC pour apprendre à coder. Rien que ça. De l’autre, Tim, le cadet : l’artiste, le designer. Même leurs personnalités semblaient faites pour se compléter. L’un, logicien pragmatique et force tranquille. L’autre, débordant d’énergie et d’idées. Une alchimie qui, comme les Jo-John, a façonné l’histoire du jeu vidéo.
Après tout, peut-être que ces deux duos, qu’ils soient frères de sang ou de circonstances, ne sont pas si différents. Peut-être que c’est simplement une histoire trop belle pour ne pas être racontée, trop parfaite pour ne pas marquer les mémoires. Peut-être aussi que la nature aime l’équilibre, dans les forces comme ailleurs. Et certainement que c’est un peu de tout ça.
Mais je m'égare.
Ah non, attendez. Puisqu’on parle de poncif narratif, j'en ai un autre. Le garage. Ce lieu, qui pour le commun des mortels n’est censé abriter que des cages en métal (et des hérissons écrasés), semble s’être imposé comme le berceau légendaire des plus grands empires technologiques : Steve Jobs et Steve Wozniak pour Apple, Larry Page et Sergey Brin pour Google, ou encore Jeff Bezos pour Amazon. Il est devenu le symbole de l’ingéniosité brute, d’un espace où les idées, à force de bricolage et de détermination, se transforment en révolutions. C'est bô.
Mais ça, oui ma bonne dame, c’est un narratif. Les plus sceptiques, ou peut-être les moins rêveurs, dira-t-on, savent qu’il s’agit en grande partie d’un mythe habilement construit. Un récit destiné à vendre l’idée que ces génies étaient partis de rien : ni capital, ni réseaux, ni héritage familial. Juste de la sueur, du talent et un vieux cagibi pour tout atelier. Un conte pratique, en somme, pour nourrir d'une part l’espoir que chacun, avec un peu d’effort, pourrait tout à fait réitérer leur succès, et d'une autre pour justifier en retour que ces astucieux cocos n’aient point à s’alourdir d’impôts, puisqu’après tout, ils sont tellement au-dessus de nous, des routes et des hôpitaux.
Bah figurez-vous que pour en revenir à nos English Men, les Stamper, bah eux c’était pas un garage qu’ils avaient. C’est une fucking ferme du XVIIIᵉ siècle, avec tout ce que ça impliquait de gigantisme. Un cadre rural qui leur offrait alors un environnement propice à la créativité et à l'innovation. Mais un environnement d’une envergure bien plus modeste qu’un autre lieu emblématique de la création vidéoludique d’époque. Je parle bien évidemment du légendaire Skywalker Ranch de George Lucas. Les narratifs qui se croisent, tout ça, tout ça. J'ai un fil conducteur à tenir moi.
Pour rappel, le Skywalker Ranch, situé en Californie, est réputé encore aujourd’hui pour ses installations de pointe dédiées à la production cinématographique et sonore. On s’en rappelle notamment pour la conception des films Star Wars, où il a joué un rôle crucial dans la postproduction, notamment en matière de montage et de mixage audio. Les Jurassic Park aussi, qui ont bénéficié de l'expertise du Skywalker Ranch pour leurs effets sonores, ainsi que Nemo et autres Toy Story.
Et en ce qui concerne le jeu vidéo, parce que c’est tout de même pour ça que je vous fais une énième parenthèse avant d’aborder le vrai sujet de cette critique (enfin, c’est ce que vous pensez), c’est là-bas que naquit un certain Maniac Mansion, développé par Lucasfilm Games, qui sera connu quelques années plus tard, au début des années 90, sous le nom de LucasArts. La légende retient même que le manoir fictif du jeu s'inspirait de l'architecture de la maison principale du Skywalker Ranch. Les développeurs, Ron Gilbert et Gary Winnick, y ayant puisé des éléments spécifiques, notamment la bibliothèque avec son escalier en colimaçon et la salle multimédia.
Maniac Mansion, qui deviendra un pionnier à part entière du genre point-and-click, marqua également l’introduction d’un moteur révolutionnaire pour l’époque : le SCUMM (Script Creation Utility for Maniac Mansion), conçu pour simplifier la création et l’interactivité dans les jeux d'aventure. Ce moteur servira de fondation technologique pour de nombreux jeux emblématiques développés par la firme dans les années suivantes, tels que la saga Monkey Island, Indiana Jones et Le Mystère de l'Atlantide et Day of the Tentacle. Véritable pierre angulaire du genre, Maniac Mansion a marqué à la fois l’histoire des jeux vidéo et celle de Lucasfilm Games par son innovation et son humour décalé.
Rare, même si ce ne sont pas les seuls à l’avoir été, c’était donc avant tout un duo fondateur qui se complétait bien, le tout dans un environnement de création bien particulier. J’aurais pu également mentionner que ces deux-là étaient de véritables bourreaux de travail, qu'ils étaient considérés comme des génies par leurs pairs, et qu'un vrai esprit de famille semblait régner dans cette petite communauté de créateurs, mais vous devez certainement commencer à en avoir marre d’apprendre toutes ces merveilleuses banalités sur l’histoire du jeu vidéo, donc on va passer à notre macaque préféré.
Carts, farts, marts, darts
Rare, c'est ainsi synonyme de Donkey Kong Country. De Battletoads. De Killer Instinct. De Banjo-Kazooie. Tant de jeux et de licences sur lesquels j’aurais pu inonder d'éloges à ne plus savoir quoi en dire cette page. Mais aujourd’hui, outre des parenthèses infinies, j’avais surtout envie de vous parler de Donkey Kong Land 1. Parce qu’il me fascine le bougre. Comme l’histoire de ce studio, tout simplement.
Regardez. Rare venait tout juste de produire Donkey Kong Country sur Super Nintendo, un jeu révolutionnaire qui avait explosé toutes les attentes. Les graphismes pré-calculés en 3D, réalisés grâce au Silicon Graphics (la pointe de la technologie de ce qui se fait à l’époque, si vous voulez) avaient permis de faire entrer la SNES dans une nouvelle ère visuelle, alors que la 3D de la N64 allait pas tarder à pointer son trident. Le gameplay, tout aussi peaufiné que les visuels, avait redéfini ce que pouvait être un jeu de plateforme à l'époque. Le succès était colossal, avec des millions de copies vendues et une véritable renaissance pour la licence Donkey Kong, qui avait déjà considérablement marqué le monde de l’arcade lors de la décennie précédente.
Nintendo, voyant un potentiel immense, voulait étendre cet univers à la Game Boy, la console portable phare de la maison. Rare se retrouva donc face à un défi de taille : adapter l’esprit de Donkey Kong Country à une machine beaucoup plus modeste, avec un écran monochrome et des capacités techniques limitées. Mais les Stamper, jamais en manque d’audace et d'argent facile, acceptèrent le projet.
C’est ainsi qu’est né Donkey Kong Land, conçu comme un prolongement de Donkey Kong Country et non comme une simple transposition. Pour relever le défi technique, l’équipe s’est appuyée sur des outils internes innovants et a fait des compromis intelligents pour préserver l'essence du jeu, tout en exploitant au maximum les capacités de la Game Boy. Le jeu offrait de nouveaux niveaux, une expérience unique sur portable, et un gameplay aussi robuste qu’épuré. Comme son grand frère, en fait. Et c'est bien pour tout cela qu'il mérite à mon sens une critique à part entière. Même si la plupart s’en rappelle comme d’une énième torture pour les yeux et les doigts, comme une bonne partie du catalogue de la gameboy.
Hearts, starts, carts, marts
Le premier truc qui saute aux yeux quand on lance Donkey Kong Land, c’est à quel point ça manque de vie. Bordel. Toute la merveilleuse palette des jusqu’à 256 couleurs simultanées de la SNES, mobilisée à la perfection pour créer ce qui était jusqu’alors la plus belle jungle luxuriante jamais conçu dans un jeu vidéo (non mais sérieux, relancez-moi ça tout de suite si ça ne vous dit rien), a été troquée sur l’autel des ignobles nuances de noir et blanc de la Game Boy. Mais bon voilà, c’était comme ça. La Game Boy n’avait pas les moyens techniques d’offrir une expérience visuellement comparable à sa grande sœur de salon. Alors forcément, quelque chose devait se perdre en cours de route.
Les niveaux, autrefois vivants et denses, deviennent alors des décors parfois mornes, où l’œil a du mal à distinguer le personnage principal des plates-formes et des obstacles. Les arrière-plans détaillés et animés du jeu SNES cèdent la place à un vide statique. Même les personnages eux-mêmes (Donkey et Diddy Kong), malgré un gros travail d’adaptation pour maintenir leurs modèles reconnaissables, souffrent de l’absence des subtilités des dégradés de couleurs et des animations qui leur donnaient un véritable souffle de vie.
Pourtant, c’est là que réside la véritable prouesse de Rare. Ils ont réussi, contre toute attente, à restituer un peu de l'âme de Donkey Kong Country dans ce format monochrome. Les sprites conservent des proportions correctes, l’animation reste fluide pour les capacités de la machine, et on sent que Rare a bataillé pour tirer parti de chaque bit de mémoire disponible. Certes, l’ensemble manque cruellement de variété, mais les nuances de gris sont exploitées de façon habile pour donner une profondeur inattendue aux environnements.
Le plus fou, c’est que ce parti pris finit par provoquer quelque chose d’étonnant : au lieu d’imiter bêtement son grand frère, Donkey Kong Land se façonne une identité propre. On passe d’une jungle foisonnante à un univers qui semble presque... onirique ? Une sorte de version fantasmée du jeu original, vue à travers le prisme limité de la Game Boy, et qui vient titiller nos souvenirs de la SNES. C’est à la fois frustrant et fascinant. Et bien que ce soit imparfait, cet effort titanesque pour adapter un univers aussi ambitieux sur une machine aussi modeste force à minima le respect.
Les règles en matière de gameplay ne sont pas les mêmes non plus. Encore une fois, Donkey Kong Land n’est pas une simple réplique portable de Donkey Kong Country, et cela se ressent immédiatement. Rare a dû ajuster les mécaniques et la structure des niveaux pour les adapter aux contraintes techniques de la Game Boy, mais aussi aux conditions dans lesquelles on joue à une console portable.
D’abord, l’écran de la Game Boy est beaucoup plus petit que celui d’une télévision. Cela veut dire que le champ de vision du joueur est réduit, ce qui rend les mouvements et les réflexes encore plus difficiles à gérer. Rare a tenté de compenser en simplifiant la disposition des obstacles et en limitant le nombre d’éléments affichés en même temps à l’écran. Mais ce choix a parfois un coût : les niveaux paraissent moins fluides, avec des ennemis qui surgissent de nulle part ou des pièges qu’on découvre un poil trop tard. Résultat, le jeu demande plus de mémorisation que son prédécesseur et peut frustrer par des morts évitables uniquement après plusieurs essais. Donkey Kong Country n’était pas un Die and Retry. Sauf peut-être le temps de se faire aux infernaux tonneaux volants. Land par contre, c’est pas la même limonade.
Ensuite, les mécaniques du gameplay pur ont été légèrement modifiées. Par exemple, les sauts des personnages semblent plus "lourds", probablement pour compenser la latence d’affichage et garantir un contrôle plus précis dans les phases de plateforme. Cependant, cela ralentit un peu l’action frénétique qui faisait la force de Donkey Kong Country, donnant à Donkey Kong Land une cadence plus posée. Parfois, au détriment du dynamisme.
Les bonus et secrets, éléments essentiels dans Donkey Kong Country, sont toujours présents mais bien moins nombreux et souvent moins complexes. Là où la version SNES faisait preuve de créativité avec des niveaux à embranchements et des cachettes ingénieuses, Donkey Kong Land simplifie tout cela. Les limitations techniques de la Game Boy rendaient impossible la gestion de vastes zones secrètes ou de passages dissimulés avec subtilité. Ce choix, s’il est compréhensible, a pour effet de réduire une partie du plaisir de l’exploration.
En revanche, Rare a conservé l’aspect collecte, avec les lettres KONG à rassembler dans chaque niveau. Ces lettres n’ont d’ailleurs jamais été aussi importantes dans la série. En effet, alors que Country reposait sur un système plus adapté pour des sessions de jeu longues et intenses sur une console de salon, avec un Candy Kong qui nous accueillait pour sauvegarder tous les x niveaux, Donkey Kong Land se devait d’avoir une approche bien différente.
Chicken, chicken, chicken
Dans Donkey Kong Country, les lettres KONG étaient des éléments collectables dans chaque niveau, qui servaient surtout à débloquer des vies supplémentaires, tout en étant un indicateur de la performance du joueur. C’était un objectif complémentaire qui permettait de prolonger son expérience, et de viser le sacro saint 100 %. Cependant, dans Donkey Kong Land, la philosophie est quelque peu modifiée. Car à chaque fois que vous ramassez les 4 lettres dans un niveau, vous obtenez en plus la possibilité de save. A l’inverse, si vous êtes plus du genre à foncer tête baissée sans prendre les risques inhérents à la récolte des lettres, et c’est sanction immédiate. Ce système s’adapte parfaitement aux sessions plus courtes d’une version gameboy, même s’il a ses limites. Rien n’empêche en effet le joueur de revenir à un niveau précédent plus facile, histoire de le terminer rapidement, et donc d’avoir une sauvegarde gratuite (autant vous dire que je repartais souvent du tout premier niveau lolilol). Mais l’idée reste louable.
En plus du système de sauvegarde, c’est le système de vies qui est aussi ici revu. On retrouvera toujours les habituelles 100 bananes qui font une vie, ainsi que les ballons à tête de Kong qui flottent de temps à autre, même s’ils sont cette fois-ci bien moins nombreux. Mais le véritable ajout, c’est un étonnant système de jetons. En effet, la plupart des niveaux bonus cachés vont contenir des jetons. On va au début les collecter, sans trop savoir à quoi ils servent. Surtout que l’habituelle interface épurée de nous donne aucune information sur le nombre total collectée à un instant T. Jusqu’à ce que l’on tombe sur une autre zone secrète, plus rare cette-fois, qui nous autorise au travers d’un mini-jeu de mettre littéralement en jeu ces jetons pour espérer obtenir des vies.
J’avoue que le principe est plutôt amusant au début, et tranche avec celui plus classique de Donkey Kong Country. Le problème, c’est qu’il s’agit toujours du même mini-jeu. Et que pour une raison qui m’échappe, autant j’ai eu le sentiment d’en avoir beaucoup trouvé pour les premiers mondes, autant j’ai vraiment eu l’impression qu’ils avaient complètement disparu à un moment. Dommage de ne pas avoir plus développé cette idée.
Dernière grosse différence avec sa grande sœur : sa durée de vie. C’est simple, je l’ai refait il y a quelques jours, et c’était plié en 5 heures à peine à 100 % (le temps réel in game, pas celui tronqué affiché par la save, hein). On reste un peu sur sa faim, avec ces 4 mondes qui reprennent en très grande partie ce que Country avait déjà instauré : la jungle, les monts enneigés, l’eau, le temple. Avec le petit niveau qui rajoute une réelle touche de fraîcheur : Big Ape City. Une grande ville, comme son nom l’indique, avec son lot d'échafaudages qui n’est pas sans rappeler le quotidien de ce cher Cranky Kong, bien des années auparavant, sur borne d’arcade. Et les musiques y sont incroyables. Sérieusement. Déjà que David Wise (accompagné ici par un certain Graeme Norgate) avait réussi à proposer des reprises très convaincantes de son incroyable travail Country, il parvient en plus à nous régaler avec des pistes inédites qui s’insèrent parfaitement dans la composition d’ensemble. Le tout sur Gameboy, que c’est beau.
Enfin, quelques reproches. Parce que oui j’en ai tout de même quelques-uns. Déjà la courbe de difficulté. Le jeu envoi du pâté dès les premiers niveaux sans qu’on comprenne trop pourquoi. Le deuxième nous envoie directement sur un niveau qui n’apparaissait normalement qu’à partir du monde 4 dans Country (exit aussi du coup la cohérence de l'univers, mais c'est que dans le premier monde donc it's okay). Pas très accueillante la bestiole, surtout lorsque l’on y ajoute les limitations en termes de lisibilité susmentionnées de la Gameboy.
Aussi, les boss. Pas un seul de mémorable, avec un concept un minimum accrocheur. Déjà que Country était avare de ce côté-là, ici c’est la mer morte niveau contenu. Même le boss final, King K. Rool himself, ne daigne emprunter que deux moveset à celui de Country. J’avoue que je n’aurais pas craché sur un poil plus de difficulté. Même si difficulté et Gameboy ça fait pas toujours bon ménage.
Stop
Au-delà de ces quelques détails, Donkey Kong Land reste une adaptation plus qu’honorable de Country sur Gameboy. Rare est parvenu une fois de plus à montrer tout son savoir-faire en matière de compréhension de ce que se doit d’être un bon jeu vidéo, le tout sous les contraintes d’une machine plus que limitée. Alors on ne le retiendra certainement pas comme la meilleure itération du singe à cravate. Au même titre que ses suites, dont je m’empresserai de papoter à l’occasion. Mais pour ce qu’ils avaient entre les mains, c’est clairement plus qu’honorable.
Si vous souhaitez y jeter un coup d’oeil aujourd’hui dans des conditions et confortables et légales (je ne vous jetterai pas la pierre, moi aussi j’ai un passif de vil gredin), Nintendo a tout pensé pour vous, avec le *roulement de tambour* Switch Online. La version GB prend même en compte les tonalités de brun ajoutées avec la Color, ce qui ajoute un peu de visibilité à tout ce bousin. Que demande le peuple ?
Quoi ?
Les Kremlings au parc Donkey Kong ?