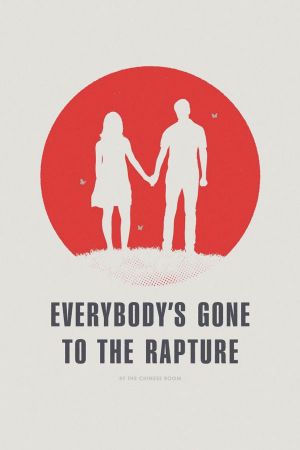Ils l’ont fait.
Persévérer aux antipodes des standards actuels et poursuivre sur la voie du cœur. Quand Lara Croft ne peut plus rentrer dans une paillote sans faire exploser le village. Quand la course à l’open world nous promet monts et merveilles de possibilités inutiles. Quand la frénésie a sacrifié l’ambiance sur l’autel de la frime spectaculaire... Un petit studio anglais continue sur son chemin.
The Chinese Room persiste et signe en dépouillant le gameplay de tout accessoire et de (quasiment) toute interaction physique. Ce qui doit jouer, ce n’est pas ces pouces aplatis qui s’excitent sur trois boutons pour qu’un héros sexy, ténébreux, gouailleur, mauvais garçon au grand cœur et à la barbe de trois jours (rayez la mention inutile)… assemble un rouleau de scotch et une canette de bière pour en faire une grenade. Ce qui doit jouer c’est l’émotion.
Les sentiments comme guides.
Les mêmes qui reprochaient à Dear Esther sa marche forcée hurlent au scandale de ne pouvoir sprinter à travers les massifs fleuris pour se mettre à couvert derrière une balançoire. Et qu’en a-t-on à foutre de pouvoir renverser un verre ou de faire bouger un ballon sur une pelouse ? C’est ne pas comprendre l’importance capitale de la lenteur, du rythme et de l’impuissance dans la montée émotionnelle. La moindre énigme à la noix viendrait faire dérailler cette mécanique. Laissez l’ouverture des tiroirs à la concurrence; l’histoire contée se passe bien de toutes ces tentatives dont l’objectif est d’artificiellement occuper un joueur qui n’est plus capable de simplement profiter du paysage et de ce qu’on lui raconte.
Car il faut entendre. Non. Il faut écouter. La vie de ces personnages se passe d’images. Elle se devine, non pas via ces silhouettes cryptiques, mais par ces voix (et quelles voix !). Par ce qu’elles disent mais surtout par ce qu’elles n’expriment pas explicitement. Les émotions de ces disparus qui n’existent plus qu’à travers des sentiments figés dans le temps sont la clé. Qu’il soit question de vie ou de mort, d’apaisement ou de souffrances, de fin ou de commencement ; il reste toujours l’amour reliant chaque interprétation.
L’amour, même, pour une splendeur de direction artistique ; pour une orchestration merveilleusement puissante et d’une grâce rarement entendue (que la reine anoblisse Jessica Curry !). L’amour pour une œuvre poignante, belle et riche de son humanité. Une œuvre dont la seule et immense ambition est de raviver la lumière du cœur.
Qu'Everybody's Gone to the Rapture soit mon autre...