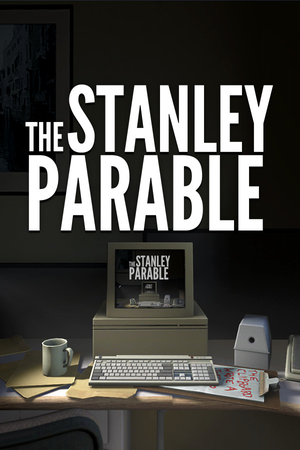Le jeu-vidéo n'est pas (encore) un art, n'en déplaise aux ludophiles en herbe qui aimeraient en persuader leurs parents afin de pouvoir passer des nuits blanches à fragger tranquillement. Je n'ai pas l'impression qu'une véritable grammaire ait encore émergée, et la majorité de la production s'embourbe inlassablement dans une vaine recherche de la recette-miracle-qui-marche-à-tous-les-coups, à grand renfort de clins d’œil appuyés au cinéma. Mais il y a tout de même de rares exceptions, des anomalies qui nous tombent dessus sans prévenir et remettent en question ce que l'on croyait acquis, que ce soit au niveau de la sensation de liberté, des méthodes de narration ou de la question de but pour le joueur. The Stanley Parable prend justement le soin d'en citer deux (à vous de les trouver) de façon très pertinente pour nous faire cogiter là-dessus.
Dans The Stanley Parable on écoute, on regarde et parfois, on appuie sur un bouton. Chaque partie commence de la même façon : on déambule dans des bureaux déserts pendant qu'un narrateur commente nos moindres faits et gestes, de la première porte que l'on pousse jusqu'à l'impasse inéluctable qui constitue l'une des fins, tandis que le narrateur défonce allègrement le 4ème mur.
Puis on recommence.
Ce n'est pas une "aventure interactive" puisqu'il n'y a ni quête, ni difficulté, ni chevauchée sauvage romanesque. Ce n'est pas non plus un jeu d'exploration. Pour ça, il aurait fallu que ce soit un jeu. Si le narrateur tient à nous faire croire qu'il s'agit bien là d'un jeu (du moins au début), c'est pour mieux en déconstruire certains codes et se moquer de nos réflexes prévisibles. The Stanley Parable n'est ni un jeu, ni une oeuvre d'art. Mais c'est un concept génial, commentaire performatif in situ d'un médium et de ses limites.