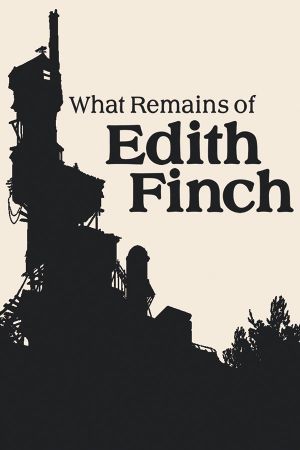J’ai commencé What remains of Edith Finch juste après avoir abandonné La Maison dans laquelle. Pour ceux qui serait passé à côté de ce « roman monde », il s’agit un pavé à propos d’une maison dont la protéiformité dépend du point de vue de son narrateur, généralement un adolescent porteur d’un handicap. Ses résidents, intenses et borderlines, sont les garants de règles qui n’appartiennent qu’à leur univers. Chaque crevasse dans le mur, chaque reflet imparfait rend la bâtisse organique, dotée d’une conscience propre.
Le bouquin m’est tombé des mains.
La faute à la première édition d’une traduction pleine de bonne volonté mais encore lacunaire, à l’effort requis pour redéfinir les traits de personnages et de pièces décrits trop tardivement, à un univers sibyllin dont les mystères n’ont jamais su m’intriguer suffisamment, la faute à Murakami qui a fini d’émousser ma curiosité pour les arcanes. Il est de ces phénomènes qui semblent transformer tout le monde autour sans jamais vous atteindre.
Chaque pas dans la maison de What remains of Edith Finch aurait pu me rappeler le roman de Mariam Petrosyan, chaque pas m’en a éloigné. Avec une infinie justesse, son gameplay se décline en plusieurs exercices de style adaptés à chaque histoire, à chaque personnalité d’une famille frappée par un maléfice absurde qu’on peut résumer ainsi : sitôt qu’on vit, on est assez vieux pour mourir.
Les disparitions sont rapidement si nombreuses, toujours inéluctables, que le deuil, devenant secondaire, rejoint un canevas plus large d’interrogations sur notre opiniâtreté à donner la vie et à la modeler dans un tourbillon qui nous laisse toujours impuissants.
Je me suis pris la fatalité de plein fouet. Je me suis pris nos réactions vis-à-vis de la fatalité de plein fouet. En mettant mes pas dans ceux des Finch, en me poussant à accompagner leurs gestes organiques, en regardant mes pieds pour détailler le personnage que je campe, j’ai vécu leurs tragédies et leurs superstitions, leurs grandeurs et leurs failles. Je suis devenu un Finch.