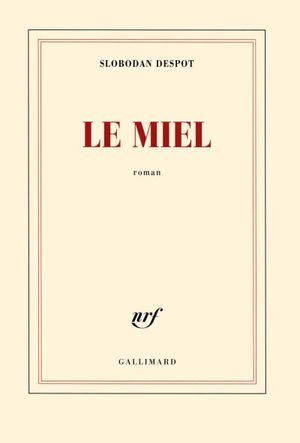Le premier roman de Slobodan Despot nous emmène dans la Krajina, république serbe coincée en pleine Croatie, lors de l’opération Tempête qui, en 1995, obligea les habitants à fuir devant les troupes croates. Le récit nous est conté par l’herboriste Vera, qui raconte au narrateur, un Serbe ayant vécu en Suisse, l’histoire de Vesko le Teigneux parti à la recherche de son père, le vieux Nikola, oublié en Krajina au moment des troubles et resté seul dans sa petite maison avec ses ruches. Laissant sa famille en sûreté en Serbie, il prend la route, aidé par Lossev, un Russe combinard qui lui fournit de faux papiers, et pénètre au cœur du territoire ennemi sous l’identité d’un inspecteur de l’ONU. Oscillant sans cesse entre la peur d’être arrêté, la nostalgie des temps de paix et la résignation – ce « fatalisme désinvolte tenant lieu de sens commun sous ces latitudes » – Vesko est aussi hanté par la honte. Honte de ne pas être comme son frère Desan, qui s’est battu durant la guerre, une honte mêlée de jalousie. « Il n’avait rien à foutre de leur guerre, non, ni de leurs idées – n’empêche : il les enviait ! Il crevait d’envie ! Avant de mourir, avant de transformer le pays en champ de ruines et d’endetter tous leurs descendants, ils auraient vécu, eux ! » Honte aussi face à ce vieux père qu’il a sans doute négligé et qui, aujourd’hui, malgré son âge et son isolement social, semble mieux se débrouiller que lui dans cette terre chaotique en proie aux luttes intestines. « Mais la terre ne signifie plus grand-chose, déplore le vieil apiculteur. Jadis, nos gens se faisaient tuer pour elle. Mais c’est une drôle d’époque, un temps de lièvres. » Là où, en temps de crise, le fils planifie tout et se laisse prendre par la panique, le père, mutique et impassible, improvise et se tire des situations les plus délicates. Chargeant la voiture de pots de miel, il lâche du lest au fur et à mesure du voyage, les utilisant comme bakchich au gré des obstacles de la route.
Le roman, remarquable par la qualité de ses dialogues, est émaillé de considérations diverses, sur l’instrumentalisation des ONG ou sur les différences esthétiques entre les imageries catholique et orthodoxe. En écho à la plainte de Nikola regrettant que « les gens ne savent plus rien faire pour autrui, même pas mourir », Vera, tirant la morale de son récit comme d’une fable, nous rappelle que dans la paix comme dans la guerre, chaque geste compte.