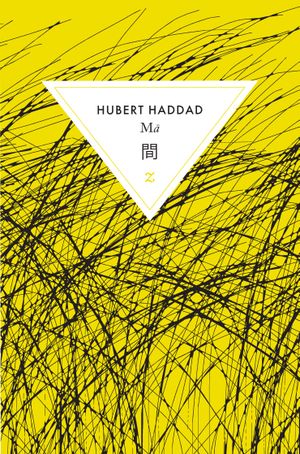«C’est au Café Crépuscule que j’ai rencontré Saori, voilà quinze ans, sept mois et trois jours.»
Le cours de l’existence de Shōichi, jeune étudiant maigre au regard de myope, avec ses lunettes à verres «larges comme des soucoupes», fut transformé le jour où la rayonnante Saori passa la porte du minuscule bar du quartier de Golden Gai où il servait le week-end. Jusque-là le jeune homme menait une vie plutôt recluse, en tête-à-tête avec une mère tournée vers son passé. À cause de «son air de hibou surpris en plein jour», de son allure et de son prénom semblable à celui du poète Santōka Shōichi Taneda, Saori, universitaire prise d’une indéfectible passion pour cet auteur méconnu, remarqua le jeune homme.
Leur aventure éblouissante mais à la fin tragique jettera Shōichi sur les routes et les traces de Santōka, moine vagabond talonné par l’abîme et dernier grand haïkiste, s’oubliant dans l’ivresse.
«La marche à pied mène au paradis : il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir, mais il faut marcher longtemps.»
Accompagné de la biographie romancée de Santōka écrite par Saori, Shōichi, toujours face au puits de douleur sans fond issu de son enfance, le décès de sa mère, en marchant se confond avec lui – à travers leurs déboires, leur goût pour le saké, les haïkus et la contemplation de l’impermanence du monde.
«Depuis bien des années, je marche pour ne pas mourir, d’un bout à l’autre de Honshu et dans les autres îles, celles où l’on ne risque pas de rattraper la queue de son ombre après un jour ou deux. Ma mémoire est mon seul fardeau, le plus lourd en tous cas, pesant comme un cadavre de femme. Un jour à venir, l’été, dans la montagne aux cigales, l’oubli me gratifiera de ses doux bûchers de lucioles ou tout ce que l’on croyait aimer s’efface en cendres bleues avec la nuit montante. On pourrait croire que je cours après mon passé mais c’est bien pire. Je me souviens du dernier soir comme si c’était demain.»
La belle écriture de «Mā», nourrie des haïkus des maîtres Bashō et Santōka sertis dans le récit, s’illumine avec les descriptions délicates et somptueuses des espaces naturels, champs de neige et fougères palpitantes, lumière sur les feuillages, contrepoint des tragédies et souffrances humaines – parmi lesquelles l’évocation du séisme du Kantô de 1923 constitue un morceau de bravoure, tragédie dont Santōka tentera, comme les autres qui l’affectent, de se détacher sur les sentes japonaises.
«Toujours à divaguer dans le malheur absolu, perdu, les yeux pleins du sang des pauvres gens, Santōka invoque presque malgré lui Bashō pérégrinant d’une montagne sacrée à l’autre sur les pas d’un maître d’antan.»
En une étonnante osmose de deux vies distantes de près d’un siècle, ce roman à paraître en septembre 2015 aux éditions Zulma, évoque la permanence des douleurs des enfants aux cœurs déchirés par les abandons et l’amour perdu, la beauté de la nature, du mouvement immobile et de la poésie qui permettent de vivre malgré les plaies profondes, et la brièveté de l’existence envolée comme un souffle.
«Les naufrages dont il était sorti indemne lui laissaient un goût d’infini aux lèvres. La chose la plus ordinaire, comme boire à la fontaine ou s’asseoir dans l’herbe, lui semblait si neuve, si propre à toutes les réconciliations, que l’instant en devenait pareil au pistil d’une fleur à peine éclose.»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/08/01/note-de-lecture-ma-hubert-haddad/