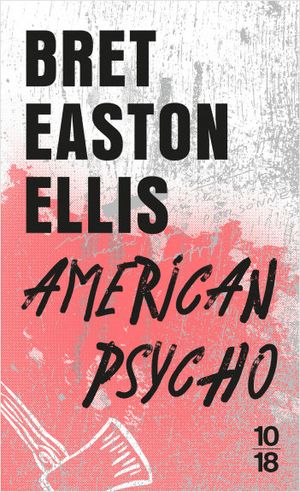Dès les premières phrases, le ton est donné; futurs lecteurs d'American Psycho, vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds. Mais quelle que soit votre appréciation du livre, soyez certains que ce ne sera pas agréable.
Parce que cet ouvrage est en grande partie un livre d'atmosphère, le cauchemar énoncé dans le titre de cette critique poindra très progressivement: cependant, dès le début ( pourtant laborieux et sans enjeux précis) le lecteur peut ressentir un léger sentiment de malaise. Malaise qui vire peu à peu à l'angoisse.
Il y a d'abord l'écriture: millimétrée et chirurgicale, presque inhumaine en fait, elle suffit à elle seule à amorcer la dissection de cet effrayant milieu. Lorsque Bateman nous décrit, sur quatre pages, son appartement ou sa toilette matinale, de la manière la plus précise possible, on ne peut s'empêcher d'être fasciné: on sent en effet une logique, une profondeur, dans cet étalage de superficialité. De fait, chaque scène, aussi inutile qu'elle puisse paraître, est une pierre de plus pour un édifice monstrueux.
Il y ensuite les personnages: au premier abord, l'entourage de Patrick Bateman, son univers en fait, dont il ne sort jamais, ne suscite que l'ennui et un léger dégoût: qui aurait envie de s'attacher à ces gosses de riches superficiels à la vue courte, de se passionner pour leur suite d'activités ultra-vaines dans les lieux les plus huppés, le tout rappelant vaguement une certaine Hell (en mieux écrit et bien moins brouillon ceci dit)? Le truc c'est qu'on comprend assez vite pourquoi il est question de "psycho": leurs obsessions paraissent anormales, tordues. Leur complet repli sur eux-mêmes nous enferme dans leur monde, sans échappatoire possible. Et plus que vains, leurs dialogues sont tout simplement délirants: ils ne s'écoutent pas parler, monologuent tous seuls, semblent avoir perdu tout contact avec la réalité. On a de plus en plus envie de se mettre à crier: "Mais tout cela n'a aucun sens ! " L'exemple le plus significatif est sans doute celui-ci:
-Je veux...réduire le visage d'une femme en bouillie, avec une grosse brique bien lourde.
-Mais à part ça? demande Hamlin, gémissant d'impatience.>
Si on y ajoute le cadre dans lequel ce peuple malade évolue (un New York froid, oppressant, prédateur, hanté çà et là par quelques clochards, victimes toutes trouvées pour un Golden boy pervers), on peut dire qu'un réel spectacle d'horreur se déroule sous nos yeux, bien avant que les massacres ne commencent.
Les meurtres sont ignobles, c'est certain. Mais ils sont décrits d'une manière si routinière, et le décor planté nous terrifie déjà tellement, qu'ils ne nous paraissent n'être que la continuité logique de ce monde devenu fou. La seule chose qui différencie Bateman de ses semblables sont les "bonnes manières", comme indiqué dans une citation servant à ouvrir le roman. Pour le reste, il y a longtemps que ce système a perdu son humanité: il n'y a qu'à voir le meurtre de Paul Owen rapidement étouffé, et son appartement revendu aussi vite (et rempli de fleurs, bien sûr, pour cacher l'odeur de pourriture); et si la société avait autant tué Owen que Bateman?
C'est en cela, d'ailleurs, que le personnage de Bateman nous paraît terriblement schizophrène: représentant le plus parfait de cette génération désœuvrée, sans autres repères que l'argent et ce qu'il achète, il en est pourtant, dans une certaine mesure, le pourfendeur le plus féroce, contrant la sauvagerie civilisée dont elle fait preuve par une autre sauvagerie à l'état brut (un bon exemple du colosse aux pieds d'argile qu'est la civilisation américaine moderne, qui se détruit elle-même, de l'intérieur). Sa grande contrariété, qu'il nous explique sur la fin, vient justement du fait que malgré ces meurtres, rien ne change, même pas lui. La société avale tout, et devient une nouvelle forme de nature, enlevant tout libre-arbitre aux gens qui la peuplent; plus personne n'est libre de ses actes. Même Bateman, qui croyait peut-être avoir trouvé une solution en se faisant serial-killer, se retrouve prisonnier de ses pulsions, sortant d'une aliénation pour retomber dans une autre (à l'image, d'ailleurs, du héros de Fight Club, lequel traite peu ou prou de la même thématique). On en vient même, finalement, à éprouver, sinon de la sympathie, au moins de l'empathie pour cet anti-héros, notamment sur la fin, ou on le sent aussi prisonnier que nous. Il ne peut rien changer, c'est trop tard. Ne lui reste plus qu'à tout décrire, tout livrer au lecteur, tel un maillon lucide de la chaîne; c'est un cinglé, mais le monde qu'il nous met sous les yeux est bien plus cinglé que lui, qui n'en est que le produit, la conséquence. Au lecteur d'y réfléchir ensuite.
Un livre d'une force incroyable.