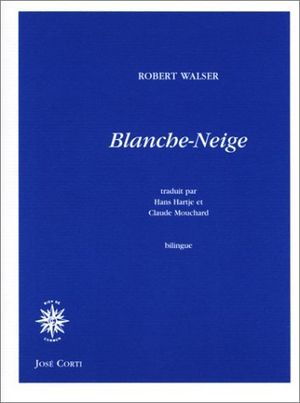Les contes jouent sur la logique du déchirement, de la rupture; celle entre enfance et âge adulte, entre campagne domestique et forêt sauvage, vie et mort, vie morte ou mort vivante, dévorement, empoisonnement... Blanche-Neige ne fait pas exception: laissée en état de stase entre vie et trépas, sauvée par la promesse du bonheur conjugal, tirée au monde de la terre et de l'enfance incarnée par les nains par la haine d'une femme dévorée par sa part d'ombre narcissique mortifère (le miroir).
Mais ce monde n'est pas le monde de Robert Walser, oh non... à la rigueur il est celui de Kafka, d'un garçon resté dans les limbes d'un Œdipe dévorant. Celui du suisse vient après, il est celui de l'apaisement et du pardon. Pour un tel homme le drame de Blanche-Neige ne peut se résoudre que dans la réconciliation. "La querelle qui fut n'est plus/L'amour sut vaincre, ici; la haine/devant tant d'amour s'est perdue [...] Vient la douce paix." Tout ça n'a-t-il été qu'un mauvais rêve? Non, sans doute mais c'est comme si... c'est là la force du pardon: on ne peut pardonner que l'impardonnable. Pour être vrai il doit abolir l'offense toute entière.
C'est cet apaisement qui fait tout le prix de l'œuvre de Walser. Il ne s'agit pas d'une béatitude niaise mais bien d'une naïveté durement conquise. Il a choisi de vivre dans le monde de la paix et du contentement, par-delà les déchirements, la violence et la folie qu'il a connu autant sinon plus que tous. Il n'est pas comme on se plait à le dire un faux naïf. Il est bel et bien un vrai naïf qui sait le prix de la naïveté. Kafka n'a pas terminé le Disparu qui devait terminer par une séance de retrouvailles avec les parents. Walser lui semble vivre dans cet élément avec le plus grand naturel. C'est pour cette force invinciblement modeste qu'on l'aime aussi passionnément.
Comme souligné par Kliban, l'édition et la traduction sont très bien faites et rendent parfaitement justice au rythme de l'original.