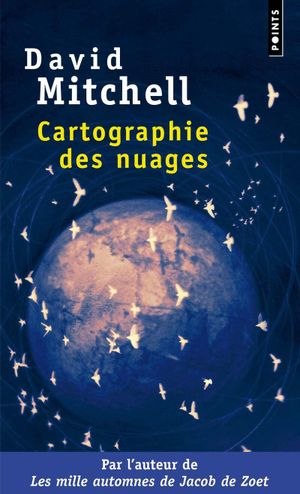N’ayant jamais lu d’autre livre de David Mitchell, je m’abstiendrai de qualifier Cartographie des Nuages de chef-d’œuvre. Il y a pourtant dans ce roman mêlant différentes intrigues sur plusieurs siècles, tous les éléments d’une œuvre magistrale. Une œuvre dense, vivante, poétique et réaliste, passionnante et complexe, maîtrisée de bout en bout. De 1850, perdus dans l’Océan Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et San Francisco, jusque dans un futur post-apocalyptique sur des îles qui rappellent Hawaii, nous suivons six personnages principaux, tous liés les uns aux autres par quelque chose qui les dépasse. Chacun s’influence, pas toujours consciemment, de la vie du précédent. Le roman est ainsi construit que chacun laisse une trace de son histoire que le suivant lira, entendra, et dans laquelle il se retrouvera parfois : Journal de la Traversée du Pacifique d’Adam Ewing, homme de loi, Lettres de Zedelghem du jeune compositeur Robert Frobisher à son ami Rufus Sixsmith, Demi-vies, la Première Enquête de Luisa Rey, journaliste, l’Epouvantable Calvaire de Timothy Cavendish, éditeur, l’Oraison de Sonmi-451, androïde intelligent, pour finir par l’histoire orale de Zachry, sauvage du futur, qui nous raconte La Croisée d’Sloosha pis Tout c’qu’a Suivi. Chaque partie est datée : une époque précise, décor, ambiance. Chaque partie illustre aussi un choix littéraire précis : journal, mémoires, interview, récit. Autant d’exercices de style différents, l’ensemble présentant ce défi particulier d’articuler ces époques, avec leurs mœurs et leurs accents particuliers, et ces personnages en un récit complet et complexe. Rien qu’en ce sens, Cartographie des Nuages est déjà une œuvre impressionnante de maîtrise littéraire.
Le Journal de la Traversée du Pacifique d’Adam Ewing relate le voyage retour d’un jeune américain, des côtes néo-zélandaises jusqu’au port de San Francisco. « Un homme sensé ne s’interpose pas entre une bête et sa pitance », l’avertissement inaugural nous dit rapidement de quoi il sera question. Avec comme décor l’Empire Britannique du bout du monde, le jeune homme évoque sa confrontation avec un monde sauvage d’abord (la violence des mœurs maoris et l’accommodation des colons à ces hommes qu’ils considèrent inférieurs), puis sa soumission, passager malade d’un navire marchand, à un microcosme social dans lequel il ne trouve pas réellement sa place, et à un étrange docteur auquel il se fie plus que de raison. Il y écrit ses réactions et ses réflexions, autour notamment de l’émancipation d’un esclave et de l’avidité sordide des hommes. Un texte empreint d’un réalisme particulier : tout va dans le sens de la véracité, d’une réalité historique tangible. Ce n’est pas la liberté qui guide les pas des hommes mais déjà le commerce. Une peinture de l’avidité des colons, dont les conquêtes, sous couvert de bonté civilisatrice, disent toute la soif de richesses et de pouvoir.
Les Lettres de Zedelghem, confidences du jeune compositeur Robert Frobisher à son ami et amant Rufus Sixsmith, sonnent comme une symphonie littéraire. Au début des années trente, ayant fui l’Angleterre où il ne se voyait aucun avenir, Robert Frobisher rejoint l’illustre Vyvyan Ayrs, acariâtre génie isolé du monde, aux environs de Bruges, pour se mettre à son service. Auprès du maître, il va apprendre la musique évidemment, et la composition, mais il va surtout se confronter malgré ses attentes à l’ambition et à la haine, à l’amour aussi et à la manipulation. Dans l’écriture, tout est musique. La sensibilité du personnage est partout présente : tout au long de cette correspondance, jamais le jeune homme n’écrit « je ». Pas une fois, il ne se personnifie, s’effaçant derrière quelque chose de plus grand que lui, l’art d’abord, qui élève l’homme : « Il y a autant de différences entre l’oisif et le paresseux qu’entre le gourmet et le gourmand », mais aussi le monde qui l’entoure, la nature qu’il retranscrit magnifiquement par ses mots avec des descriptions sonores de son environnement impressionnantes de précision. En fond de sa réflexion commune menée avec le vieux maître, la place de l’individu : « Quel système de société préconise-t-il ? Aucun ! Plus un pays est organisé, plus ses habitants sont moroses ». Ce constat est une des grandes lignes de réflexion du livre : plus les sociétés sont denses, plus le nombre de lois pour régir ses membres est important, tandis qu’une société de sauvage, au territoire et au nombre limité, peut s’organiser autour d’un nombre restreint de lois orales, autour d’une sagesse populaire. Musicalement, chaque homme est une infime note d’un grand ensemble qui le dépasse. Plus il y a de notes, plus l’harmonie est difficile à atteindre.
Demi-Vies, la première enquête de Luisa Rey prend la forme plus classique d’un roman aux chapitres très courts, et narre tel un polar l’enquête d’une jeune journaliste autour de la construction et de la mise en service d’un réacteur nucléaire de nouvelle génération dans les années soixante-dix. Face à des industriels riches, puissants et déterminés à continuer de s’enrichir, Luisa Rey creuse comme elle peut son chemin vers de dangereuses vérités. Dans l’immense adversité qui lui est opposée, elle pourra compter sur l’aide précieuse et rare de quelques hommes. L’auteur commence de développer de manière plus évidente les liens entre chaque récit et le lecteur apprécie les similitudes entre les personnages : tous interpelés par des disfonctionnements sociaux, ils ont à cœur de tenter, sinon d’y remédier, au moins d’en donner la conscience à un plus grand nombre. Ils sont les rares messagers de valeurs dépassées qui se heurtent à l’inepte course du monde. Le meurtre d’un scientifique se justifie : « Une tragédie pour ceux qui l’aimaient, un évènement sans importance pour les autres, et un problème de moins pour mes clients ». La société où évolue Luisa Rey a clairement mis les sentiments aux rebuts pour la course aux profits, c’est la déshumanisation du capitalisme : une société qui vante les richesses au mépris des hommes, de la nature et de la condition humaine. L’individu n’est plus rien, seuls comptes les profits et le progrès, la domination de la nature par la civilisation.
L’Epouvantable Calvaire de Timothy Cavendish sont les mémoires de Timothy Cavendish, petit éditeur britannique contemporain, sans succès mais pas sans dettes. Pour ne plus entendre parler de lui et de ses problèmes, son frère le fait enfermer dans une maison de retraite. Naïf, Tim Cavendish est obligé de regarder en face la malhonnêteté et la méchanceté des hommes. Leurs négligeables vies aussi : « Nous nous imaginons qu’un pays comme l’Angleterre saurait aisément contenir tous les événements d’une humble vie sans que nous retombions sur nos propres traces (…), et pourtant, nous croisons et recroisons les croisillons de notre sillage, tels des patineurs artistiques », c’est l’inéluctable cycle des vies humaines, amenées à répéter et à intensifier bonheurs, progrès, mais aussi erreurs, horreurs et déchéances. « Dès lors qu’on se résigne à subir quelque joug au quotidien, notre défaite est certaine ». Une phrase comme une sentence définitive, importante. L’éditeur est obnubilé par sa propre décrépitude et par le déclin des civilisations. « Cette bonne vieille terre connut une brusque fin », écrit-il. Comme l’acceptation de l’apocalypse à venir. Timothy Cavendish incarne la triste résignation des hommes à se laisser asservir par ce qui les dépasse, en même temps qu’il est l’espoir toujours tenace d’une liberté toujours plus grande.
L’Oraison de Sonmi-451 est la confession enregistrée d’un androïde de service dans un futur d’anticipation relativement proche. L’androïde femelle, à la conscience bridée pour un meilleur rendement, s’éveille à la réflexion pour souffrir de vivre en plein cauchemar. Elle raconte sa vision d’une société de surconsommation où le prix de chaque vie humaine s’évalue selon son rang (« La sagesse populaire veut que les factaires n’aient pas de personnalité. Un préjugé cultivé pour le confort des sang-purs »), où le bonheur apparent des plus riches s’abreuve du sang des clones et de la misère des pauvres. Humaine comme n’importe qui, Sonmi devient le porte-parole d’une rébellion naissante en portant aux hommes la conscience de l’autre : « Comment trouve-t-on de la connaissance ? lui demandai-je. Tu dois apprendre à lire, petite sœur », l’homme seul meurt, l’autre lui insuffle la vie. L’auteur, par la bouche de l’androïde, cite Orwell et Huxley, et c’est bien de cela dont il s’agit : un roman dans une lignée d’anticipation et de réflexions sur les sociétés humaines et ce qu’elles apportent ou ôtent d’humanité aux gens. « Je lui demandai comment remédier à ces souffrances. On n’y remédie pas. On vit avec ». La résignation de la condition humaine : c’est bien la souffrance, la pitié et l’empathie qui nous permettent de comprendre notre prochain et de nous rattacher à lui. « Vous sous-estimez les capacités de l’humanité à donner vie au mal ». Les rouages d’un pouvoir stable se basent sur le mal en chaque homme : mise en scène de la terreur, divisions sociales et course effrénée au confort, avec leurs conséquences. En tête, la négation par chaque individu de sa propre humanité. Mais « Tous les soleils levants finissent un jour par se coucher », l’auteur nous rappelle la brièveté de nos vies, inclues dans un cycle qui nous dépasse.
La Croisée d’Sloosha Pis Tout C’qu’a Suivi est le récit au coin du feu de Zachry dans un futur post-apocalyptique. Le vieil homme raconte son enfance et la visite dans son clan d’une Presciente, une femme venue d’une autre tribu, d’une autre île, où l’humanité n’a pas autant perdu que par chez lui. Une visiteuse qui bouscule ses croyances. C’est la confrontation de deux humanités déchues avec ce que cela comporte de méfiance initiale, jusqu’à la compréhension mutuelle. Grâce au dialogue, à l’empathie et à la fraternité.
« Allongé sur le fond du kayak, j’ai r’gardé les nuages flageoler. Les âmes traversent les âges comme les nuages traversent les ciels, pis leur forme, leur couleur et leur taille ont beau changer, ça reste des nuages, et c’est pareil pour les âmes. Qui sait d’où qu’sont soufflés les nuages ou bien en qui demain une âme se réincarn’ra ? Ceux qui savent, c’est Sonmi, l’est et l’ouest, pis la boussole, pis la carte, ouais, la carte des nuages, c’est la seule à l’savoir ». Toute la mystique du roman en quelques lignes.
Cartographie des Nuages est une œuvre impressionnante, les raisons sont là : c’est une longue réflexion humaniste et philosophique sur la condition humaine et la place de l’individu dans les sociétés. Un long plaidoyer pour la compréhension mutuelle des libertés de chacun, conciliées les unes par rapport aux autres dans un esprit de fraternité. Un vibrant appel à la fraternité, qui est la seule voie possible entre les hommes : la responsabilité de chacun, de tout temps et de tout âge, de partager, de s’ouvrir, de ne pas se laisser envahir par le mal. Quoi de mieux qu’une grande fresque trans-temporelle pour illustrer les sociétés de l’homme et leurs influences à la fois sur l’individu, et sur le groupe social. Cartographie des Nuages est une magnifique étude de la condition humaine à travers plusieurs personnages sur différentes époques, par-delà les religions, par-delà les fois, spirituelles ou matérielles. L’idée développée tout au long du livre par ces messagers d’époques différentes est toujours celle que l’homme porté par une inextinguible soif cultive son propre malheur et la mort de ses semblables. Et que dans nos sociétés aux innombrables membres, il en sera toujours ainsi. Seule la reconnaissance de l’autre, véritable lien de fraternité, permet de comprendre à quel point nous sommes tous liés.
« Et seulement à votre dernier souffle, enfin comprendrez-vous que votre vie n’a guère davantage compté qu’une goutte d’eau dans l’infini de l’océan !
Cependant qu’est-ce qu’un océan, sinon une multitude de gouttes ? »
Les derniers mots du livre résument clairement la place de l’homme au sein d’une nature qui le dépasse et la nécessaire humilité que chacun devrait ressentir face à son prochain. Je le répète : une œuvre impressionnante, intelligente, et profondément humaniste ! Une symphonie humaine sans fausse note, un long mouvement philosophique qui nous amène à nous remettre en question en tant qu’homme, et à remettre en question nos sociétés de progrès incessants.
Matthieu Marsan-Bacheré