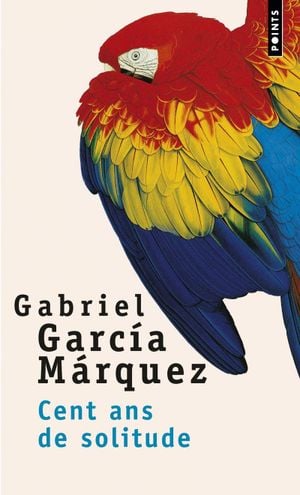Depuis que je travaille, c'est dans les transports en commun que je lis le plus. Si cela permet de tuer agréablement les vingt minutes qui me séparent de mon boulot, ce n’est pas, honnêtement, le coin parfait pour réfléchir ou s’évader, selon ses lectures. Entre l'usager grincheux qui vocifère contre le chauffeur pour qu'il ouvre les portes, et les élèves qui, petit à petit, déboulent et s’en vont me demander si le CDI sera ouvert en première heure de la matinée, il m’est bien difficile de m’adonner complètement à ce que je suis en train de lire.
Mais en lisant Cent ans de solitude, je me suis sentie affranchie de tout ce qui avait trait à l’espace-temps. Loin de la trivialité des transports en commun, j'étais transportée dans le village de Macondo, entourée de José Arcadio et d’Aureliano à perte de vue. Durant vingt minutes qui s’égrenaient comme des millièmes de seconde, je vivais des décennies.
Macondo n’existe pas. Elle n’est qu’un mirage qui ne doit sa réalité qu’aux quelques quatre cent cinquante pages rédigées par Garcia Marquez. Erigée par la troupe de José Arcadio Buendia, elle connaîtra ses heures de gloire, puis celles de sa chute, calée sur la vie de son père fondateur et de sa descendance. Si Macondo existe, ce n’est bien qu’à travers la formidable dynastie des Buendia, qu’on essaie de suivre de manière logique. Mais perdu dans l’enchevêtrement de José Arcadio, d’Aureliano, d’Amaranta ou de Remedios, force est de constater que nos manières de penser n’ont pas lieu d’être ici. Après tout, pourquoi essayer de définir ces personnages ? Le temps a beau s’écouler, l’histoire se répète inlassablement. Et qu’importe qui est le grand-père, la tante ou la bisaïeule de tel enfant Buendia. Ils ont beau être une famille, chacun n’est qu’une individualité qui se définit par sa propre obsession.
Aussi illusoire soit ce village sud-américain, c’est à travers celui-ci et les Buendia qu’on assiste à l’histoire de cette région du monde, marquée par les guerres civiles, l’invasion du capitalisme, les grèves réprimées dans l’horreur et le sang… Mais à ces dures réalités s’ajoute le sublime. Le sublime surnaturel dans lequel baigne Macondo avec ses fantômes, ses ascensions divines ou encore sa fin apocalyptique, mais surtout le sublime de la plume de Gabriel Garcia Marquez, qui mêle la narration du conteur avec le langage du poète. La traduction à ce titre est délicieuse, la version originale ne doit être que plus exquise.
Je peine à trouver les mots pour mettre fin à cette critique. Comme le temps dans le roman, je risque de me répéter. Et n'ayant pas le talent de notre compère colombien, je ne peux pas m'éterniser en radotant sur le fait que ce livre est splendide à tout point de vue et que, plus que d'être lu, il se doit d'être vécu.