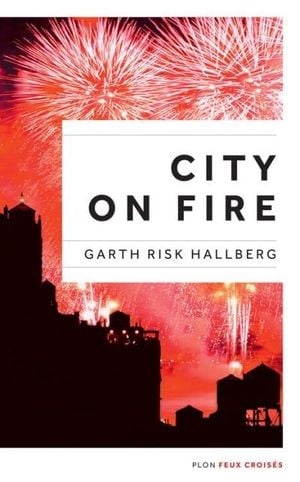C’est toujours délicat de s’attaquer à la critique d’un livre qui a été encensé par la plupart de ceux qui l’ont lu et surtout par ceux qui ne l’ont pas lu. On a beaucoup dit, beaucoup écrit sur ce roman. On a cité Charles Dickens, Donna Tartt, Tom Wolfe etc.. On a aussi évoqué le « grand roman américain » : ce mythe qui refait son apparition dès qu’un jeune auteur débarque avec un livre qui dépasse les 400 pages. On nous avait déjà fait le coup avec La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert avant de revoir sérieusement son jugement. Attendons donc le second roman de ce jeune auteur avant de le comparer aux fils spirituels d’Hemingway : John Irving, Philip Roth, Truman Capote, Norman Mailer et les autres.
Reste que Garth Hallenberg nous livre là un ouvrage follement ambitieux et résolument américain. Mais, plus que l’Amérique, c’est New York la vraie star. L’ouvrage est une véritable fresque urbaine à sa gloire et utilise un style parfois aussi démesuré qu’elle. C’est que l’auteur ne nous épargne rien de tout ce qu’elle a de détestable : le bruit, la pollution, la drogue, la violence, la corruption, l’anarchie latente, la crasse, la pauvreté mais où règne d’une manière égale, nous dit-on, la liberté d’être ce que l’on est et la formidable synergie des énergies individuelles.
On a d’ailleurs souvent l’impression que l’auteur s’attache plus à nous dépeindre sa ville plutôt qu’à nous entraîner à suivre l’évolution de ses personnages. Ceux-ci sont attachants, il est vrai, mais guère épais et il a fallu les multiplier à l’excès, au risque de s’en désintéresser, pour pouvoir colmater par endroits un récit qui s’enlisait. Une vague enquête policière, passablement bâclée, tenant lieu de fil conducteur relie ces personnages mais pas toujours de façon très claire.
C’est que l’ouvrage lui-même n’est pas aisément classifiable. On parle d’un roman choral, d’un ouvrage d’apprentissage (de quoi ?), d’un manifeste américain.
Sans doute.
Ca pourrait être aussi un reportage documentaire sur NY, un guide touristique des quartiers de l’Upper Side et Long Island, un ouvrage anthropologique sur la condition humaine new yorkaise au point qu’on se prend parfois pour un myrmécologue, loupe à la main, penché sur une fourmilière. Et ce n’est pas toujours très passionnant.
L’auteur a pourtant du talent - la chose est évidente - un style personnel - c’est indéniable - et il sait écrire - ce qui est encore mieux – ( Elle entendait les lumières s’allumer, les tiroirs gémir et attendait dans ce couloir où flottait l’odeur imperceptible de milliers de repas, comme si une énorme pâte douceâtre colmatait les murs.) Et pourtant, on ne sort pas pleinement satisfait de sa lecture. C’est souvent trop touffu, trop verbeux, trop imprécis, trop flou, trop disparate. Bref, c’est trop tout. A l’image même de la ville qu’il décrit. Avec cette critique récurrente que les ouvrages de cette taille ont toujours 200 pages de trop.
Finalement, ce roman n’a d’américain que la démesure qu’il a suscitée avant même sa sortie, même si l’auteur supporte mal qu’on lui parle de ses millions de $ d'à valoir, faisant de lui un jeune auteur aussi bien payé qu’une star de la NBA. En fait de phénomène littéraire, celui-ci tient plus du Guinness Book que d’une candidature au prix Pulitzer.