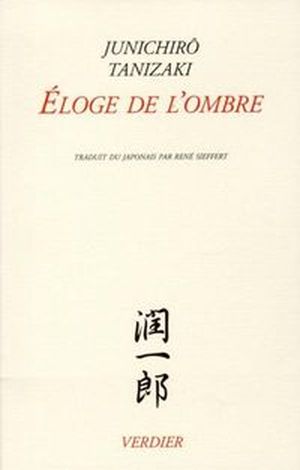Autant le dire de suite, la citation mise en exergue dans le titre n'est pas extraite de cet ouvrage. C'est un aphorisme de l'artiste Pierre Soulages, un autre fervent apôtre de l'ombre intégrale. Car on rencontre partout cette religion particulière, me dis-je à présent. Et je pense à l'Alhambra, à la mosquée de Cordoue, aux églises romanes. Il m’apparaît en effet, après lecture de ce court essai, que le rapport à l'ombre est fondamental dans n'importe quelle culture. le livre fournit en cela une ébauche de théorisation tout à fait stimulante.
Tanizaki Jun'ichirô parvient, de façon admirable, en partant du raisonnement le plus prosaïque, à s'interroger sur les fondements de l'architecture et ce que nous appelons aujourd'hui le "design". Le début du texte relate de façon assez drôle la difficulté que rencontre l'auteur à accommoder le confort moderne "occidental" avec l'architecture traditionnelle japonaise, en particulier lorsqu'il s'agit des toilettes. Ce lieu de recueillement essentiel ne peut, selon lui, admettre la brillance, la faïence ou la froide lumière électrique. Contre le locus horribilis des toilettes d'hôtel "à l'occidentale", il prône les toilettes traditionnelles japonaise situées à l'extérieur de la demeure, là où le vent souffle doucement, où l'on peut entendre le bruissement des insectes, le chant des oiseaux à mesure que décline la lumière du jour, là on l'on peut méditer.
L'entrée dans la modernité s'accompagne ainsi de la mélancolie du monde perdu, qui subsiste encore dans les campagnes, un peu idéalisée pour l'occasion. Le texte original fut publié en feuilleton en 1933 et nous offre une lecture très fine des conditions matérielles au fondement de ce que nous appelons "l'esthétique". C'est là le trait le plus remarquable de l'oeuvre selon moi : l'art comme l'architecture sont en partie perçus comme une acceptation de la contingence. Pour Tanizaki Jun'ichirô, c'est ainsi que la cohabitation d'abord forcée avec l'ombre a donné lieu à une compréhension intime de la beauté, de la nuance, de l’ambiguïté et de la fraîcheur que recèlent les jeux de lumière, jusqu'à définir un rapport au corps, au genre et au temps. L'essai est une déclinaisons de ces principes et invite à percevoir à notre tour la richesse des environnements selon leur luminosité ou leur obscurité.
C'est aussi un texte très élégant, distancié, ironique. Comme d'habitude, je n'ai lu la préface (excellente, par ailleurs, dans cette nouvelle édition 2017) qu'à la fin. J'ai donc eu du mal à déterminer d'où provenait cette voix particulière. En 1933, Tanizaki Jun'ichirô est une sorte de dandy issu de la bourgeoisie marchande, homme de lettre suspicieux à l'égard du nationalisme comme de la modernité. Il porte aussi les représentations de sa classe et de son temps. La seule chose un peu agaçante du livre est d'ailleurs cette manie de réifier "l'occident", avec assez peu de nuances. Une sorte de pendant à l'orientalisme colonial totalement dominant en France à l'époque. Heureusement, l'humour et la retenue compense largement ce léger défaut. Et puis, il ne faut pas oublier que ce petit livre est aussi un témoignage historique, à la fois de la pensée d'une certaine élite et de la façon de vivre d'un peuple à l'orée du XXème siècle.
Il me faut donc remercier mon libraire qui m'a recommandé cet essai, dont la lecture l'a lui-même bouleversé : "Je vois de l'ombre partout à présent" m'a-t-il dit.