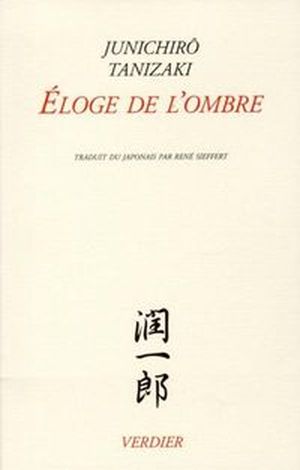Écrivain quelque peu traditionaliste, Tanizaki offre cependant un éclairage passionnant sur la spécificité de la culture extrême-orientale, et avant tout nippone.
A travers l’examen de l’invasion de la culture occidentale en Asie, il se demande si l’intégration de cette autre culture, se résumant plutôt à emprunt généralisé, ne reviendrait pas à une acculturation qui, en la dénaturant, soulèverait le problème de l’identité japonaise. Sans cette ingurgitation d'une civilisation "plus avancée" presque forcée initiée par l’empereur à l’époque Meiji, l’Orient aurait pu arriver aux mêmes avancées techniques mais prises sous un angle différent, propre à leur mode de pensée.
Tout l’essai se fonde notamment (d’où son titre) sur cette écart fondamental qui séparerait les deux cultures : l'amour de l’Occident pour le progrès, pour ce qui est au-delà du quotidien, pour l’élimination de toute trace de poussière et pour une vie dans une clarté toujours plus aveuglante ; alors que le Japonais, lui, se contenterait du doux clair-obscur, le cultiverait même comme s’il était l’écrin même de la beauté. La souillure, comme marque de l’indéfini, du temps qui passe, de l’imperfection, de l’empreinte que l’homme laisse sur le monde, serait un élément du beau. Ainsi la différence entre le diamant, pierre occidentale, et le jade, pierre orientale : celle-ci renferme des résonances troubles, comporte une part d’ombre, est striée de veinures comme si elle renfermait un brouillard opaque et irrégulier, alors que le diamant ne fait qu’étinceler dans sa perfection sans tâche.
Il en irait de même pour la majeure partie de la culture japonaise : des tableaux qui s’apprécient mieux dans la pénombre, se fondant avec harmonie dans leur contexte ; de la cuisine qui se déguste autant par les yeux que par la bouche, les grains de riz rayonnant comme des perles dans l’obscurité, la soupe prenant des teintes profonde dans son bol de bois laqué ; jusqu’au théâtre et à la façon de s’habiller, l’idéal féminin étant un visage aux dents noircis, les lèvres peintes d’une couleur bleu-verte, dont la blancheur de la peau illumine la pénombre.
Le livre est un peu daté (années 1930) et cela peut se ressentir ; mais derrière ce plaidoyer non dépourvu d’humour sur la société japonaise et sa difficile confrontation à l’envahisseur occidental qui fascine, se révèle un aspect passionnant de l’esthétique nippone qu’il vaut vraiment la peine de découvrir.
Mention spéciale au passage sur les toilettes, présentées comme le pinacle de la culture japonaise, incarnation de sa délicatesse et de son bon goût. On ne peut s'empêcher de penser à la relation assez magique que les japonais entretiennent avec ce lieu aujourd'hui...