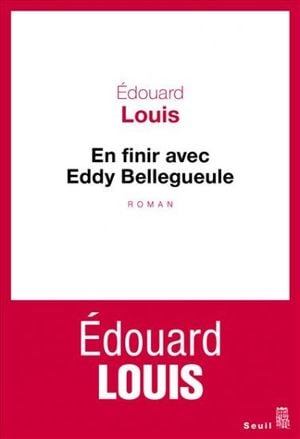En finir avec Eddy Bellegueule déchire les foules : entre les pro, émus par la peinture bouleversante d'une enfance terrible, et les anti, criant à la supposée haine de l'auteur contre son milieu, il semble n'y avoir guère de demi-mesure. Je ne fais pas exception à la règle, en me situant bien plutôt dans la première catégorie.
Il n'y a pas, à mon sens, de haine dans cette oeuvre. Je n'y vois nulle revanche personnelle d'un enfant rancunier contre son milieu sordide, nulle calomnie qu'il faudrait condamner en bloc, nul narcissisme pervers dans le récit de soi à vingt-deux ans. Pourquoi ? Pour la simple - et excellente raison - que le statut même de l'oeuvre est flou.
Il est sous-titré "roman". Quand d'aucuns y voient une précaution facile contre les accusations de calomnie, j'y vois plutôt un choix extrêmement cohérent, et littéraire. Car dans les faits, difficile de nier la part autobiographique de l'oeuvre, notamment quand Edouard Louis en personne l'affirme. Mais il s'agit précisément d'une part : peut-on parler d'autobiographie, quand d'après ce que l'on sait, il y a une part non-négligeable de fiction dans ce "roman" ? A l'évidence, non. Peut-on parler, alors, d'autofiction ? Je trouve le terme tellement péjoratif que je ne puis m'y résoudre ; et puis Edouard Louis dit "C'est l'histoire d'un enfant, et cet enfant, c'est moi" : il pense donc son oeuvre comme une autobiographie, ET comme un roman en même temps.
Il est évident que c'est un choix.
Comment, alors, comprendre En finir avec Eddy Bellegueule ?
Faisons un peu de littérature.
Il existe, dans le genre autobiographique, une convention qui s'appelle "le pacte autobiographique" (voir à ce sujet l'essai éponyme de Philippe Lejeune). Ce pacte, tacite, est comme un contrat avec le lecteur, que l'on pourrait formuler ainsi : "Le narrateur, c'est moi, le "je" qui parle équivaut à ma personne d'auteur, je vous parle de moi, et je m'engage à dire toute la vérité en ce qui me concerne". Pour qu'il y ait autobiographie, il faut que l'on trouve ce pacte dans l'oeuvre ; il faut également que le je-héros soit le je-narrateur, et que le je-narrateur soit le je-écrivain, que la coïncidence soit parfaite.
Il n'y a pas de pacte autobiographique dans l'oeuvre dont nous parlons, car elle est sous-titrée "roman".
Néanmoins, en aval de l'oeuvre, il y a ce qu'en dit l'auteur ; mais l'auteur se contente de dire que l'enfant dont il parle, c'est lui-même.
Ça devient compliqué, on va pas se le cacher.
Il me semble que la seule solution satisfaisante, pirouette fréquemment exécutée par l'écrivain, est de dire : c'est le point de vue de l'enfant Eddy Bellegueule qui est donné par Edouard Louis (il y a dissociation entre le "je" antérieur, et le "je" contemporain, que dit tout bêtement le changement de patronyme), avec ses sentiments à vif, sa radicalité dans la construction en opposition avec son milieu, et toute sa subjectivité. Ce que raconte Edouard Louis, c'est sa propre vérité, celle de son enfance, celle qu'il a dû construire et mettre à distance pour survivre au rejet qu'il a subi de la part de son milieu.
On s'en tamponne les steaks de la vérité historique. La vérité historique est invérifiable, et pour qui a déjà étudié un peu des autobios, c'est incontestable. Rousseau et Casanova, par exemple, ont mis en place, explicitement, un pacte autobiographique, ils l'ont formulé. Cela signifie-t-il que leur oeuvre autobiographique est exempte de fantasmes, d'approximations, d'erreurs ? Nullement. Cela signifie qu'ils ont écrit leur vérité, déformée consciemment ou pas, et que personne n'a le droit de leur ôter cela.
Alors oui c'est un peu facile. Mais quelqu'un a-t-il une meilleure idée ?
Le débat sur la véracité du récit est un faux débat, un débat creux, qui veut ôter au texte ses qualités littéraires pour le penser à partir de l'auteur. Les véritables calomniateurs, ce sont les lecteurs qui cherchent des noises à l'auteur et voient de la haine là où il n'y a que la description d'une tristesse insoluble, l'amer constat d'une misère sociale prégnante, dépassable mais encore indépassée, ravageuse, d'une violence inouïe - en particulier pour un enfant. Les flots de haine ne sont pas dans le livre, mais en-dehors de lui.
Alors oui, c'est douloureux, cruel, affreux à lire, et sans doute en premier lieu pour les gens que cela concerne. Oui, il y a sans doute une exagération patente des faits. Mais Edouard Louis ne fait de procès à personne : il dresse le portrait sociologique de son milieu, et par touches aussi discrètes que fines, analyse les mécanismes de la reproduction sociale et la difficile émancipation de cette logique implacable. Comme il le dit lui-même, encore une fois, il faut voir dans le regard angoissé, apeuré de l'enfant, l'effort pour mettre à distance l'altérité : son milieu le condamne à être étranger, et après avoir désespérément tenté de s'intégrer, il ne peut que renforcer, pour s'en sortir, l'opposition, construire dans son esprit un Autre sauvage, total, fatal. La méthode d'Edouard Louis est comme un dernier rempart, un dernier effort commandé par la peur ; et en même temps comme une lucidité cachée sur cette peur qui commande la mise à distance. Un aveu intime, quoi, comme on en fait dans les autobiographies.
Les discrètes interventions du narrateur, entre parenthèses, sont là pour montrer à la fois la proximité émotionnelle des souvenirs d'enfance, et le regard rétrospectif qu'exige le récit de soi au passé.
On pourrait peut-être parler d'autobiographie romancée, voire romanesque, dans la littérarisation du réel ; littérarisation qui apparaît à la fois comme un processus conscient, et comme une submersion invincible de l'émotion puérile (au sens étymologique du terme : du latin puer, l'enfant), renforcée par la force du traumatisme sur la mémoire. Et la force du traumatisme, Edouard Louis ne la nie pas.
Cette complexité dans les points de vue et dans le genre de l'oeuvre permet de ne pas se vautrer dans le jugement moral sur le choix de l'écrivain - car le jugement moral, on peut le formuler, mais je ne vois pas que l'on puisse en faire un motif valable de condamnation de la qualité d'une oeuvre. Personne ne reproche à Rousseau ou à Casanova ses entorses à l'Histoire ; précisément car on a du recul, et qu'il est difficile d'avoir du recul sur une oeuvre ultra-contemporaine. Pourtant, il faut essayer, et tendre vers une dissociation de la personne et de son oeuvre. Sinon, il faut cesser de suite de lire la littérature qui compose la vulgate scolaire et universitaire, car on peut faire beaucoup de moralité à partir des Grands, entre les racistes, les misogynes (wait... à peu près tous en fait ?), et autres.
Voir du mépris, des clichés, de la haine de classe dans ce "roman", il me semble que c'est faire fausse route : j'y ai vu, moi, beaucoup d'amour, et beaucoup de tristesse ; une espèce de réflexion amère sur l'immobilité de la misère, une espèce de portrait de la pauvreté et de ses déboires - le manque d'éducation, les préjugés racistes/sexistes/homophobes qui dessinent la dualité entre virilité et féminité comme un fil rouge du roman, le manque d'attention à l'enfant. Les faits sont peut-être exagérés eu égard à la vérité historique ; mais la reproduction sociale est une réalité sociologique. Cette misère existe, ce n'est pas juste une affabulation d'un auteur revanchard et snob (ce serait un comble).
Et pour dépasser cette misère, il faut la peindre, il faut la faire voir dans ses tristes nuances de gris. Edouard Louis l'a dit lui-même : c'est en faisant prendre conscience aux gens de l'état de stagnation arriérée des campagnes françaises pauvres et reculées que l'on peut faire évoluer les mentalités. Plus qu'une volonté de vendre une vision voyeuriste et idéologique d'un milieu, j'y vois une démarche progressiste, sociologique (ce n'est pas pour rien qu'Edouard Louis a dirigé un ouvrage collectif sur Bourdieu...). On est loin de la contemplation égotiste de soi-même !
Finalement, je ne fais que broder sur les déclarations de l'auteur en personne. Les procès d'intention sont un travers dommageable de lecteurs à l'affût de la moindre erreur, qui n'hésitent pas à se gargariser de faits divers et de polémiques absconses. J'ai très peu parlé de la plume, de l'intérêt stylistique d'Edouard Louis ; sans doute, cela a déjà été fait, et mon propos n'a été ici que de proposer une voie interprétative un peu plus rigoureuse et juste. Je m'excuse pour mon ton un petit peu péremptoire ; c'est que j'ai vu les flots de haine dans les critiques, et que je les trouve tristes.
En finir avec Eddy Bellegueule, bien plus qu'achever par l'écriture une indispensable affirmation de soi contre la souffrance, c'est replonger dans cette souffrance, la sortir de l'intime, pour en montrer l'horreur au tout-venant, pour qu'on en prenne conscience, et qu'on comprenne que c'est avec cette horreur qu'il faut en finir.