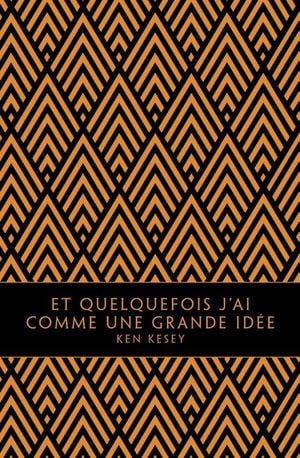Est-ce pour prouver en bon hippie que la quantité ne surpasserait jamais la qualité que Ken Kesey aura arrêté, après avoir livré ce chef d’œuvre, d’écrire pendant 25 ans ? Trois romans étalés sur 35 ans, ce n’est plus de la flemme à ce prix là, c’est un sacerdoce à l’envers ! Inutile de chercher à comprendre pourquoi ce black out, inutile de regretter le manque à gagner, autant faire nôtre cette leçon d’anti-consummérisme radicale plutôt, et boire à petit trait cet alcool d’autant plus fort qu’il est rare. Fort donc, très très fort. Mauviettes s’abstenir.
Pourtant lorsque le roman commence, on a l’impression d’être en territoire connu. Sur le papier, ça fait même diablement penser à du Steinbeck cette affaire : un roman fleuve (parce qu’il fait facile ses 800 pages, et parce que la rivière Wakonda au bord de laquelle vit la famille Stamper est un personnage central du récit) ancré dans la réalité économique et géographique du pays façon "Les Raisins de la colère", une famille hors norme de bucherons solitaires et durs à cuire façon "Au Dieu Inconnu", une grève façon "En un combat douteux", l’affrontement de deux frères façon "A l’Est d’Eden" et j’en passe…(en fait la plupart des personnages secondaires, regardés avec un mélange de compassion et d’ironie, semblent s’être échappés d’un bouquin du grand John ). Mais ce qui pourrait n’être qu’une pale resucée, ou un vibrant hommage, trouve très rapidement la voie de traverse qui va transformer l’essai et faire en sorte que le bouquin se mette à voler comme un grand, de ses propres ailes. A savoir un parti pris narratif étonnement moderne et étonnement réussi, surtout vu l’ampleur de la gageure : raconter sur un temps ramassé (à peine un mois) les innombrables péripéties de cette famille au sein de cette petite ville en explosant la chronologie via des allers-retours vertigineux, aussi bien spatiaux que temporels, et surtout en distribuant la parole de personnages en personnages sans rupture, sans marque distincte, passant dans le même paragraphe de vision subjective en vision subjective (à la première personne donc), entrecoupées de quelques phrases à la troisième, émanant d’un narrateur surplombant. Inimaginable mosaïque de sensations, d’idées, de points de vues, tellement finement travaillée que le lecteur n’est jamais perdu, et passe de regard en regard avec une frénésie orchestrée en sous main par l’auteur. L’effet est magistral.
Alors on sort de cette lecture essoré, à l’image des protagonistes qui auront lutté contre la Nature sauvage, et la nature humaine, sans reprendre leur souffle. Il y a bien une trentaine de personnages, et chacun est aussi important, même quand on ne le voit que trois pages, que les deux héros Hank et Lee. Chacun a son dilemme, son combat, ses amours, ses peurs et ses lâchetés, sa façon de parler, de bouger. De l’Indienne réprouvée à l’agent immobilier, du blanchisseur au tenancier de bar, en passant par le délégué syndical, la demi-mondaine française, le Patriarche irascible, les deux chanteurs de country, le cousin optimiste, la chienne opiniâtre, tous forment une ronde qui tourne et s’emballe pour marquer obstinato la mesure derrière le jeu d'amour et de mort qui se noue entre les deux fils Stamper au milieu de la pluie et du brouillard de ce putain d’Oregon. Pas étonnant finalement qu’ayant écrit un tel bouquin, Ken ait eu soudain comme une grande envie : celle de souffler un peu après avoir effleuré de si près, et avec tant d’acharnement, toute cette comédie humaine qui n'a de comédie que le nom.