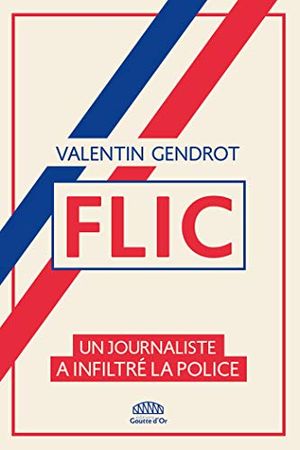L’actualité récente a poussé plusieurs journalistes à prendre la parole, pour alerter sur la situation critique de l’institution policière en France. Après le brûlot Un Pays qui se tient sage de David Dufresne, Valentin Gendrot propose avec FLIC un récit autobiographique, à la portée non pas prescriptive ou moralisatrice, mais descriptive et profondément empathique. Un livre essentiel pour mieux comprendre les rouages de la Police Nationale, mais surtout la psychologie des gens qui la composent.
Jusqu’à présent, aucun journaliste ne s’était lancé un tel défi : infiltrer la police. Valentin Gendrot, adepte des reportages en immersion, a osé. Il a suivi une formation express avant d’intégrer un commissariat durant six mois. Celui du 19e arrondissement de Paris, un secteur réputé sensible. Une arme à la ceinture, le journaliste sous couverture a rejoint une brigade dont certains membres tutoient, insultent et distribuent régulièrement des coups à des jeunes hommes noirs, d’origine arabe ou migrants qu’ils surnomment « les bâtards ». Ce livre dévoile les coulisses d’une profession souvent accusée de violences, de racisme et au taux de suicide anormalement élevé. Un récit urgent, tant pour les victimes des violences policières que pour les policiers eux-mêmes.
Si une telle quatrième de couverture annonce déjà la couleur de ce dans quoi le lecteur s’apprête à plonger, aucun résumé ne semble assez fort pour exprimer en si peu de mots la réalité à laquelle ces quelques 300 pages nous confrontent. On s’attend au pire, et pourtant, on en sort quand même assommé, sous le choc. Tout ce qu’on pourrait considérer comme des clichés, des poncifs liés à la police française, se réalise ; non pas une fois, mais à chaque page, chaque jour de ces longs mois d’infiltrations. Tout ce qu’on croit être de l’ordre de la bavure occasionnelle ou du fait divers compose, finalement, un quotidien étrangement monotone et routinier. Une routine terrible à laquelle nous, lecteurs, comme Valentin Gendrot lui-même, nous habituons peu à peu à supporter, voire à normaliser, au gré d’une escalade de l’inacceptable. FLIC montre ce que personne ne voit ni ne sait ; ce que personne ne soupçonne à ce degré-là. Si le documentaire de David Dufresne avait déjà permis une réflexion intelligente sur les violences policières en 2020, prenant le parti du surplomb théorique pour tenter d’intellectualiser les images, ce livre de Valentin Gendrot prend le contre-pied absolu.
FLIC ne s’interroge pas sur la violence des actes, n’en tire aucune conclusion sociologique, philosophique ou politique ; FLIC ne s’interroge pas tout court, ou finalement très peu. C’est un journal intime dont le rôle premier est de décrire un quotidien : celui d’agent de la Police Nationale, depuis l’école où on les forme jusqu’au commissariat où ils exercent. Les policiers que Valentin Gendrot rencontre sur sa route, et qui sont les seuls protagonistes de son histoire, ne seront jamais « jugés » par le journaliste, à proprement parler. Celui-ci se contente d’exposer les faits, de décrire telle ou telle mission routinière – des actions les plus insignifiantes en apparences aux événements les plus tragiques –, de rapporter des discussions WhatsApp ou de restituer des conversations réelles. Témoin impuissant de sa propre histoire, Valentin Gendrot se garde bien de tirer des conclusions sur le bien et le mal dans ce qu’il voit, dans ce qu’il vit, sinon à travers ses propres ressentis émotionnels du moment – allant de l’horreur à l’indifférence la plus coupable –, et que sa position de journaliste infiltré ne rend pas moins dévastateurs. Car cette parenthèse dans la vie de Valentin Gendrot n’en demeure pas moins une période de deux ans de vie commune avec tout un tas de personnes, qui, même quand elles nous apparaissent détestables, sont toujours d’une certaine manière sujettes à l’empathie du narrateur, à force de les côtoyer. Ainsi, si l’indignation est palpable au fil des mésaventures de Valentin Gendrot, celle-ci ne bascule jamais dans la haine ou le mépris – et c’est ce qui fait la force à la fois intellectuelle et émotionnelle du livre. FLIC ne cherche pas à prendre parti, à dénoncer un « camp » après s’y être malicieusement infiltré, comme pour faire tomber la tête d’un roi. Au contraire, FLIC se sert de l’infiltration pour accéder à ce qui, autrement, serait resté tu : qui sont ces policiers, que pensent-ils, qu’aiment-ils, que détestent-ils, comment conçoivent-ils leur métier, quels sont leurs rapports aux citoyens, leur sensibilité et leur conception du bien. La peinture est celle des individus, non d’une institution.
Pour autant, la répétition des comportements est telle que, tout empirique que cette étude puisse être, il est impossible, pour nous lecteurs, de ne pas en tirer des conclusions alarmantes sur la situation institutionnelle à grande échelle. Ce ne sont pas des cas isolés, quoi qu’en dise le gouvernement actuel pour éviter toute réflexion en profondeur. Il y a un problème d’individus, c’est certain ; mais ces individus eux-mêmes ne sont responsables, au fond, qu’en seconde instance. Dès le début, FLIC prouve à quel point le problème de la police provient des écoles, des centres de formation : tout le reste n’est que la continuation de ce qui s’y joue déjà, à ce moment-là. Les problèmes que constate Valentin Gendrot quant au racisme, au sexisme, à la virilité, au fait d’incarner le pouvoir et la justice, de porter une arme et d’avoir « tous les droits », sont déjà des réalités dès les premières pages consacrées à sa formation. La réalisation de ces comportements se traduira, plus loin, par divers passages à tabac de gamins de 15 ans pour le seul motif de leur insolence, d’inactions face à des femmes venues avertir des menaces de mort proférées par leurs maris, d’insultes homophobes envers des détenus et autres bizutages de collègues à la limite de l’agression sexuelle. La restitution des situations est d’une telle précision, les dialogues d’une telle banalité déconcertante, que les 300 pages de FLIC se dévorent comme un roman à suspense. À ceci près que les victimes sont réelles, que des flics se suicident à la fin, et que nous en venons, à la suite de Valentin Gendrot, à culpabiliser nous-mêmes d’avoir été les témoins, à la lisière du voyeurisme, d’une réalité révoltante sans n’avoir rien pu y faire – et sans avoir la moindre idée, en refermant le livre, de comment tout ceci pourrait changer.
FLIC s’intéresse aux policiers lambdas, mais ne fait pas détester les flics pour autant. Eux-mêmes sont les dommages collatéraux d’une institution malade, reproduisant des schémas répressifs et intolérants qu’ils ne sont pas vraiment conscients d’incarner, parce que leur métier est tout aussi précaire que la situation sociale de ceux à qui ils s’en prennent dans la rue. Et l’inaction mêlée de déni de la part des hautes sphères donne à la situation une couleur amèrement kafkaïenne. À qui la faute ? On ne sait pas, on ne sait plus. En attendant, les désespérés s’étripent et se haïssent, quel que soit leur camp.
« Je rembobine le film de l’intervention. Il commence comme une intervention anodine. Un tapage en plein après-midi. Des gamins qui éteignent leur enceinte. Un flic énervé qui leur parle comme du poisson pourri (“vous commencez à nous faire chier”). Un gamin qui répond : “On n’a rien fait”. Le même flic qui tapote la joue du gosse et, par ce geste inutile et absolument hors de procédure, l’humilie volontairement devant ses potes. Par orgueil, le gamin répond à la provocation physique par une provocation orale (“je te prends en un contre un”). Le flic met le premier coup, il n’en reçoit pas en retour, mais en distribue un nombre considérable, insulte le gosse, l’embarque en garde à vue et le frappe encore à de nombreuses reprises. Ça s’appelle une bavure. Et encore, une bavure sous-entend qu’il y a dérapage, or j’ai le sentiment d’avoir davantage assisté à une agression physique et gratuite. Nous aurions pu confisquer l’enceinte et nous en aller. Ou ne rien dire et repartir. Ou même embarquer le gamin pour outrage (ce qui aurait déjà été contestable, étant donné que le premier outrage venait de chez nous). Mais il s’est fait tabasser. Le plus effarant, n’est-ce pas mon attitude passive et, pire encore, celle, mutique, des autres collègues plus capés que moi ? Car c’est bien ma seule excuse dans l’échelle des responsabilités : je suis le bleu, le planton, l’ADS [auxiliaire de sécurité], celui qui se trouve le moins en capacité de m’interposer face à quelqu’un qui, de facto, est un “supérieur”. Derrière un écran d’ordinateur, Xavier et Mano passent la fin de leur journée à rédiger le procès-verbal d’interpellation (PVI). […] Je comprends très vite la manœuvre. Ils vont charger le gamin et absoudre Mano de toute responsabilité. Il a gardé son sang-froid et n’a commis aucune violence. Il va même jusqu’à se poser en victime. Je rêve. Mon collègue décide de déposer plainte contre le gamin pour outrage et menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique. […] Le rapport n’est pas terminé, on va rester de longues minutes dans ce bureau à écrire ce texte mensonger et éloigné des faits. »
[Article à retrouver sur Le Mag du ciné]