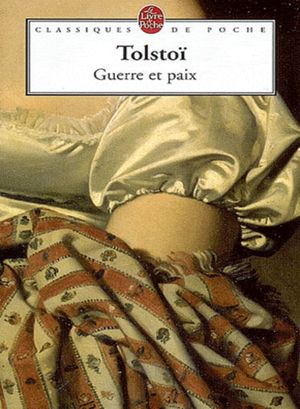2000 pages. Près de deux mois d’une lecture assidue et quotidienne m’auront permis de venir au bout de ce qu’Albert Camus considérait comme une des plus grandes œuvres littéraires au monde. Un ami m’avait fait part qu’il y avait, selon lui, « un avant et un après » à la lecture de cette œuvre. Je ne peux aujourd’hui qu’acquiescer.
Si je me suis plongé à la lecture de ce récit de Tolstoï, je dois l’avouer, c’est bien par la hype montante, en cet automne 2023, autour du film « Napoléon » de Ridley Scott, et ceux, bien avant sa sortie et les critiques terribles qui vont l’accompagner. Alors que celui-ci est en salle il depuis plus d’un mois et demi maintenant, je n’irai très probablement jamais le voir. Mais l’idée d’aborder le personnage de Napoléon par la littérature et le point de vue russe m’était séduisante. Et bien plus que le personnage de Bonaparte, qui est au final relativement peu présent de l’œuvre de l'écrivain russe, c’est bien une réflexion sur le pouvoir, qui fait que les êtres humains, de façon épisodique, mais récurrente, s’entretuent sur des champs de bataille immenses, pour leurs rois, empereurs ou tsars, qui m’interpelle tout au long de ma lecture.
Plus encore, c’est par l’élan romanesque qui souffle comme le vent d'hiver sur les plaines du Don que je me fais happer et arracher par l’histoire tragique des familles Bézoukhof, Bolkonsky, Rostov, Kouraguine et Droubetskoï. Rarement mon cerveau n’aura produit autant d’images cinématographiques à la lecture d’une œuvre littéraire. Des images d'une Troïka fendant la nuit d'hiver, de forêts glacées, des lacs gelés, des églises de Moscou, des palais de Saint-Petersbourg, des colonnes d’artillerie à Austerlitz et à Borodino, en passant par l’immense propriété des Bolkonsky, à Lyssia Gory.
À tous celles et ceux qui lieront jusqu'ici mon humble « critique » (ce n’en est pas une, je n’en ai pas l’ambition ni même l'envie), je n’ai au final qu’un message à vous faire passer : surtout, ne soyez pas effrayé face la taille de cet ouvrage et l’ampleur de la tâche que représenterait sa lecture. Lire « Guerre et Paix », c’est facile. C’est comme contempler une cathédrale. Par exemple, la façade de celle de Strasbourg. C’est terriblement facile, il suffit de laisser glisser ses yeux sur le monument, et l’on est alors fasciné par les innombrables détails et nuances qui ornent celui-ci pour, bien souvent, se poser une question : comment des hommes ont-ils pu bâtir cela ?
Alors que je clos cette cathédrale littéraire, par une nuit d’hiver à Berlin, je me demande alors, comment un seul homme a-t-il pu écrire cela ?