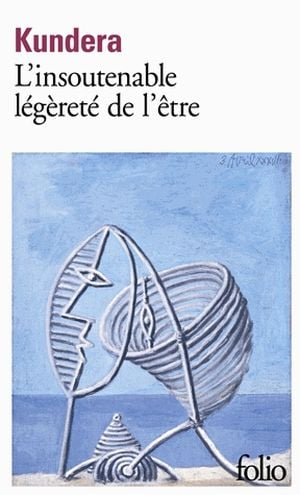À premier abord, j'avais de grandes attentes pour ce livre. Le titre m'intriguait particulièrement par sa poésie qui invite déjà à une réflexion sans même avoir ouvert le roman. Pourtant, je crois bien que j'ai été déçue par L'insoutenable légèreté de l'être.
Je ne suis pas sûre d'avoir réussi à bien faire le lien avec ce titre qui m'a attiré et l'histoire qu'en a tiré Kundera. En effet, cette histoire, ou plutôt cet entremelât de vies, m'a paru plate et n'a pas résonné avec l'idée que je me faisais du livre. Je pensais en fait lire quelque chose qui allait bouleverser ma vision des choses, m'inviter à une réflexion bien plus poussée, c'est du moins ce que le titre m'évoquait.
Bien sûr, quelques passages m'ont paru intéressants, il m'est arrivé de plier quelques pages ici et là pour les retrouver. J'ai notamment apprécié la réflexion que l'auteur a développé sur ce qui fait l'unicité du moi : cette part d'inimaginable que l'humain porte en lui. Plus tard, dans un autre passage, Kundera explique que le roman n'est pas un biais de création pour l'auteur, mais plutôt un laboratoire où explorer les possibilités jamais vécues de son moi. Cette idée m'a aussi plu.
Pourtant, ça ne m'a pas suffit pour que le livre me marque. Pour être honnête, si je devais en résumer l'histoire, je ne saurais même pas quoi dire. J'ai l'impression d'avoir oublié tout, comme si le contenu du roman s'était évaporé aussitôt que je l'ai fermé pour la dernière fois. Peut-être est-ce le centre du livre après tout. Une manière efficace de démontrer en quoi réside l'insoutenable légèreté de l'être.