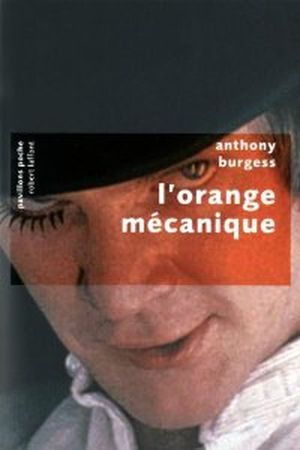Anthony Burgess avait, dans ses dernières années, une très grande crainte : celle de ne demeurer dans les mémoires qu'en tant que l'écrivain qui avait inspiré Stanley Kubrick pour « A Clockwork Orange ». Burgess ne comprenait pas même pourquoi un tel engouement réunissait les lecteurs autour de l'Orange Mécanique : au regard du reste de son œuvre, cette brève "novella" n'était bien qu'une bagatelle, une « coïonnerie » à la Voltaire. Et pourtant... Mister Burgess a eu bien raison de craindre la notoriété de son roman, car ce petit livre regroupe absolument tout.
Le monde de « A Clockwork Orange » nous dévore les yeux à chaque page ; immeubles délabrés, graffiti aux murs et prison aux cellules étriquées, tout prend corps sous les mots de Burgess, toute une esthétique baroque et rugissante. Mais, au surplus, que ce monde fût vide ne changerait pas grand-chose : les ascenseurs éventrés et les rambardes éreintées ne prennent vie, ne s'embrasent que par le regard de notre Little Alex. Les phrases démesurément longues, tantôt saccadées, tantôt bondissantes, nous livrent un terrible tourbillon de couleurs et de mots que les "droogies" auront à cœur de dévaster.
Mon seul regret est bien que l'univers d'un Kubrick me trotte encore trop souvent dans l'esprit, tiens...
Nous y voilà : Kubrick. Burgess et Kubrick, Kubrick et Burgess ; chaleureux ennemis. Catholique fervent et défenseur infatigable de son œuvre, Anthony Burgess n'aura de cesse de convaincre le monde littéraire de la rectitude morale de l'Orange Mécanique. Bien qu'il désapprouve la violence du film (qu'il soupçonne un temps de pornographie), Burgess assurera sans trêve une éclatante promotion à l'adaptation de Kubrick, alors même que celui-ci se désintéresse d'une campagne trop moralisatrice pour qu'il y goûte.
Ainsi, « A Clockwork Orange », une utopie dégénérée mais très catholique ?...
« He has no real choice, has he ? – We are not concerned with motive, with the higher ethics. We are concerned with cutting down crime. » Tout est dit. N'attendez pas de Burgess une morale de grenouille-de-bénitier, de ces œuvres réputées « chrétiennes » et qui vous font bailler d'ennui dès avant la première page. Un fils d'homme jeté dans la grande machine-État, un grain de sable broyé entre les engrenages sécuritaires, un phénomène médiatique que se déchirent deux camps tout autant carnassiers, voilà la droiture de l'œuvre. Un catholicisme âpre, hanté.
Mais plus encore, l'on contemple le gâchis d'une vie : interrogé sur le sens de son titre, Burgess avait proposé entre autres explications que tout son récit n'était qu'une vaste orange mécanique : elle tourne sur elle-même et revient à son origine, mais rien n'a changé ; seule une existence encore jeune a été dévastée dans la manœuvre. Mais Burgess ne renonce pas. Un étrange optimisme désespéré, un humanisme battu aux vents, qui s'explique amplement par la genèse même du livre : le professeur F. Alexander, qui assiste impuissant au viol et au meurtre de sa femme, n'est autre que Burgess lui-même dont l'épouse fut battue à mort en 1944 à Londres, par quatre GI déserteurs. On comprend dès lors la noblesse d'un homme brisé, chrétien ardent mais rongé par l'idée de pêché, qui refuse le conditionnement de l'Homme et lui préfère le libre-choix de la conscience – quitte à y perdre les êtres chers à son cœur. La violence, Burgess l'extirpe de sa propre vie.
« Un homme qui renonce à choisir n'est plus un homme » écrit-il.
Burgess, c'est le courage.
Pourtant, bien au-delà de la morale, l'œuvre révèle des passages encore inexplorés, ceux du langage.
Jamais travail sur le langage, sur les mots, ne fut aussi abouti que sous la plume de Burgess ; bien sûr, il y a eu Joyce : mais celui-ci maniait le slang brumeux de Dublin pour son « Ulysse », la langue croquée des bas-fonds irlandais, un dialecte qu'il humait au coin des rues. Rien de cela pour Burgess : son langage, le « nadsat », est forgé dans les profondeurs d'une bibliothèque, et à grands renforts de dictionnaires russes. Langue de la dépravation, du clan, mais avant tout langue des esprits formatés : notre Alex ne parle pas tant nadsat, il pense nadsat. Et le russe en cela, pourquoi le russe ? Un coup de génie de Burgess, expliqué plus tard par l'auteur lui-même : le lecteur, s'il veut comprendre ce baragouinage qui se déploie avec fureur à longueur de pages, devra plonger son esprit britannique dans les abîmes de la syntaxe russe, pour tenter d'en démêler toutes les intrications. Burgess déforme le lecteur, formate son esprit, le noie dans les torrents du nadsat ; c'est admirable à quel point, passé quelques chapitres, les barbarismes slavo-britanniques nous coulent si naturellement à l'oreille, et comme les « slovos » (« Words, that is ») d'Alex continuent de flotter au milieu des autres mots de Shakespeare, tout simplement. Pour cent quarante-et-une pages, nous nous sommes promenés dans les délires de Notre Humble Narrateur, nous avons été Alex ; qui en réchapperait indemne ?...
Il est d'ailleurs singulier que, dans l'esprit de Burgess, le nadsat atténuait grandement la violence de l'œuvre en masquant les termes brutaux ; bien au contraire ce langage, âpre, râpeux, ravageur, fait voler en éclats le rempart des mots et nous propulse dans l'âme dévastée des « droogies » en quête de hurlements.
« Ce ne fut certainement pas une joie pour moi de décrire les actes de violence lorsque j'écrivais le roman ; ma propre frénésie à ces descriptions me rendait malade. » Burgess ne s'est pas trompé : entre fascination nauséeuse et répulsion délectable, les éclats écarlates de « little bit of ultra-violence » nous promènent à la frontière du dégoût, mais sans jamais basculer dans le précipice. On se découvre pervers, à vouloir en lire toujours plus. Nous sommes Alex.
Qui voudra plonger à la rencontre de l'Orange Mécanique n'en ressortira pas déçu ; mais pas non plus intact.
Un brûlant chef-d'œuvre.