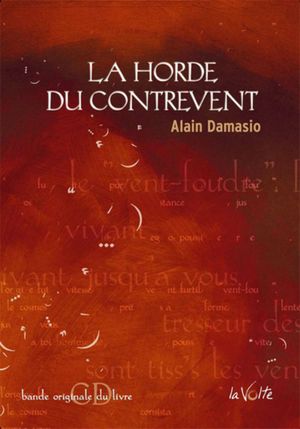La Horde du Contrevent n’est pas un livre mal écrit mais pose la question de savoir ce qu’est un livre bien écrit.
Avant cela, si on veut être mauvaise langue, on trouvera que le récit met tous les clichés de l’épopée de science-fiction (1) dans un grand fait-tout et les laisse à cuire longtemps : une nature hostile, quelques combats sans fin, un vieux maître d’armes qui réapparaît juste à temps pour tirer d’affaire son ancien disciple, des personnages catalogués qui se lancent dans des considérations pseudo-psychologiques ou pseudo-métaphysiques loin d’être toujours convaincantes…
Pourtant le roman pousse à la mansuétude, ne serait-ce parce qu’il pue le plaisir. Il donne envie de le lire comme certains d’entre nous lisaient à dix ou douze ans, c’est-à-dire en ne sortant de l’histoire que pour se laver, se nourrir ou dormir – et encore. Plaisir partagé ? Je ne suis pas écrivain, et peut-être la Horde est-elle née avec de longues douleurs, mais j’imagine que si l’écriture d’un roman long, complexe et lisible pouvait donner du plaisir à son auteur, ce serait la Horde du Contrevent. (Je parle bien du plaisir pris à l’écrire, pas à l’avoir écrit.)
Mais ce qui échapperait sans doute à la majorité des gamins de dix ou douze ans qui auraient l’idée de se plonger dans cette œuvre, c’est qu’elle propose un travail sur la langue – point à partir duquel on peut parler de littérature. Et là, je ne parle pas de la maîtrise de la langue, qui devrait être la condition sine qua non de toutes les œuvres littéraires publiées ; disons que celle-ci ne respecte pas toujours certaines règles d’accord, de syntaxe ou de conjugaison (2). Ceci dit non pour faire le pion, mais pour regretter qu’un auteur ambitieux se pique à ce genre d’épines, à la façon d’un architecte qui entendrait dessiner le plus beau bâtiment du monde et qui oublierait une partie de l’installation électrique ou de la plomberie.
Certes, le style du roman n’est pas si mal par rapport à ceux qu’il côtoie sur les étagères des rayons « Imaginaire » des librairies (3), et même par rapport à ceux de « Littérature Générale ». Mais que la plupart des critiques – et la quatrième de couverture de l’édition « Folio SF », qui est un véritable sketch ! – insistent sur la qualité de ce style, ça me paraît exagéré, en plus d’être inquiétant pour les autres auteurs. En-dehors de deux ou trois personnages, et encore, les considérations psychologiques sentent le réchauffé, et les dialogues ne sont pas des réussites – ce qui devient pénible dans la deuxième moitié. C’est encore dans la narration pure que l’écriture de la Horde du Contrevent est la plus efficace.
Je ne parle pas non plus de la narration multiple : Alain Damasio n’est pas Laclos, la Horde du Contrevent n’est pas les Liaisons dangereuses – qui n’existeraient pas sans polyphonie. Mais ici la variété des styles – en réalité quatre ou cinq : ceux des personnages principaux – donne surtout du souffle à ces sept cents pages, dans la mesure où la répartition de la parole anime la répartition des rôles qui étaient assignés aux personnages avant même le premier chapitre : le Golgoth bourru, le scribe mélancolique, le prince digne, les femmes fragiles et sensibles… Les personnages existent réellement par ce qu’ils disent, comme ceux d’une pièce de théâtre : l’épigraphe est justement inspirée de Shakespeare – la Tempête, forcément !
Car voilà : la langue de la Horde du Contrevent donne vie à tout un univers. Que cet univers de fiction rappelle pas mal de livres, films ou jeux vidéo qui ne sont eux-mêmes pas des créations entièrement originales (4), qu’on ait droit au vieux sage rabougri qui à sa façon étrange parle – lire : « macaque », traduire : « padawan » –, cela passe au second plan. Au bout du compte, tout convenu qu’il apparaisse sous certains aspects, l’univers dans lequel évoluent traceur et sourcière, feuleuse et aéromaître est incroyablement riche.
Et c’est là que la langue joue son rôle. À cet égard, les inventions lexicales qui émaillent la Horde du Contrevent, pour s’en tenir à cet aspect, sont d’une efficacité qui n’exclut pas la poésie. La richesse du vocabulaire, les néologismes récurrents (géomaître, l’Hordre, les ærudits, etc., mais sont-ils encore des néologismes au bout des sept cents pages ?), les jeux de mots qui de prime abord pourraient sembler gratuits (sorcière / sourcière, l’outre / loutre, « Tu te sens prêt ? / – Près oui, mais de qui, Sov ? »…), la notation des vents, les contraintes oulipiennes dans l’épisode du duel verbal (chapitre XII) : tout finit par être extrêmement cohérent – en plus de faire naître, pour tout amateur de littérature, y compris les enfants dont je parlais au début de cette critique, le plaisir dont je parlais au début de cette critique…
Dans plus d’une épopée de science-fiction, à partir d’un certain niveau – on peut prendre le mot dans le sens qu’il a dans les jeux vidéo –, les personnages se désincarnent, tendant à devenir de purs souffles, ou de purs esprits, ou de pures consciences (5)… Ce moment vient assez tôt dans la Horde du Contrevent, dont la dimension dépasse vite celle du simple roman d’aventures. Alain Damasio semble avoir plaisir à le montrer.
Que la Horde, avec ses frictions, ses moments de grâce et ses variations, puisse être la métaphore de n’importe quelle personnalité (« l’Hordre a souhaité fragmenter, de façon tout à fait intentionnelle, le savoir que plusieurs d’entre nous ont reçu de leur formation », Oroshi, p. 355), que sa quête figure une existence qui jusqu’à son terme demeure initiatique (« Qu’est-ce qu’on en savait de la distance qui restait à parcourir pour atteindre l’Extrême-Amont ? Si même cette distance n’était pas infinie… », Pietro, p. 513), que la cité d’Alticcio soit une de nos métropoles modernes à peine transposée, entre autres, ça paraît vite évident.
De là, me semble-t-il, vient l’impression que l’auteur prend ses lecteurs par la main. Il faut attendre six cents pages (p. 92) pour qu’un personnage émette l’idée que « tout ce qui avait pu être dit et gravé à ces sujets [la fin de l’épreuve] ne témoignait de rien d’autre que de cette même doctrine de l’épreuve et de la récompense qui postulait un univers moral, une fin à toute quête et une terre aux dimensions parcourables – ce que rien n’étayait ». Je crois que n’importe quel lecteur – n’importe lequel des lecteurs sur lesquels Damasio table – s’en était aperçu bien avant.
Si je m’étais senti d’humeur, j’aurais tenté d’aborder la Horde du Contrevent par son versant philosophique – le nietzschéisme lu par Deleuze qui en structure l’ensemble – ou parlé de la pagination à rebours – qu’y a-t-il en dire, d’ailleurs ? Mais cette critique n’a que trop duré.
(1) Que ce soit dit une fois pour toutes : j’utilise ici science-fiction dans un sens large. J’admets volontiers que des lecteurs plus trempés que moi dans le domaine, ou plus portés sur les classifications, disent que ce n’est pas de la science-fiction, ou pas vraiment, ou pas seulement… Il y a les romans, bons ou mauvais, dont les seuls codes que je connaisse indiquent qu’ils s’agit d’histoires imaginaires écrites, longues, avec des personnages. À la rigueur, la discussion peut avoir lieu entre roman et épopée.
(2) Par exemple et respectivement : « Tout le monde se regardait, ébahis, suspendus » (p. 358), « Moins que tout autre, Golgoth ne supportait » etc. (p. 624) et « [nous] n’eument » (p. 22).
(3) Je mets à part Jacques Abeille et Mark Danielewski traduit, quand on les trouve dans lesdits rayons.
(4) En gros, toute une galaxie dont Dune serait la matrice. Cependant, la borgesienne bibliothèque d'Ær, par exemple, ou l’épisode de la Tour Fontaine, très arthurien dans l’esprit, appellent d’autres influences.
(5) C’est le moment, dans les jeux de rôle d’heroic fantasy, où le héros apprend qu’il est l’Élu, ne ramasse même plus l’or des donjons qu’ils explore et couche une demi-douzaine d’orcs en soufflant dessus.