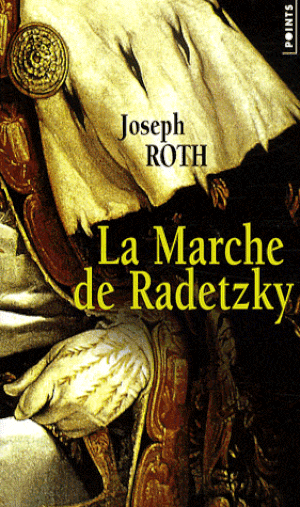Les dernières pages de la « Marche de Radetzky » sont douces et saisissantes. Tellement douces et saisissantes qu’elles m’ont saisi le cœur, l’estomac puis la gorge. Ces divers saisissements me sont ensuite remontés dans les yeux et je dois concéder que comme le préfet Von Trotta apprenant la mort de son fils deux belles et lourdes larmes de cristal me sont venues. Cette émotion qui monte et ressort est bien rare en littérature, il y a très peu de romans aussi émouvants que celui-ci (enfin pour moi). Roth passe de la tristesse de caserne à la désillusion, du sournois cheminement vers l’inéluctable à la présence vérifiable de cet inéluctable. Pourtant, ce ne sont pas seulement des hommes qui meurent, un monde qui s’écroule (les Habsbourg et le village initial), les hommes et les mondes sont faits pour s’écrouler, c’est leur nature que de s’écrouler, non c’est aussi et surtout l’intuition qu’il nous faut avoir pour pouvoir voler des instants à la fuite et à l’écroulement généralisé, cette intuition, l’intuition de Roth qui le fait vivre, et écrire, « à l’extrême bord du néant, comme si tout allait pour le mieux ».