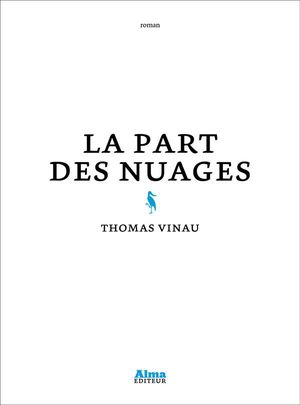Prendre un Thomas Vinau dans la pile à lire c’est comme savoir à l’avance qu’on va passer un bon moment, qu’on va retrouver ce lieu paisible et un peu triste, qu’on va adorer les mots et leur enchevêtrement délicieux, qu’on va retrouver le sens de la nature, le lien à la terre. Les premières lignes réveillent le bruit de l’herbe vagabonde, l’odeur de l’orage d’été, la caresse du sucre des cerises. La poésie de Thomas Vinau happe tous les sens et les reconnecte avec l’essentiel. La simplicité devient d’une beauté sans égale. Les choses de la vie reprennent de l’ampleur, l’esprit habite chaque petite chose.
Dans ce roman, nous suivons Joseph qui dérive lentement. On comprend que sa femme est partie et qu’il s’accroche à son jeune fils Noé pour ne pas couler. Mais les vacances arrivent et la bouée de sauvetage vogue vers d’autres flots abandonnant notre marin en pleine mer. J’ai directement été prise d’affection pour cet homme auquel le quotidien échappe et qui se réfugie en haut d’un arbre pour se retrouver. Joseph se crée un sanctuaire dans lequel il peut être l’enfant qu’il a oublié et ne pas se soucier du monde qui continue de tourner. Le temps se dilate et n’a pas plus de prise, on s’attarde avec plaisir dans les réflexions et les errances de cet homme en quête de sens.
Les autres personnages sont peu nombreux mais ajoutent une valeur forte au roman. Il y a ce vagabond qui vit lui aussi en hauteur, sur les toits de la cathédrale où il va emmener Joseph. Un robinson des villes comme le laisse entendre son nom. Il y a aussi Lilith la voisine, espionnée gentiment, qui joue de la clarinette et qui pleure à cause d’un homme. Mais il y a surtout Odile, la tortue que Joseph trimbale partout avec lui. Le petit animal devient peu à peu un être à part entière auquel le lecteur s’attache. C’est le garde-fou du personnage :
« Odile s’est fait la malle. Il se redresse en vrac, trébuche à moitié, regarde autour de lui. Si elle est tombée dans le bassin,c’est foutu. Elle n’a pas pu retourner dans la rue, tout de même. Faire du stop ou prendre le bus. Il monte sur le banc pour voir plus loin. S’accroupit en dessous. Fouille dans l’herbe. Jette un œil dans la poubelle sans trop savoir pourquoi. Il n’a pas les yeux en face des trous. La sueur lui gratte le cou… »
Si l’on n’y prêt pas attention au début du roman, les prénoms se colorent petit à petit d’un symbolisme fort. Ces figures bibliques ramenées à l’humain viennent enchanter la narration. Noé apparait définitivement comme le seul qui puisse sauver son père. Au retour de ses vacances, l’enfant rapporte avec un lui un hérisson chétif qu’il s’est mis en tête de sauver. Le petit animal va faire son entrée sur l’arche, lui aussi est sauvé des eaux.
La nature est un élément permanent dans le roman, c’était déjà le cas dans « Ici, ça va ». Elle devient presque un personnage. Les éléments se mêlent, mélangent les sens et titillent les sensations. Les nuages prennent une allure mystique et magique. On a envie de lire au jardin pour nous aussi être en communion avec l’espace, communiquer avec les trèfles et les bêtes à bon dieu. Je ne vais pas m’étendre plus sur cet excellent roman et plutôt vous laisser avec quelques morceaux choisis qui seront bien plus parlant que tous mes verbiages laborieux :
« De la morve se mélange au sucre au-dessus de ses lèvres. Son père le regarde se salir. La crasse est le costume de sa liberté. La crasse est un cheval sauvage. Les adultes sourient en voyant leurs enfants se salir. C’est une procuration pour galoper à cru dans les plaines. Son père a les mains propres et ils se sent minable. »
« Ça bouge au-dessus de nos têtes. C’est la grande lessive bleue et le créateur de l’univers est une femme de ménage. Il faudrait s’ouvrir le crane comme une boite de conserve. S’enfoncer l’horizon dans les yeux. Avaler les glaces du ciel. Il faudrait passer une serpillière de neige dans son ventre. Que la brise arrache les peux mortes. Qu’on monte comme une particule d’eau stratosphérique dans la chaleur de l’aube. Comme une araignée dans une bulle. Qu’on passe son cœur au Kärcher de la lumière. Il faudrait retourner là-haut, dans les nuages. »
Critique à retrouver sur: Le mouton curieux