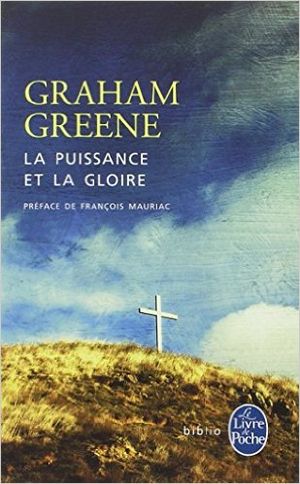Il n’y a que deux sortes d’hommes : les uns justes, qui se croient pécheurs ; les autres pécheurs, qui se croient justes.
Blaise Pascal, Pensées
Psychologie du tyran
Combien curieux il est de lire, après plusieurs essais sur le totalitarisme, un roman chrétien et d’y trouver ce qu’on avait cru laisser : un régime totalitaire. Ce que Bernanos ou Havel décrivent, et qu’un Français d’aujourd’hui voit du reste si bien lui-même (il n’est que de porter ses regards autour de soi et, voici ! la lâcheté, la peur, le déni vous sautent aux yeux), est romancé par Graham Greene dans La Puissance et la gloire. Le roman se passe au Mexique dans les années trente, mais c’est un roman qui a des allures de réalité, et les kiosques à musique que le personnage principal rencontre dans tous les villages où il passe ont beau être silencieux, le lecteur français contemporain croira néanmoins entendre les airs d’une douce France pétainiste, d’une France soumise aux diktats d’un young global leader sans racines ni honneur ni dignité, foutriquet et assassin de masse avide d’oblitérer le passé pour se faire démiurge d’un monde neuf.
Aucun personnage, dans ce Mexique présenté par Greene, n’est vraiment comparable à l’actuel Président de la France. Pourtant nous est offert, en la personne d’un lieutenant de police communiste, le portrait du tyran. Ce lieutenant voit jouer à la guerre des enfants et, nous dit le narrateur : « Il voulait éliminer de leur enfance tout ce qui l’avait rendu, lui, si malheureux : toute la pauvreté, la corruption, la superstition. Ils méritaient la vérité, et rien de moins que la vérité ; dans un univers vide, un monde qui se refroidissait, le droit de faire leur bonheur comme bon leur semblait. Il était prêt à se livrer pour eux à un massacre – d’abord l’Église, ensuite les étrangers, et enfin les politiciens – son propre chef lui-même devrait y passer à son tour. Il voulait recommencer le monde avec eux dans un désert. » (p. 97) On voit, dans le tyran, un sale gosse qui n’a pas su devenir adulte et qui, remâchant jusqu’à l’obsession les griefs de son enfance, veut se venger sur la société entière en trouvant cela juste, comme l’enfant qui fait un croc-en-jambe à celui qui lui a volé ses billes et, devant les genoux ensanglantés de son camarade, s’écrie C’est bien fait pour toi !
Il y a quelque disproportion à comparer sans nuances ce lieutenant et la parodie d’être humain qui gouverne actuellement la France : n’ayant qu’un modeste pouvoir, le lieutenant, bien que captivé par une idéologie monstrueuse, reste capable de charité. Il est un tyran en ceci : il exécute les hommes du peuple qu’il veut sauver, si ceux-ci refusent le salut qu’il leur offre. Il veut fusiller les prêtres pour sauver le peuple de la domination ecclésiastique ; mais qu’un membre du peuple s’avise d’aider les prêtres, refusant ainsi la liberté que leur propose le lieutenant de police, voilà qui le fait sortir de ses gonds. C’est par amour du peuple qu’il commet ces exactions. Il va, « cachant sous sa figure de haine ce lourd secret d’amour » (ibid.), un amour dénaturé par son orgueil, parce que, déniant à Dieu la primauté de l’amour, il se fait dieu lui-même en revendiquant pour lui le droit à être la source de l’amour. Lewis écrivait : « L’amour peut parfois se composer pour ses neuf dixièmes de haine, et pourtant se prétendre toujours amour. » (1) Or, puisque le lieutenant n’a pas le pouvoir de chambouler le monde pour le façonner à son image, sa haine d’amour est freinée et fait place, parfois, à la charité : au moment de libérer un homme emprisonné pour un délit, il lui donne de l’argent, pour qu’il puisse subsister le temps de trouver de quoi subsister encore.
Ici, nous sacrifions sans utilité la jeunesse
Mais qu’importent les états d’âme de l’individu ? Dans un totalitarisme, le système agit à travers eux et broie tout. Les cas de conscience n’intéressent pas le système, les élans de générosité non plus ; pour étudier un système totalitaire, il ne faut pas être psychologue, ou bien on s’expose à un paradoxe insoluble : pourquoi le système persiste-il, alors que tant d’individus, soit sont contre, soit s’en moquent, soit se languissent d’en être débarrassés ? Non, Zinoviev nous l’a appris (2) : il faut réfléchir en sociologue pour comprendre un tel système, car ce que pensent les individus n’a aucune influence sur la société où ils vivent. Le lieutenant peut bien chasser les chrétiens par amour du peuple, et faire l’aumône aux prisonniers : la société que lui et ses semblables ont bâtie n’est pas pour autant celle de l’amour ou de l’empathie. C’est plutôt l’apathie qui est de mise. Pour le dentiste ivrogne : « L’ennui… c’est qu’il n’arrivait jamais rien. » (p. 80) Pour un chrétien qui doit cacher sa croyance afin de n’être pas accusé de trahison envers la patrie : « Personne ne passait dans la rue, rien n’arrivait. » (p. 87) Et le lieutenant de police même, après avoir mené à bien la mission qui l’occupait depuis si longtemps, ne parvient qu’à esquisser « une étrange grimace amère où ne brillait ni le triomphe, ni l’espoir. Il faut se contenter de peu pour commencer. » (p. 317) Nous voilà comme dans l’URSS décrite par Zinoviev : pas d’espoir que l’avenir apporte un changement. De sorte que les enfants, n’ayant pas d’avenir, n’ont pas d’enfance. D’une petite fille, on nous dit : « Ce corps de sept ans était comme celui d’une naine : il contenait une affreuse maturité. » (p.114) D’une autre petite fille : « Elle était prête à accepter n’importe quelle responsabilité, même celle de la vengeance. C’était sa raison de vivre. » (p. 73) D’après Nietzsche, l’enfant joue pour inventer les nouvelles valeurs (3) ; d’après le Christ, en jouant il fait advenir le Royaume des Cieux. Si rien de nouveau n’est attendu (pas d’espoir) et qu’il n’y a rien à attendre du Ciel (pas d’espérance), les enfants ne jouent plus. Ainsi périclite la jeunesse qu’on prétend vouloir sauver.
Étéocle et Polynice
Les défaites dépriment un peuple. Si Faulkner (4) et Musset (5) décrivent l’ennui d’un monde où l’espoir a déserté les êtres, la défaite à l’origine de cette morosité est classique : l’armée du Sud a perdu contre celle du Nord, aux États-Unis ; l’armée de Napoléon a été vaincue par l’Europe coalisée. Le cas du Mexique dépeint par Greene, de la Russie analysée par Zinoviev, de la France sous le joug macronien, est plus déprimant encore : la défaite subie par les peuples lui a été infligée, non par un peuple ennemi, mais par ses propres chefs, par ceux qui ont juré de les protéger et qui se sont parjurés en sapant leur joie et leur confiance. Les chefs communistes d’URSS et du Mexique accusent l’Église et le capitalisme, l’avorton de France accuse le covid et les non-vaccinés, mais la vérité est qu’ils ont eux-mêmes divisé le peuple, ces diables, et l’ont poussé à ramper, ces serpents : voilà le nouveau monde qu’ils entendent créer à leur image et à leur ressemblance. Ainsi donc il n’y a pas, comme il y eut de tout temps chez les vaincus, une connivence, l’espoir de se rassembler un jour pour vaincre l’adversaire et retrouver sa dignité. Non, dans le Mexique de Greene, le père José qui a renié sa foi et s’est marié pour survivre n’ose même pas se rapprocher des chrétiens qui, comme lui, ont renoncé à manifester leur religion. Il voudrait bien se racheter et aider en secret les chrétiens. « Mais, justement, le drame était là… il ne pouvait avoir confiance en personne. » (p. 83) Comment être sûr qu’on ne sera pas dénoncé ? Et non pas dénoncé au peuple vainqueur, mais à son propre peuple ; non pas aux chefs ennemis, à l’occupant, mais à ses propres chefs ? Nous n’en sommes pas encore là en France, c’est vrai ; mais qui ne voit que nous y serons bientôt ? Nous ne nous ennuyons pas et il se passe des choses : car le totalitarisme se met en place, c’est l’heure des révolutions et nul ne sait qui l’emportera, nous ne sommes donc pas encore dans l’ennui systémique. Mais tout peut devenir très ennuyeux si l’idéologie totalitaire l’emporte et si l’on doit craindre d’être dénoncé à son propre peuple, à ses propres capitaines.
Et loin de n’être que politiques, les conséquences du totalitarisme sont spirituelles. Le père José mentionné ci-dessus hésite à prononcer une messe secrète pour un enterrement ; les chrétiens qui enterrent leur proche le supplient d’accepter. Lui a peur d’être dénoncé. Il regarde la tombe, il regarde le quai derrière lui. « L’avilissement et la sécurité l’attendaient près du quai : il voulait partir. » (p. 84) Et il part, sans avoir dit la messe. En menaçant son corps, les agents du système ont amoindri son âme. La peur de mourir transforme en monstre, et pour glaner quelques années de vie, on court le risque de se damner pour l’éternité. Nous savons cela, nous qui avons renoncé à voir nos grands-parents avant leur mort, par peur de les tuer ; nous qui n’enterrons plus nos frères par peur d’être contaminés, et qui blâmons Antigone d’avoir mis en péril la vie de ses concitoyens ; nous qui ne nous sommes pas embrassés à l’Église par peur que notre prochain ne nous rende malade – mais restera-t-il longtemps notre prochain ? Avoue, tu as déjà oublié son visage sous le masque qu’il porte pour se protéger de toi…
« Vos yeux risqueraient de le prendre pour de la haine. Il est de nature à nous terroriser. L’amour de Dieu ! » (p. 314)
L’amour et la peur sont les deux forces antithétiques qui gouvernent les hommes. Ceux-ci agissent sous l’effet de l’une ou l’autre de ces forces. Mais comme chacun connaît le bien et le mal (c’est la conséquence du péché originel), l’on a honte d’agir par peur et chacun fait croire et se fait accroire qu’il agit par amour. Dans un totalitarisme, le système lui-même justifie les hommes qui évoluent en son sein et procède à une inversion – systématique – des valeurs, à l’échelle de toute la société. Orwell l’a illustré à merveille, qui fait promouvoir la haine par le ministère de l’amour, le mensonge par le ministère de la vérité (6). C’est ainsi dans tous les totalitarismes du XXe siècle, pas seulement chez les communistes : durant la guerre d’Espage, les milices de Franco fusillaient les non chrétiens, ce qui a poussé un grand nombre de gens à se faire baptiser. Les franquistes appelaient donc « chrétiens » ceux qu’ils avaient poussé à ces fausses conversions par peur de la mort, et ils se félicitaient de leur évangélisme (7) ; en France macronienne, se faire vacciner pour partir en vacances est « la solidarité », et « être responsable » signifie renoncer à sa liberté de penser et s’en remettre au gouvernement. Dans La Puissance et la gloire, la peur aussi domine. Sur un panonceau, est griffonné « d’une écriture nette et scolaire un adage empreint de facile et excessive assurance, d’après lequel l’homme n’a rien à perdre, hormis ses chaînes. » (p. 193) Sagesse d’étudiant. Sitôt arrivé le système totalitaire, la peur s’installe et, alors, l’étudiant découvre que l’homme n’a pas que ses chaînes à perdre : mais aussi la vie. Et ses chaînes peuvent lui être confortables si elles assurent aussi sa vie. Ainsi s’accommode-t-on du système totalitaire par peur, au nom de l’amour : c’est l’amour du monde et non l’amour de Dieu.
Pour deviner l’amour de Dieu, il faut observer le protagoniste du roman, un prêtre ivrogne et dont on n’apprend jamais le nom. Il est en état de péché mortel puisqu’il a couché avec une femme et que de cette union d’un soir naquit un enfant, et qu’il n’arrive pas à regretter cet enfant, qu’il l’aime, et l’aime comme il devrait aimer son prochain, ses ouailles, mais rien à faire, il aime son enfant plus que les autres êtres humains et se sait damné pour cette raison ; et il désespère. Et il sait agir sans cesse par peur plutôt que par amour. Pourtant, il est le seul prêtre à faire encore son devoir, clandestinement : il baptise, fait communier, dit la messe dans tous les villages où le conduisent ses pérégrinations, ce qui lui vaut d’être pris en chasse par les milices communistes. Mais il parle de « souffrances imposées » (p. 118), admirant les simples et les saints qui cherchent la souffrance pour plaire à Dieu tandis que lui les subit, incapable de les désirer. Il fait son devoir, non courageusement, mais parce qu’il s’y sent obligé. Des otages sont fusillés pour avoir refusé de le dénoncer, de révéler sa cachette : « L’on fait, en passant, Dieu sait quels martyrs […] tandis qu’on manque soi-même de la grâce nécessaire pour mourir. » (pp. 119-120) Il se demande comment il se fait que Dieu permette que des gens courageux meurent pour que lui survive, et pourquoi il a le pouvoir de mettre Dieu dans la bouche des fidèles alors qu’il est si indigne. Plusieurs fois il manque se faire attraper par ses poursuivants et alors la peur, qui pèse sur lui à chaque instant, atteint son paroxysme : « La peur recommençait à l’envahir. […] ou n’était-ce que le retour cyclique du désir de vivre, de vivre n’importe quelle vie. » (pp. 188-189) Dans ces moments-là en effet, il est prêt à renier Dieu pour survivre : vivre même en parjure ou en lâche, se marier comme le père José l’a fait, fuir le pays comme d’autres prêtres en eurent l’idée quand il en était temps, n’importe quoi pour échapper à la mort… Mais malgré tous ses péchés bien réels, malgré tous les blâmes qu’il s’adresse à lui-même, ce prêtre continue d’accomplir son devoir et de risquer sa vie, jusqu’à l’inéluctable fin. Persuadé de son indignité, il vit en martyr. Et si le père José, dont le mariage a permis aux communistes de montrer la faiblesse de la foi chrétienne et l’hypocrisie des chrétiens, peut paraître damné lui aussi, qui sait s’il ne continue pas de servir Dieu sans s’en douter ? Car ayant renié sa foi par peur de mourir, il se croit passible de l’enfer et porte sur ses épaules la culpabilité du monde. Ainsi souffrent les lâches et les ivrognes au service de Dieu, qui reste silencieux et laisse sans réponse leurs appels. La puissance et la gloire appartiennent à Dieu, elles sont faites de la faiblesse et de l’opprobre de ses serviteurs. Or ses serviteurs, se croyant injustes, trouvent juste qu’il en aille ainsi. C’est l’amour de Dieu et non l’amour du monde.
**La Puissance et la gloire*, 1948, éditions Robert Laffont, collection « Pavillons », traduction de Marcelle Sibon (1948)
Notes
(1) C. S. Lewis, Tant que nous n'aurons pas de visage
(2) Alexandre Zinoviev, Les Hauteurs béantes (lire ma critique)
(3) Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra
(4) William Faulkner, Absalon, Absalon !
(5) Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle
(6) George Orwell, 1984
(7) Pour en savoir plus sur l’idéologie franquiste, lire Georges Bernanos, Les Grands cimetières sous la lune
(Critique rédigée après avoir lu le livre de Graham Greene, les 29 et 30 janvier 2022.)