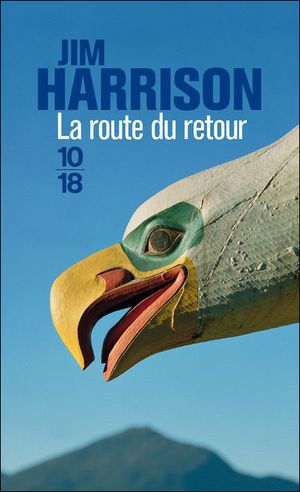Je suis un enfant de la ville et mon grand-père est un homme de la campagne.
J’ai grandi dans un petit appartement dans un petit bâtiment en brique, et en face, il y avait de grandes tours blanches maintenant grises et pales et tristes comme une fin d’après-midi pluvieuse de novembre.
Tous les jours, je prenais le métro pour aller au collège ou alors à l’entrainement si bien que maintenant, le métro me dégoûte. Un peu comme quand on mange un aliment qui nous a rendu malade il y a bien des années déjà, et que l’on a un haut-le-cœur dès la première bouchée.
Quand je sortais de chez moi, les jeunes -mais bien plus vieux que moi- qui passaient leur journée assis sur le rebord de la fenêtre de l’appartement du rez-de-chaussée qui se trouvait au coin de la rue me disaient bonjour, je restais des après-midis entiers sur un parking à faire du football, et autour du parking, il y avait des arbustes et des buissons et d’autres petits bouts de végétation sauvage, ce type de végétation qui se fraye un chemin jusqu’au milieu du béton, et parfois maintenant encore quand je marche dans la rue, un arbuste, un buisson ou un petit bout de végétation sauvage me renvoie la même odeur que celle du petit parking et j’ai de nouveau dix ans sur ce petit bout de béton et je fais du football, et quand je regardais Tom Sawyer et son Mississippi à la télévision, son Amérique verdoyante était interrompue par le moteur pétaradant d’une moto-cross passant à toute vitesse sur la route qui séparait mon petit bâtiment en brique de ces grandes tours blanches maintenant grises, et parfois, dans la nuit blafarde des réverbères, une voiture brûlée. Alors, le lendemain, il y avait une trace noire sur les tours blanches grises.
Mes grands-parents, eux, habitaient, et habitent toujours, à la campagne. Dans une belle maison avec un petit jardin devant et un petit jardin derrière aussi, et avec une petite véranda où l’on peut rester à l’ombre l’été et une cheminé devant laquelle on peut être au chaud l’hiver, et dans les jardins, il y a des arbres et pleins de jolies fleurs de toutes les couleurs. Et mon grand-père aime les animaux, si bien qu’il y avait toujours des chiens et puis des chats errants qui passaient là pour manger, et certains même y restaient quelques temps, et il y avait une volière où il prenait soin d’oiseaux blessés, ou juste un peu mal en point, ou juste à la recherche d’un petit point de chute. Des petits colorés, des gros tout noirs et puis des pigeons aussi. A une époque, il avait même un canard domestique qui le suivait partout, si bien qu’on aurait pu croire que son ombre s’était transformée en un petit canard qui dodelinait de la croupe pendant qu’il remuait du bec, et parfois, il se retournait et il regardait le canard et le canard comprenait, alors il arrêtait de le suivre et il retournait dans le jardin. Un jour son canard s’est fait écraser sur la route qui borde la maison et mon grand-père était très triste. Partout où il allait, sa nouvelle ombre à plume n’était plus là, il n’y avait plus qu’un lui-même ombrageux qui le suivait.
Parfois, le week-end, ou alors quelques semaines pendant les grandes vacances, j’allais chez eux et je quittais la ville. Je quittais le béton et les halls d’entrée et les cages d’escaliers et les longs couloirs et voilà que j’étais au milieu des fleurs et des champs et des forêts et des collines. On allait chercher les carottes et puis les pommes de terres et puis les haricots verts directement dans la terre dans un petit jardin situé à quelques pas des chez eux et grand-père ramenait de la viande pour six mois d’affilée avec son grand fusil de chasse ou pêchait du poisson avec sa longue canne-à-pèche.
Avec grand-mère et mes cousines on allait se promener sur de petits chemins de terre et de gravillons et on donnait de l’herbe aux vaches et on regardait les chevaux courir dans leurs enclos et on croisait des faisans et parfois mêmes des biches qui restaient plantées là, à nous regarder fixement avec leur oreilles au garde-à-vous pointées vers le ciel, et parfois même encore des sangliers qui passaient à toute vitesse entre les arbres comme un tonneau infernal dévalant une falaise, et on cueillait des pommes et puis des cerises et puis alors on rentrait.
Grand-père m’amenait visiter sa petite hutte en ferraille. On partait dans sa vieille deux-chevaux beige avec les chiens sur la banquette arrière. La vieille Isa avec ses longs poils blancs et marrons et le jeune Jeudi, grand et musclé avec le poil court et noir. Il s’appelait Jeudi parce qu’il est né pendant l’année des « J » et plus précisément encore un jeudi. On se baladait et il me montrait les traces des animaux sur l’herbe ou dans la terre et les différentes sortes d’arbres et de plantes et Jeudi courrait autour de nous partout où l’on allait, propulsé par la fougue de la jeunesse pendant qu’Isa, plus mélancolique, comme si elle sentait que la fin l’attendait sagement au bout du chemin, profitait simplement de cette belle fin d’après-midi ensoleillée en se baignant dans l’eau et en séchant dans la brise, à l’ombre d’un grand arbre qui étendait fièrement ses grandes branches vertes dans le ciel bleu. Ensuite, on faisait un tour de barque en métal sur un petit coin d’eau et je donnais du vieux pain sec aux canards.
Un jour, sur la petite barque avec grand-père, je mangeais un bout de pain à chaque fois que j’en donnais un aux canards, parce que j’avais faim et que si c’était bon pour les canards, ça devait bien l’être pour moi aussi. Depuis, à chaque fois qu’on y retourne, grand-père raconte cette histoire pendant le troisième café, celui avec une petite goutte de café dans beaucoup d’autres gouttes de gnôle. Alors, tout le monde présent ce jour-là autour de la table rigole un grand coup, comme s’ils n’avaient pas entendu cette histoire des centaines de fois déjà, et je souris pendant qu’il me regarde en se demandant si c’est bien moi ce petit blondinet qui l’accompagnait sur sa barque, là-bas, à côté de sa hutte où il ne se rend plus parce que son corps ne lui permet plus. Alors à la place, il reste à l’intérieur à y penser.
Et si je vous raconte tout ça aujourd’hui, c’est parce que l’Amérique d’Harrison me replonge dans la campagne Française de mes grands-parents, même si elles n’ont finalement pas grand-chose en commun, et que le vieux Suédois Lundquist me rappelle mon grand-père, son étrange capacité à se faire comprendre des animaux, son amour pour toute cette nature qui l’entoure depuis toujours et ses petits bouts de philosophie toute simple qu’il laisse échapper dans de petites répliques évidentes comme le soleil qui se lève le matin.
Et qu’à chaque fois que je referme son livre, j’ai envie d’avoir dix ans à nouveau et de visiter la campagne avec mes yeux d'enfants et de retourner faire de la barque et de donner du pain sec à manger aux canards. Et si une petite faim vient me tenir compagnie pendant qu’on file tranquillement sur l’eau, alors je mangerais un peu de pain sec avec eux.