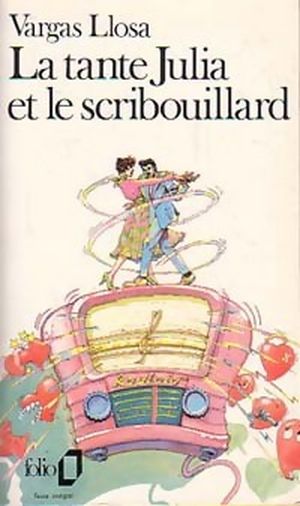La tante Julia et le scribouillard est avant tout l'histoire d'amour contre vents et marées entre le jeune Varguitas, dix-huit ans, étudiant en droit, petit employé au service information de la radio Panamericana de Lima et aspirant écrivain, et la tante Julia (par alliance, heureusement), divorcée, et de quinze ans son aînée. Certains faits sont romancés mais ce roman ne reste pas moins autobiographique, ce qui en fait une histoire tout à fait remarquable.
Mario Vargas Llosa nous offre une réelle plongée au cœur de la classe populaire liménienne des années 50. On y découvre une ambiance kitsch et rétro, très colorée, flamboyante. Cette ville de Lima semble se mouvoir d'une manière frénétique, les rues, les cafés regorgent de gens et de vie, mais est aussi bruyante, sale et vétuste. Le récit fait état d'une société parfois violente, et très souvent raciste, ce qui rend la lecture de quelques passages pénible.
Tels sont les contrastes de ce livre, calme et agitation, sobriété et ivresse, amour et violence se succèdent sans cesse. Et ceux-ci sont exacerbés par l'extraordinaire idée de l'auteur d'alterner un chapitre sur deux entre le récit de la vie de Varguitas et un feuilleton radiophonique, les fameuses telenovelas.
En effet, il faut s'imaginer un monde pré-télévision où la ménagère tire son divertissement de feuilletons joués par des acteurs à la radio, tous les jours à la même heure. Pedro Camacho, un petit personnage excentrique bolivien et collègue de Varguitas, déchaine les passions avec ses feuilletons, mais il dérange lorsque ses idées deviennent floues et s'emmêlent. On suit leur évolution avec autant d'intérêt et d'impatience que ses auditeurs et cela nous plonge totalement dans ce monde si anachronique. Et l'on est tenu en haleine par la rocambolesque histoire d'amour entre le "morveux" et la "divorcée", insulte véhémente dans un Pérou empreint de puritanisme.