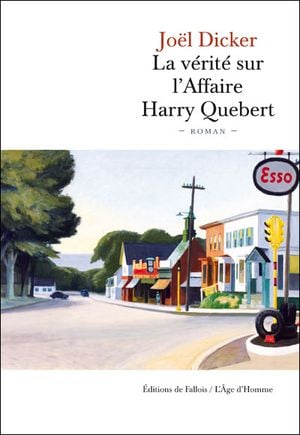Un écrivain qui écrit au sujet d’un écrivain fictif, tiraillé entre l’angoisse de la page blanche et le sentiment d’être un imposteur, il y a de quoi lever les yeux au ciel. Quelque part, La vérité sur l’affaire Harry Quebert est un ouvrage anecdotique pour son histoire, mais intéressant pour ce qu’il raconte d’un homme, qui n’a réussi à être édité qu’au bout du cinquième ou sixième manuscrit, à une époque où il est de plus en plus facile, contrairement à ce que la rumeur en affirme, de se faire imprimer. Comment expliquer, sinon, les cinq cents livres disponibles à chaque rentrée littéraire, et les nouveaux arrivages de l’hiver suivant ?
L’histoire possède de vagues relents de Twin Peaks, avec une jeune adolescente assassinée dans un trou perdu de l’Amérique, en apparence sans histoire, dans lequel on découvre bien évidemment que tout se cache sous la fine pellicule des apparences extérieures, et que la morte n’était pas si innocente qu’on nous le faisait croire au début. Il est difficile, d’inventer une histoire fondamentalement originale, qui semble se détacher de toute influence directe. Cependant, au discrédit de Joël Dicker s’ajoutent en plâtrées écœurantes tous ces clichés rabâchés jusqu’au vomissement sur l’Amérique. La pudibonderie, le libéralisme, les méchants garants de la morale s’agglomèrent dans un ensemble cacophonique pour nous servir une soupe verdâtre, qui, pire que l’absence de style, nous propose des dialogues dont l’incongruité a malheureusement atterri dans nos mains, devant nos yeux non préparés. Passons sur la mère juive qui, caricaturale, peut être apparemment défendue comme étant un avatar d’un réel. Parce qu’il y a de quoi pointer du doigt, entre les conseils d’écriture prodigués en début de chapitre, dignes des fonds de rayons des ouvrages sur la psychologie, et les ratés concernant les paroles d’une gamine de 15 ans, comme si elle sortait tout droit de la série Violetta. C’est d’autant plus dommage que l’amour, censé être le leitmotiv de La vérité sur l’affaire Harry Quebert, est perpétuellement ridiculisé par un discours tarte à la crème, quand des personnages, et même l’ouvrage tout entier aurait mérité mieux qu’une simple note d’intention, mièvre à l’excès et sans saveur.
Une ligne sépare deux camps, deux types de personnalités dans ce livre. D’un côté, les fameux imposteurs, supposés, ou avérés, qui en font une fixation, tels les incompétents notoires auxquels chacun est confronté au moins une fois dans sa vie ( il faut poser la question: a-t-on déjà réellement vu des personnes obsédées par l’idée d’être factices, qui ne le sont pas réellement ?). D’un autre, les adaptés au système. Flics, éditeurs, agents littéraires, mères poules, riches à l’abri. Dans ce monde manichéen que nous sert La vérité sur l’Affaire Harry Quebert, la complexité des protagonistes se résume à l’épaisseur d’un cheveu, plus ou moins habilement masquée par une astuce de magicien au chapeau à double fond, qui consiste à jouer avec les apparences. Mais, le contrepied du manque d’individualité de ses personnages pousse le malheureux Joël Dicker à nous proposer une histoire cousue de fil blanc, fatigante dans ses deux premiers tiers, tant il ne se passe rien, truffée de mobiles farfelus, tenables uniquement grâce à des ressorts fictifs vus et remâchés.
Alors, où se trouve l’intérêt de ce livre, vendu à trois millions d’exemplaires, dont on peut décréter qu’il est le coup mercatique le plus réussi de la rentrée 2012 ? Dans sa simplicité, et, pour ceux qui vont au-delà, dans ce qu’il raconte de Dicker. La vérité sur l’affaire Harry Quebert enchaîne les poncifs, mais le fait facilement, de sorte que quiconque résistera à l’ennui face aux petits retournements de situation qui n’apportent rien à la trame principale du récit aura paradoxalement passé un moment plutôt correct, comme si les personnages nous étaient sympathiques, à leurs dépens. Un peu comme Joël Dicker, dont on comprend bien que les interrogations sur les impostures sont inhérentes à sa personnalité. Comment continuer à croire, quand on veut être écrivain, mais qu’on n’arrive pas à franchir le pas de l’édition ?
En somme, la meilleure façon d’écrire un livre consiste à tirer de soi ce qui est susceptible d’intéresser les autres. Cette approche, naturelle, se heurte à la réalité, où le génie, s’il est un mythe, peut s’approcher par le travail assidu. Joël Dicker, c’est cette grenouille dans les contes merveilleux qui rêve d’être transformé en prince, grâce au baiser du public la princesse. Tant mieux pour lui, il a réussi. Peut-être se sent-il moins empêtré dans la supercherie, et c’est tout ce qu’on lui souhaite.