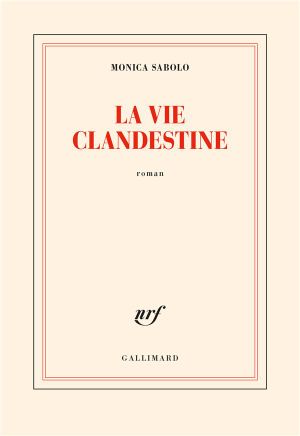Monica Sabolo s’inscrit avec La vie clandestine dans un genre de récit plutôt efficace, comme on en voit maintenant cent à chaque rentrée, dans lequel un auteur-narrateur se pique d’entremêler à la petite histoire - la sienne ou celle de sa famille - celle d’un fait divers plus ou moins retentissant qui, pour une raison ou pour une autre, l’attire, le requiert. La recette est éprouvée et fonctionne à tous les coups.
Le problème ici est que Monica Sabolo avoue elle-même avoir choisi son sujet (l’histoire du groupe terroriste d’extrême-gauche Action directe et celle de leur fait d’armes le plus marquant, l’assassinat du PDG de Renault) au petit bonheur la chance, en écoutant des podcasts et en jetant son dévolu sur le thème qui lui semblait le plus bankable, pour s’en emparer avec un enthousiasme si soudain et dépourvu de fondement qu’il semble feint. Rendu aux deux tiers du roman, je cherchais encore pourquoi elle avait tenu à l’écrire : je crains qu’il n’y ait aucune autre raison que celle-là.
Monica Sabolo n’a en réalité rien de personnel à écrire sur Action directe, rien d’autre à produire qu’une compilation de sources qu’elle cite mécaniquement, revendiquant sans honte son inculture politique et son incompréhension totale des questions idéologiques portées par le groupe. Quand elle a l’occasion de rencontrer d’anciens proches du réseau, elle se jette sur eux comme la petite vérole sur le bas-clergé breton, pour aussitôt reconnaître qu’elle ne sait pas quoi leur demander et qu’elle ne retient pas grand-chose de leurs échanges. En retour je n’ai donc rien à en dire, à peine suis-je capable d’en penser quelque chose. Cette entreprise est-elle réellement empreinte du cynisme consternant qu’elle affiche (fabriquer un récit à partir d’une matière dont on sait qu’elle restera à une distance suffisante pour ne pas perturber le fonctionnement de la machine narrative vide et creuse mais vendeuse du roman-enquête) ? Ou s’agit-il d’une des tentatives les plus tristement illusoires de plaquer un récit sur une histoire familiale douloureuse (de timides ponts étant jetés, à partir de la moitié du livre, avec la vie familiale de l’autrice : « moi aussi, j’ai vécu une vie clandestine », semble-t-elle vouloir dire dans une forme de parasitisme psychique aberrant, qui arrive même à desservir le récit de sa relation au père qui aurait pourtant de quoi interpeller) ? Je ne sais même pas - mais dans les deux cas, vous me direz, ça n’a rien de très glorieux.